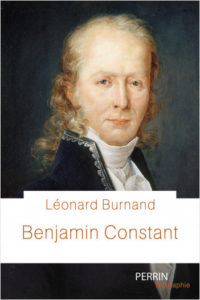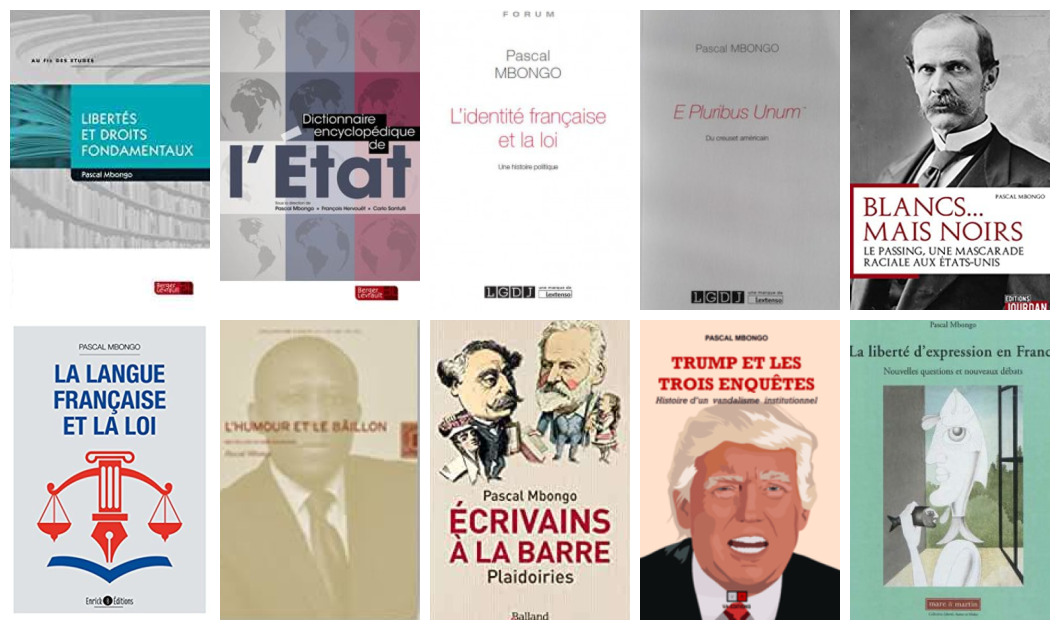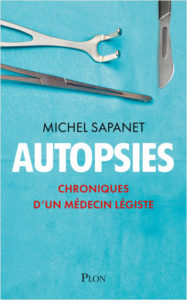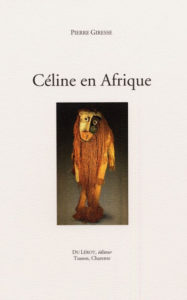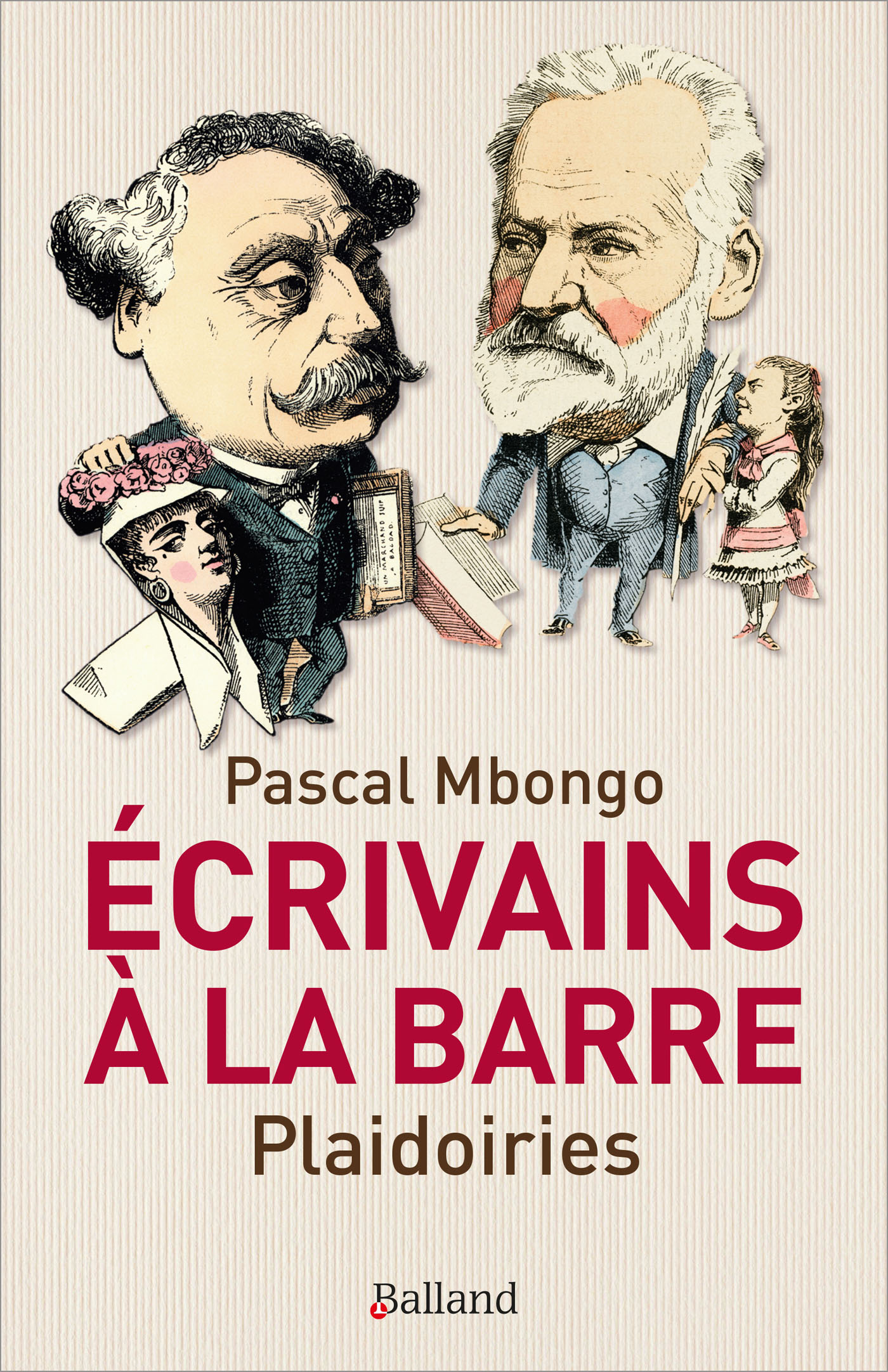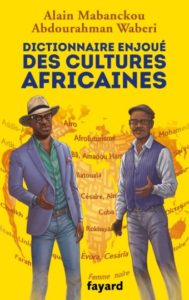De l’humour. Dans les deux textes ci-après, Félicien Challaye, camarade de promotion de Charles Péguy à l’Ecole normale supérieure raconte d’abord comment Péguy a cherché à se dérober au canular à son arrivée en 1894 à l’Ecole, puis comment il a échoué à être élu chef de canular.
Je ne constatai la présence de Péguy qu’après la semaine d’innocentes brimades infligées par les anciens aux nouveaux, ce qu’on nomme en argot normalien le canular.
Pendant ces sept jours, les nouveaux, les gnoufs[1], étaient les domestiques des anciens, utilisés à transporter d’une turne[2] à l’autre les livres, les cahiers, les notes, tous les biens des carrés et des cubes[3]. Ils leur servaient aussi de jouets, en des séances récréatives dirigées par le chef de canular. Notre ahurissement amusait les normaliens quand, la nuit, ils venaient nous retourner dans nos lits ; quand, le jour, ils nous faisaient combattre les uns contre les autres à coups de traversin, ou quand ils nous conduisaient, enveloppés chacun dans un drap de lit transformé en suaire, baiser la dernière vertèbre du méga[4] ; un squelette de mégathérium, dont l’ancienneté symbolisait les plus lointaines traditions de l’école. On contait qu’il y a quelques dizaines d’années, un gnouf ayant refusé d’accomplir ce geste, qu’il jugeait déshonorant, Jaurès improvisa un magnifique discours, flétrissant cette manifestation d’un monstrueux irrespect, et exprimant l’indignation éprouvée par l’archicube méga devant un scandale dont il n’avait jamais encore été témoin…
Après plus d’un demi-siècle, bien des détails de ces pittoresques scènes vivent encore devant mes yeux. Je vois s’agiter avec une verve extraordinaire le chef de canular, le cube Feyel ; j’écoute ses mots d’esprit que rendait encore plus piquants un bégaiement léger. Je me rappelle la stupeur du petit provincial bien élevé que j’étais quand je l’entendis hurler; après la bataille aux traversins : « Le combat ayant eu lieu à l’arme blanche, il n’y a pu y avoir que des pertes de même couleur ».
Le dernier soir du canular, au cours d’une vaste assemblée, certains nouveaux devaient s’exhiber en grimpant sur un poêle, pendant que quelques anciens ; qui souvent avaient été au lycée leurs camarades, chantaient une chanson dénonçant leurs ridicules physiques ou moraux. J’entends encore le refrain de la chanson consacrée à notre camarade Albert Mathiez, dont la douceur n’était point la qualité dominante :
« C’est épatant :
Rouspétait tout le temps ».
À la fin de cette séance, le chef de canular proclamait qu’il n’y avait jamais eu de gnoufs, qu’il n’y avait plus que des conscrits[5]. Un bal animé, où les plus jeunes d’entre nous faisaient fonction de danseuses, mettait fin au canular. Puis cubes et carrés invitaient les conscrits à prendre le thé dans leurs turnes. Je fus invité par Paul Crouzet, le futur historien de la littérature, qui devait devenir inspecteur général de l’instruction publique, et qui partageait sa turne avec Gustave Téry. Sur le pas de la porte, j’entendis la grosse voix de Crouzet faire à mon sujet un calembour, que j’ai dû plus d’une fois subir : « Dans cette maison, tu travailleras, Challaye, de nécessité »…
Dans cette période de la vie normalienne, qui avait l’avantage de faire se connaître les membres des diverses promotions, et aussi les nouveaux venus entre eux, comment se fait-il que je ne remarquai point une silhouette aussi originale que celle de Péguy et qu’au contraire elle me frappa de suite après la fin de cette semaine fatidique ?
On me conta que Péguy, dès son succès au concours de l’École, avait déclaré les brimades du canular contraires à la dignité humaine, proclamé sa décision de ne point s’y plier, annoncé sa ferme résolution de casser la figure au premier des anciens venus pour le canuler ; et que l’administration, connaissant son énergie, redoutant un esclandre, l’avait invité à rester chez lui huit jours de plus.
Cette explication me parut confirmée quand j’appris que, quelques jours avant l’entrée de l’École, Péguy avait, pour exprimer son refus d’accepter le canular, convoqué en un café quelques camarades amis, dont Albert Mathiez. Celui-ci conduisit à la petite réunion son cousin et correspondant ; c’est de sa fille que je tiens ce récit.
Le bruit se répandit, parmi les normaliens, que Péguy n’avait pas comme nous subi le canular, et que l’administration avait reculé devant son énergie.
À mes yeux, comme aux yeux de tous les nouveaux, cet « on-dit » lui conféra un extraordinaire prestige, dès le début de notre vie commune.
*
(…) Une amusante agitation secoua les conscrits quand il s’agit d’élire le futur chef de canular. Il y eut de nombreux candidats. Fidèle à ses convictions antérieures, Péguy posa sa candidature en qualité d’anti-canulariste : son élection signifierait la fin d’une tradition stupide, comportant des violences attentatoires à la dignité d’autrui. Bien que ne me sentant aucune vocation pour la conduite de ces manifestations collectives, je fis aussi acte de candidat, me proclamant canulariste modéré. Personnellement, j’avais trouvé utile et pittoresque cette semaine pendant laquelle les membres des diverses promotions, mêlés les uns aux autres, arrivaient à se mieux et plus vite connaître. Je proposais de supprimer les brimades vraiment désagréables, celles qui se produisaient la nuit et troublaient le sommeil, tout en maintenant, dans l’ensemble, l’antique tradition de l’école ; idée que, dans mon affiche électorale, je symbolisai par la formule : « Ne contristons point le Méga ». (Dans le numéro de l’Illustration consacré à l’école Normale à l’occasion de son centenaire, la phrase figure sur l’image reproduisant le mégathérium, inscrite sur le socle au-dessus duquel se dresse le gigantesque squelette).
Je crois me rappeler que Péguy recueillit seulement les voix de ses coturnes, et encore. Je n’obtins pas une seule voix ! Mes camarades avaient bien apprécié l’incapacité où j’aurais été de conduire un canular ! Un des candidats avait fait une campagne animée de mots d’esprit et même de calembours : « Que fait la brebis ? Elle bêle… Votez pour lui ! ». Paul Elbel fut élu chef de canular, préludant par ce triomphe à d’autres succès électoraux et parlementaires (il devint plus tard député des Vosges, puis ministre de la Marine marchande, avant de mourir prématurément).
Félicien Challaye, Les Deux Péguy, Editions Amiol-Dumont, 1954.
[1] Ainsi appelait-on alors un nouveau reçu à l’école normale supérieure. Après avoir passé un rite initiatique (le canular), le gnouf devenait un conscrit. L’expression ne désigne plus de nos jours que tout élève de première année.
[2] La « t(h)urne » désigne une chambre de Normalien, en argot de l’école normale supérieure. Et un « coturne » est un camarade de chambre, dans le même argot.
[3] Le « carré » est un élève de deuxième année, et le « cube » est un élève de troisième année.
[4] Cette expression désigne, en argot de Normalien, le « week-end d’intégration » à l’école normale supérieure. « Historiquement, comprend-on, les élèves entrant à l’École étaient invités à se prosterner devant un fossile de Megatherium conservé à la Bibliothèque de lettres. Le fossile a depuis disparu, et le Mega, lui, s’est adapté… ».
[5] En argot de l’Ecole normale supérieure, un « conscrit » est un étudiant de première année.