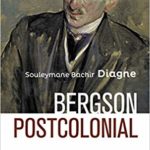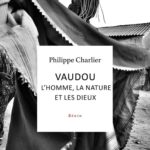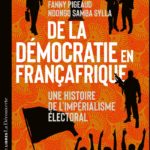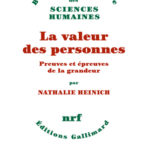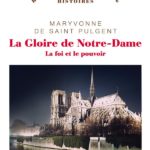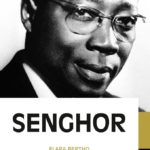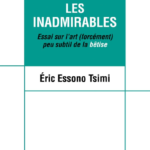Les Bons Ressentiments. Elgas, lu par Mohamed Mbougar Sarr (Libération, 21 avril 2023)
L’écrivain et journaliste Elgas, qui m’avait fait l’honneur de parler pour Libération de mon Blancs mais Noirs, vient de publier un essai remarqué. Mohamed Mbougar Sarr signe ce jour (21 avril 2023) dans Libération à propos du livre d’Elgas une intéressante tribune intitulée Les bons ressentiments sont toujours mauvais qu’on se permet de reproduire ici en fair use d’abonné de Libération.
*
«Je refuse de répondre à vos questions, monsieur, c’est trop bizarre.» Tenter, comme j’allais le faire, d’interviewer professionnellement Elgas au sujet de son dernier essai, les Bons Ressentiments, avait quelque chose d’étrange. Nous nous connaissons bien et partageons nombre de passions et tables depuis plus de dix ans. De livre en livre, son goût pour le débat intellectuel n’a jamais fléchi.
Par son ambition théorique, celui qui vient de paraître en donne l’exemple le plus fort. Ecrire un «essai sur le malaise post-colonial» (c’est son sous-titre), avec tout ce que cela implique, expose à bien des malentendus, adoubements malhonnêtes, anathèmes faciles. Elgas est bien conscient des pièges auxquels sa réflexion pourrait le livrer. Il me raconta d’ailleurs un récent événement où il intervint, au cours duquel d’éminents représentants de la diplomatie française en Afrique le félicitèrent pour son propos et saluèrent la nécessité de son livre. «On a besoin d’entendre certaines vérités !» Celles que mon camarade présente, dans sa volonté de questionner leurs idées sans les caricaturer, ne les épargnent pourtant pas. Il décrit même dans son essai ce qu’il vivait aussi à cet instant-là : le moment où les institutions françaises savaient anesthésier, par une magnanime reconnaissance, ceux qui leur rappelaient le prix de leur «rayonnement» dans leurs ex-colonies africaines. Et mon camarade ne l’ignorait pas, qui sourit lorsque je lui demandai comment il comptait éviter d’être «récupéré». Réponse dans son style caractéristique : «Je ne suis pas dans cette contradiction mentale qui consiste à dénigrer la France par principe, alors que j’y vis et y écris depuis dix-sept ans, quasiment le même nombre d’années que j’ai passées au Sénégal. On ne peut pas toujours éviter le baiser de la mort français, mais il n’est pas un bâillon, en ce qui me concerne.»
Procès en aliénation
De bâillon, il en est précisément beaucoup question dans les Bons Ressentiments. Le livre s’ouvre en effet sur la révision d’un procès classique qu’essuyèrent maintes figures politiques, intellectuelles ou artistiques africaines du passé ou du présent. Toutes commirent, selon leurs procureurs, le suprême crime de s’être montrées trop conciliantes avec l’ennemi européen, quand elles ne lui servirent tout bonnement pas de cheval de Troie. A cette barre des «collabos», furent présentés Léopold Sédar Senghor, l’essayiste camerounaise Axelle Kabou, ou Yambo Ouologuem, pour les plus connus. Il leur fut reproché, au nom de combats politiques ou de postures identitaires, d’avoir trahi les leurs : d’être, par conséquent, des aliénés – voilà la terrible inculpation. Certains accusés ne s’en relevèrent jamais et s’enfoncèrent dans un silence où l’orgueil blessé le disputait à une impuissance sans issue ; d’autres traînèrent la disqualification toute leur vie, devenant des sortes d’eternalusual suspects. L’accusation pourrait d’ailleurs se mêler à la réception de ce livre. Cela ne serait ni étonnant ni une première : tel article ou portrait dans la presse sénégalaise, telle tribune, tel livre a déjà valu à Elgas d’être mis dans la sauce, comme on dirait aujourd’hui.
Où faudrait-il chercher la source de ce procès en aliénation ? Dans un affect, répond l’essai : le ressentiment. Qu’il soit «bon», c’est-à-dire légitimé par le présupposé d’une faute éternellement occidentale, ne change rien à l’affaire : le ressentiment empêche de penser clair et juste. Il empêche surtout de penser contre soi, ce qui est une condition de la lucidité. La référence à la formule gidienne est transparente : si on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, on fait encore moins de bonne pensée politique avec de bons ressentiments, qui sont toujours mauvais. Cette certitude est étayée par une puissante intuition : il se pourrait qu’au fond, le contre-discours décolonial n’ait pas conscience de sa propre aliénation, une incapacité à exister ou se structurer en dehors d’une opposition dont les règles sont non seulement acceptées, mais parfois édictées par ceux qu’il prétend attaquer.
Il peut y avoir quelque limite à analyser un fait intellectuel et politique de cette complexité à la lumière d’une donnée psychologique. Elgas, lecteur attentif de la Cynthia Fleury de Ci-gît l’amer (Gallimard, 2020), le reconnaît volontiers, mais précise qu’il ne réduit pas tout le malaise post-colonial à la psychologie. Il admet aussi que le mouvement dit décolonial est vaste ; qu’il s’exprime sous diverses formes, à travers plusieurs disciplines et dans différents espaces culturels depuis de longues décennies. Nous avons à ce propos longuement évoqué l’Amérique latine, où le mouvement trouve ses racines et son actualité la plus vive. Peut-être mon camarade étendra-t-il le spectre de son analyse à cet espace dans un ouvrage prochain ; pour celui-ci, il voulait rester dans l’espace francophone, où la tendance s’affirme dans la recherche académique, le terrain politique et le champ artistique, parfois en même temps, au risque de la confusion. Que recouvre, au juste, le mot «décolonial», comme adjectif ou comme adjectif substantivé ? Elgas ne se risque pas à la définition, mais doute qu’il désigne une «pensée». Tout au plus s’agit-il pour lui d’une méthode de travail qu’un usage militant a idéologisé à outrance, au point d’en obscurcir le sens ou de le figer dans des positions politiques dont la revendication appelle parfois la surenchère. «C’est absurde de prendre des outils pour des identités», tranche-t-il.
Impossible, évidemment, de ne pas évoquer toutes les charges médiatiques et polémiques que suscite le mot en France. La plupart d’entre elles proviennent d’un camp conservateur voire réactionnaire, qui fustige aussi, dans un rejet indistinct et aveugle, le wokisme, les néoféminismes, la cancel culture, la déconstruction, etc. Elgas n’inscrit clairement pas son travail, en effet beaucoup plus nuancé, dans cette perspective droitière. Il la raille presque, la jugeant souvent «intellectuellement paresseuse» et «affaiblie par une panique déraisonnable». Il se sentirait plus proche d’un Jean-François Bayart, dont les Etudes postcoloniales. Un carnaval académique constitua pour lui une lecture importante.
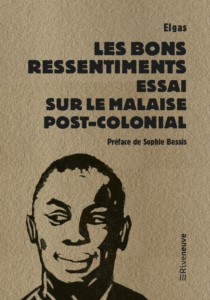
«Vulgate» et «mutine»
D’autres parrainages intellectuels se dégagent : il cite le sociologue et économiste sénégalais Amady Aly Dieng et mentionne Axelle Kabou («qui, parmi nos intellectuels, développe aujourd’hui une pensée aussi dense qu’elle ?» m’a-t-il dit un jour). Pour la sainte colère et le style, voyez Bernanos et Césaire. Albert Londres suscite son goût pour le journalisme.A Desproges la paternité de l’irrévérence joyeuse. Ici, cependant, le grand maître d’Elgas, docteur en sociologie, demeure Georges Balandier. Rien d’étonnant à ce que ce remarquable polymathe, africaniste sans l’arrogance du surplomb, esprit rigoureux et curieux, courageux et soucieux du réel, ait présidé à l’écriture des Bons Ressentiments. Après tout, Elgas n’a-t-il pas voulu décrire dans ce livre une «situation décoloniale», en écho à la «situation coloniale», concept majeur de la pensée de Balandier ? Il a en tout cas hérité de ce dernier le goût de l’étude sérieuse, référencée, sensible, combative mais ouverte à la critique. Et libre, surtout. C’est le mot préféré du bonhomme, peu devant «tropisme», «vulgate» et «mutine».
Alors que nous allions nous séparer, je songeai à la fin de l’essai. Elgas y défend la belle notion d’incolonisable : ce qui, n’ayant pu être colonisé, échapperait du même coup au besoin furieux de tout décoloniser. A quoi songe-t-il ? A des espaces (Coubanao, un des villages de son enfance casamançaise, ou encore Foundiougne). A des temps, des savoirs, des jeux. Au génie des langues. A un esprit insaisissable et ouvert, que rien n’a pu arracher ou humilier. Je n’ai pas osé dire à mon ami que par l’éloge de cet incolonisable, il était presque décolonial à sa manière. Cela, aussi, aurait pu lui sembler bizarre.
Elgas, Les Bons Ressentiments, Riveneuve «Pépites», 200 pp., 11,50 €.
Benjamin Azoulay, Abel Bonnard. Plume de la collaboration, Perrin, 2023.
En 1932, Abel Bonnard est élu à l’Académie française. À quarante-huit ans, le plus brillant causeur des salons de l’entre-deux-guerres est au faîte de sa carrière littéraire. Poète précoce, délicat moraliste et grand voyageur, « l’exquis Bonnard » va pourtant se muer en tribun flamboyant et en essayiste fulgurant au service du fascisme. Comment ce cosmopolite méditatif – qui écrivait encore, en revenant de Chine en 1924, que « le voyage donne plus de liberté à nos rêves » – est-il devenu l’idéologue le plus méthodique de la Collaboration avec l’Allemagne nazie ? Quel rôle a-t-il joué durant l’Occupation ? Comment les tribunaux l’ont-ils jugé ?
L’itinéraire extraordinaire du poète est ici brossé avec maestria : ses jeunes années en province, ses débuts littéraires, son entrée fracassante dans le Tout-Paris de la Belle Époque, son engagement politique dans les années 1930 puis sa conversion immédiate et sans retour à la Collaboration qui lui vaudra le portefeuille de l’Éducation nationale en 1942 dans le gouvernement Laval. Mais le ministre n’accomplira jamais la Révolution pédagogique qu’il avait théorisée : criblé d’épigrammes par la Résistance qui fustige son homosexualité présumée, « la Belle Bonnard » – tantôt appelé « Gestapette » – est chassée par la Libération. Ce pilier du collaborationnisme trouve alors refuge en Allemagne puis en Espagne. Radié de l’Académie, jugé deux fois et deux fois condamné, Abel Bonnard meurt en 1968 à Madrid.
S’appuyant sur de nombreuses sources inédites, Benjamin Azoulay retrace sans manichéisme le parcours inattendu d’une figure aujourd’hui tombée dans l’oubli, mais ô combien complexe, fascinante et sulfureuse.

Christophe Bourseiller, Ils l’appelaient Monsieur Hitler, Perrin, 2022
De la naissance du parti nazi en 1920 jusqu’à la déclaration de guerre en 1939, on a vu croître en France un courant d’opinion pacifiste, humaniste, européiste et germanophile. « Hitler est un modéré, disaient en substance ses apôtres, c’est un humaniste, un pacifiste. Il n’est antisémite que par tactique. Il calmera ses troupes. D’ailleurs, l’Allemagne ne veut pas la guerre… » Qui étaient les partisans de cette grande réconciliation généralisée entre les peuples ? Jean Luchaire, Fernand de Brinon, Jacques Benoist-Méchin, pour n’en citer que quelques-uns. En parallèle, l’extrême droite française se construit, à l’exemple du fascisme, puis du nazisme. Le Faisceau, la Solidarité française, le Parti franciste, le Parti populaire français et une myriade de groupements haineux inventent le fascisme à la française et soutiennent ouvertement les dictatures, en général, et Hitler, en particulier. Lorsque la guerre éclate, ces adeptes se métamorphosent, s’enfonçant dans une collaboration toujours plus radicale, qui les mène, en une spirale destructrice, à l’apocalypse de 1945. De Pierre Laval à Jacques Doriot en passant par Alphonse de Chateaubriant, Marcel Déat, Eugène Deloncle et beaucoup d’autres, nous suivons ainsi les parcours inouïs de ces champions de la paix devenus des prêcheurs de haine.
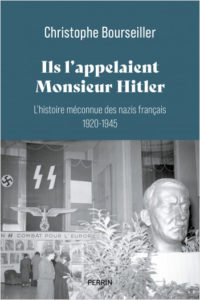
Dan Morain : Kamala Harris. Des rues d’Oakland aux couloirs de la Maison-Blanche, Talent Editions, 2021
Dan Morain, reporter au Los Angeles Times, nous raconte comment cette enfant d’immigrés, née en Californie au temps de la ségrégation, est devenue l’une des actrices majeures du pouvoir américain.
Son récit nous plonge au cœur des années que Kamala Harris a passées en tant que procureure générale de Californie, explore son soutien téméraire à un Barack Obama encore peu connu, et montre comme elle a su jouer des coudes pour accéder au Sénat.
Il analyse également son échec à devenir candidate pour la présidence, et les coulisses de sa campagne de vice-présidente.
Tout au long de son récit, Dan Morain nous dépeint le portrait de sa famille, nous révèle ses valeurs et ses priorités, tout comme ses faux pas, ses prises de risques et l’audace dont elle a fait preuve lors de son ascension.

John Bolton : La pièce où ça s’est passé, Talents éditions, 2020.
Conseiller à la Sécurité Nationale de Donald Trump, John Bolton a passé 453 jours au cœur du pouvoir américain avant d’être remercié. Vivez heure par heure son histoire.
John Bolton nous offre un compte rendu précis de la gestion des crises internationales et nous révèle de nombreuses anecdotes sur Trump : la position américaine sur le climat, la Corée du Nord et son dictateur « Rocket Man », l’Iran, la Syrie, l’Ukraine, les batailles au G7, le plan fou pour amener les Talibans à Camp David…, et nous livre la méthode Trump pour gérer les relations internationales des États-Unis. Ce qu’il en a vu l’a estomaqué : un président focalisé sur sa réélection, quitte à demander l’aide de la Chine pour soutenir la politique agricole américaine, ou demander au président ukrainien d’enquêter sur son rival politique.
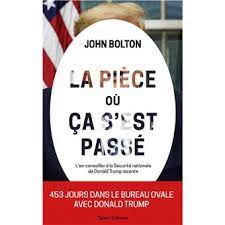
Il nous dépeint un président addict au chaos, qui embrasse les ennemis des États-Unis et méprise ses alliés historiques. Bolton n’en revient pas de voir Trump gérer la politique étrangère comme une négociation immobilière. Avec pour résultat d’affaiblir la position des États-Unis face à la Chine, la Russie, l’Iran, et la Corée du Nord.
Dès son arrivée, Bolton est confronté à la crise des attaques chimiques en Syrie, les échanges avec la France, le détail des appels téléphoniques entre Trump et Macron.
(la traduction n’est pas heureuse à de nombreux passages)
Thomas Paine, penseur et défenseur des droits humains
Peu connu en France, Thomas Paine fut pourtant député de la Révolution française et ardent défenseur des droits de l’homme. Après avoir été parmi les organisateurs de l’Indépendance américaine en 1776, il a rejoint Paris pour défendre, par la plume et par le verbe, les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité et de fraternité, et leur inscription juridique dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Guidé par sa confiance dans l’humanité, il condamne dans ses ouvrages la corruption et le pouvoir héréditaire. Il y développe l’idée d’une connaissance universelle émancipatrice.

Le présent recueil contient les deux textes fondamentaux de Thomas Paine sur les droits de l’homme. Il est introduit par Peter Linebaugh, historien spécialiste des communs. Pour compléter la documentation, nous y avons joint la Déclaration universelle des droits humains de 1948, et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée par Olympe de Gouges. Deux petits essais permettent une mise en perspective de l’héritage et du génie visionnaire de Thomas Paine, et une découverte de sa biographie rocambolesque.
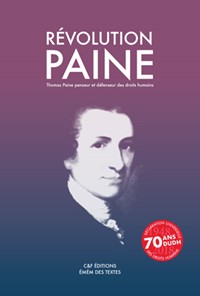
« Anglais de naissance français par décret américain d’adoption », telle pourrait être la courte biographie de Thomas Paine. Ayant participé aux grands événements de la période révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, Thomas Paine a écrit de nombreux ouvrages populaires, dont les deux partie de Droits de l’Homme reproduites ici..
Cet ouvrage est le fruit du travail des étudiantes du Master Édition, mémoire des textes de l’université de Caen, sous la direction de Nicolas Taffin, qui y enseigne l’édition.
L’étonnement que la Révolution française a causé dans toute l’Europe doit être considéré sous deux points de vue différents : d’abord, en tant que cette révolution affecte les habitants des pays étrangers ; secondement, en tant qu’elle affecte les gouvernements de ces mêmes pays.
La cause du peuple français est celle de toute l’Europe, ou plutôt celle du monde entier ; mais les gouvernements de tous les pays ne lui sont aucunement favorables. Il est à propos de ne jamais perdre de vue cette distinction. Il ne faut point confondre les peuples avec leurs gouvernements, et particulièrement le peuple anglais avec son gouvernement.
[…]
Tandis que la Déclaration des droits était en agitation à l’Assemblée nationale, quelques-uns de ses membres remarquèrent que si on publiait une déclaration de droits, il fallait qu’elle fût accompagnée d’une déclaration de devoirs. Cette observation annonce de la réflexion : ils n’erraient cependant que parce qu’ils ne réfléchissaient pas assez profondément. Une déclaration de droits est aussi une déclaration de devoirs réciproques. Ce qui est mon droit comme homme, est également le droit d’un autre homme ; et il est de mon devoir de lui garantir le sien comme de posséder le mien.
Thomas Paine
Elizabeth II (1926-2022).
« La reine Elizabeth II, qui est décédée à l’âge de 96 ans, est devenue au cours de son long règne non seulement la plus ancienne souveraine de l’histoire du pays, mais aussi celle qui a servi le plus longtemps.
Quarante-deuxième d’une lignée de rois et de reines d’Angleterre, puis de Grande-Bretagne, puis du Royaume-Uni, depuis Guillaume le Conquérant, elle était également la sixième reine souveraine d’Angleterre et la quatrième du Royaume-Uni. En outre, elle a été reine et chef d’État de 15 autres pays, allant des Fidji, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande aux Bahamas et au Canada, qui ont tous fait partie de l’ancien empire britannique. Pendant sept décennies, elle a été à la tête du Commonwealth, dont les 54 pays regroupent 2,1 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale.
Conformément au précédent établi par Henri VIII, la reine était également défenseur de la foi et gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre, un rôle qu’elle a pris beaucoup plus au sérieux dans sa vie privée et publique que nombre de ses prédécesseurs.

Son règne a englobé une période qui a vu certains des plus grands changements dans le développement technologique, la vie industrielle, économique et sociale à travers le monde de toutes les époques, pourtant il est difficile de voir son nom être conféré, comme celui de sa prédécesseure la reine Victoria, comme le symbole déterminant d’une époque. Au lieu de cela, elle a joué, en grande partie de manière impeccable, le rôle d’un monarque constitutionnel moderne, une figure de proue symbolique ayant le droit d’être consultée, de conseiller et d’avertir les dirigeants politiques en privé et de se montrer publiquement comme un centre de la vie nationale, de la célébration et de la commémoration.
Si le monde a changé de manière spectaculaire au cours de son règne, la monarchie a fait de même, bien que de manière plus imperceptible : les promenades qui caractérisent de plus en plus les apparitions royales, les concerts pop à Buckingham Palace, l’ouverture des palais royaux aux visiteurs – même le paiement de l’impôt sur le revenu et les podcasts royaux – auraient été des innovations inconcevables à l’époque où Elizabeth est montée sur le trône. Cependant, elle a accepté nombre de ces changements plutôt que de les initier.
En tant que reine, elle faisait partie intégrante du pays et de ses institutions : c’était l’une des femmes et l’un des dirigeants nationaux les plus connus au monde, photographiée, peinte, filmée, décrite, louée – et parfois ridiculisée – depuis qu’elle est devenue héritière du trône, à l’âge de 10 ans, en 1936, jusqu’à la fin de sa vie. La nation – et le monde entier – l’ont vue passer du statut de princesse impavide à celui de jeune reine glamour, de mère et de grand-mère, d’enfant blonde aux cheveux bouclés à celui de vieille dame diminuée aux cheveux blancs, au cours de plusieurs décennies pendant lesquelles son rôle n’a guère changé. Née quinze jours avant la grève générale de 1926, elle a vécu bien avant l’ère de l’internet… »

Doreen Fowler : une lecture freudienne de « Passing », de Nella Larsen.
Les critiques de Passing ont souvent fait observer que le roman semble éviter de s’engager dans le problème de l’inégalité raciale aux États-Unis, et Claudia Tate va jusqu’à écrire que « la race … est simplement un mécanisme pour mettre l’histoire en mouvement » (598). En l’absence apparente de la race comme sujet du roman, les chercheurs ont identifié la classe sociale ou l’attraction lesbienne comme la préoccupation centrale du roman.
Bien que l’attirance pour le même sexe et la classe sociale soient certainement des préoccupations du roman, je soutiens que les critiques ont négligé la centralité de la race dans le roman parce que le sujet de Passing est la répression raciale ; c’est-à-dire qu’une solidarité totale avec un peuple opprimé et racialisé est le référent réprimé, et, pour cette raison, la race apparaît à peine. En tant que roman sur le passing, le sujet de Larsen est le refus de s’identifier pleinement aux Afro-Américains, mais la critique de Larsen n’est pas seulement dirigée contre les membres de la communauté noire qui se font passer pour des Blancs ; Passing explore plutôt la manière dont la race est réprimée aux Etats-Unis à la fois chez les Blancs et chez certains membres de ce qu’Irène appelle la « société nègre » (157). Tout au long du texte, la négrité est recouverte par la blancheur. Même le mot « noir » ou « nègre » semble être presque banni du texte. Comme je le montrerai, le roman explore la manière dont l’association avec une identité noire est réprimée par de nombreux personnages, dont Brian, Jack Bellew, Gertrude et d’autres membres de la société de Harlem, mais Irene Redfield, la conscience centrale du roman, à travers l’esprit de laquelle les événements sont perçus et filtrés, est la principale représentante de la répression raciale. Jacquelyn McLendon observe astucieusement qu’Irene Redfield « vit dans l’imitation constante des Blancs » (97). (2) Partant de cette observation, je soutiens qu’Irene, qui désire avant tout la sécurité, identifie la sécurité à la blancheur et réprime une identification complète avec la communauté noire par refus de l’abjection que les Blancs projettent sur les Noirs. Pour cette raison, Irène ne se contente pas d’imiter les Blancs dans sa vie de bourgeoise de classe supérieure, elle s’efforce, comme une personne passant pour blanche, d’effacer les signes de son identité noire – mais ces signes de négrité reviennent la hanter sous la forme de son double, Claire. Si de nombreux chercheurs ont reconnu qu’Irène est ambivalente par rapport à son identité afro-américaine et que Claire et Irène sont dédoublées, ma contribution originale consiste à relier les deux. Dans ma lecture, Claire est le double étrange d’Irène car elle représente le retour du désir rejeté d’Irène de s’intégrer pleinement à la race noire.
Dans cet essai, je propose que Larsen soit articulée à la théorie freudienne pour analyser la dimension psychologique de la répression raciale. Comme l’observe Thadious Davis, Larsen était « très consciente de Freud, de Jung et de leurs travaux » (329), et la pierre angulaire de la théorie de Freud est la répression. Selon Freud, « l’essence de la répression consiste simplement à détourner quelque chose et à le maintenir à distance du conscient » (« Répression », SE 14:147).
Chose lue : Jean-Pierre Dupuy, « Misère scientifique dans l’intelligentsia française », Cités, 2022.
« Le face-à-face entre le sociologue Bronner et le sociologue Latour résume la misère de l’intelligentsia française. Le rationaliste centriste et l’épistémologue gauchiste partagent une même prémisse : il n’y a de croyances que de croyances non rationnelles.
Le premier veut les chasser ; le second les tient pour irréductibles, au motif que c’est ainsi que les scientifiques, sans s majuscule, travaillent.
Les sciences sociales à la française ont ceci de bon que, quel que soit leur désir de scientificité, elles conservent un substratum philosophique qu’elles ne craignent pas de revendiquer.
Comment alors expliquer que nos sociologues aient oublié leur Platon ? Ils devraient se souvenir que, dans le 𝘛𝘩𝘦́𝘦́𝘵𝘦̀𝘵𝘦, celui-ci définit le savoir comme croyance vraie justifiée.
Et, sauf s’ils sont fâchés avec la philosophie analytique de l’esprit, ils savent que cette dernière a repris et considérablement raffiné cette définition.
Le savoir des scientifiques est 𝘱𝘢𝘳 𝘥𝘦́𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 croyance, ce que Bronner s’interdit d’envisager, mais leurs croyances sont, peuvent et doivent être rationnelles, tournées vers la quête de la vérité, ce que Latour feint d’ignorer.
Dire que le savoir implique la croyance, c’est dire qu’on ne peut savoir si l’on ne croit pas. Il est aussi ridicule de vouloir extirper la croyance de la connaissance (Bronner) que de rabattre la connaissance sur la seule croyance (Latour).
Dans le savoir, il y a autre chose, qui est la vérité – le goût et la quête de la vérité, qui est aussi la quête de sens. Ces mots sont inaudibles par la sociologie 𝘩𝘢𝘳𝘥 des sciences. »
Jean-Pierre Dupuy, 𝘔𝘪𝘴𝘦̀𝘳𝘦 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘴𝘪𝘢 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤̧𝘢𝘪𝘴𝘦, Cités, n° 90, 2022.