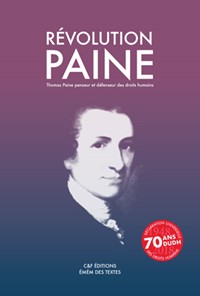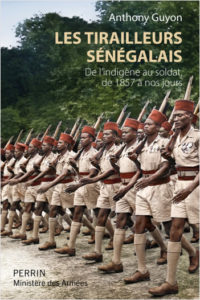Le président de la République française Emmanuel Macron a inauguré le 30 octobre 2023 la Cité internationale de la langue française – Château de Villers-Cotterêts, celle-ci ouvrant au public le 1er novembre. Le président de la République a prononcé à cette occasion un discours qui n’a guère fait l’unanimité en raison d’un certain nombre d’assertions politiquement clivantes. Le président de la République n’a pas moins cédé à telle ou telle idée saugrenue, comme lorsqu’il a assuré que « tous les grands discours de décolonisation [ont été] pensés, écrits et dits en français ». Le président Macron décidait ainsi, probablement par méconnaissance personnelle et des rédacteurs de son discours, de passer à la trappe les discours prononcés en langues autochtones, les discours prononcés en arabe, les discours prononcés en anglais.
Le président de la République s’est en revanche tenu relativement à distance de deux vulgates mémorielles sur la langue française : l’une veut que les Serments de Strasbourg soient l’acte de naissance de la langue française ; l’autre veut que l’ordonnance de Villers-Cotterêts soit l’acte de naissance du français comme « langue officielle » en France. L’histoire politique et légale de la langue française commence bien avant l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Et cette ordonnance ne serait pas célébrée – seulement depuis le 19e siècle – si de nombreux textes postérieurs n’avaient pas voulu, d’une part, en rendre l’application effective partout en France, d’autre part, n’avaient pas imposé l’usage du français dans de nombreux autres cadres de la communication institutionnelle et sociale. Ci-après nos développements dans La Langue française et la loi relatifs à ces questions. On trouvera ensuite une liste simplifiée des textes qui ont fait l’histoire politique et légale de la langue française en France[1] jusqu’à la Révolution. Cette liste s’arrête à la Révolution dans la mesure où, pour l’essentiel, l’histoire politique et légale de la langue française sur le siècle après la Révolution se confond assez largement avec celle de l’instruction publique et des programmes scolaires.
« (…)
Serments de Strasbourg
Historiens, linguistes et grammairiens peuvent toujours assurer que les Serments de Strasbourg du 14 février 842 ne sont pas tout à fait l’« acte de naissance » de la langue française, la croyance inverse ne se perpétue pas moins. Pascal Quignard n’est certes pas le premier à exalter cette croyance[2] :
« Début février 842, les deux armées victorieuses lors de la bataille de Fontenoy se retrouvent à Strasbourg dans un froid glacial, où elles s’établissent, l’une sur la rive de l’Ill, l’autre sur la rive du Rhin.
À mi-chemin, dans la plaine glacée, le vendredi 14 février, à la fin de la matinée, les deux rois et les chefs – les ducs des tribus – portent solennellement un serment de paix entre eux et concluent devant Dieu un pacte d’entraide – maléficiante, sacrée – contre Lothaire.
C’est alors que, le vendredi 14 février 842, à la fin de la matinée, dans le froid, une étrange brume se lève sur leurs lèvres.
On appelle cela le français.
Ce qu’on désigne de nos jours par « serments de Strasbourg » étaient appelés par les évêques et les pères abbés, en langue latine, les « sacrements d’Argentaria ».
C’est Nithard lui-même qui précise, dans son Historia, que la cité d’Argentaria, sur l’Ill, est « maintenant appelée par la plupart de ses habitants Strasbourg » (nunc Strazburg vulgo dicitur).
Rares les sociétés qui connaissent l’instant de bascule du symbolique : la date de naissance de leur langue, les circonstances, le lieu, temps qu’il faisait »[3].
La bataille dont parle Pascal Quignard est celle Fontenoy-en-Puisaye le 25 juin 841. Les armées victorieuses sont celles de Louis le Germanique et de Charles le Chauve (petit-fils de Charlemagne), alliés contre leur frère aîné et empereur, Lothaire Ier. Tous trois petits-fils de Charlemagne et fils de Louis le Pieux, les deux premiers, à la mort de leur père, contestèrent à leur frère Lothaire Ier la qualité de suzerain. Le traité de Verdun d’août 843 scelle, consécutivement à leur conflit, le morcellement de l’Empire carolingien, même si Lothaire Ier conserve sa qualité d’Empereur. Nithard, lui aussi petit-fils de Charlemagne, Comte-Abbé de l’abbaye royale de Saint-Riquier, rédigea les fameux Serments[4] − que Louis le Germanique prononça en langue romane (pour ainsi dire « l’ancêtre du français ») et Charles le Chauve en langue tudesque (pour ainsi dire « l’ancêtre de l’allemand »). D’autres dissonances existent entre l’histoire et le « roman national » de la langue français, celle par exemple sur la continuité formelle et plastique du français. Étienne Dumont a pu faire remarquer à cet égard que « le moyen français n’est qu’une étape intermédiaire entre l’ancien français et le français moderne dont il est la forme archaïque. P. Guiraud, dans son ouvrage sur le moyen français, montre que la langue de Joinville (Histoire de Saint-Louis, 1305-1309) et celle de Froissart (Chroniques, 1370-1400) n’ont à peu près rien de commun et qu’en revanche ce dernier écrit tout à fait comme Brantôme (Recueil des dames illustres, 1600-1610). C’est dire que, dès le début de la guerre de Cent Ans, la langue française a pris sa forme moderne. Si elle est encore un peu embarrassée et flottante, elle le restera jusqu’à la réforme classique du début du XVIIe siècle. Il faut donc faire une différence entre le Moyen âge linguistique, qui se termine en 1340, et le Moyen âge culturel qui, en France, s’étend jusqu’au milieu du XVIe siècle »[5].
La langue française a été un objet hautement juridique entre la deuxième moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe, puis pendant la séquence allant de la Révolution à la fin du Premier ministre. L’Histoire de la langue française de Ferdinand Brunot se singularise précisément par l’intérêt et l’importance qu’elle accorde aux nombreux textes juridiques datés de cette double période. La nouvelle ère de production intensive de textes juridiques relatifs à la langue française commencée dans les années 1960 est d’autant plus distinctive qu’elle voit la France se doter pour la première fois d’un énoncé constitutionnel désignant le français comme langue nationale et langue officielle.
Villers-Cotterêts, lieu de mémoire
« Cette langue, a écrit Merlin de Douai, aujourd’hui si correcte, si claire, si riche des productions de nos plus illustres écrivains, que toute l’Europe a adoptée pour ses actes diplomatiques, et que tout étranger, tant soit peu instruit, tient à honneur de savoir comme sa Langue maternelle, il a été un temps où elle était en quelque sorte, dédaignée par nos magistrats et par nos jurisconsultes, qui se faisaient gloire, les uns de rendre leurs jugements, les autres d’écrire leurs mémoires et leurs consultations, en latin. C’est à Louis XII qu’est dû le premier effort du gouvernement pour faire cesser cet usage d’autant plus étrange qu’on ne parlait alors au palais qu’un latin barbare »[6]. De fait, l’ordonnance de Villers-Cotterêts a été précédée par une ordonnance de 1510 par laquelle Louis XII décida, au détriment du latin, que les actes et documents des procédures criminelles devaient être établis en « vulgaire et langage du pays ». Au demeurant, l’ordonnance de Moulins de 1490, dont l’article 101 était dirigé contre le latin mais n’était applicable qu’en Languedoc, prescrivait l’enregistrement des dépositions des témoins « en langage français ou maternel, tels que lesdits témoins puissent entendre leurs dépositions ».
La prudence est de mise lorsqu’il s’agit de parler de l’ordonnance de Villers-Cotterêts sur le fait de la justice, la police et les finances tant la date et la portée de ce texte sont l’objet d’importants débats historiographiques. De cette ordonnance il est souvent dit qu’elle fut édictée par François Ier en avril 1539. Or d’autres sources datent sa signature du 18 ou du 19 août 1539 et un éminent auteur soutient que le texte « paraît » le 15 août 1539[7]. Ces contradictions ont une explication rationnelle pour une période où le Roi est régulièrement en déplacement et qu’il signe les actes là où il se trouve au moment où ils lui sont présentés. Des traces de son enregistrement sont néanmoins établies pour le parlement d’Aix en octobre 1539 et pour le parlement de Toulouse en novembre 1539.
L’ordonnance de Villers-Cotterêts a donc exigé des notaires l’usage de la « langue vulgaire des contractants ». Quant aux célèbres articles 110 et 111 de l’ordonnance, ils posent le principe de la rédaction en « langage maternel franç[a]is et non autrement » des actes publics, spécialement des décisions de justice. Les voici dans leur rédaction apparemment d’époque et tels que reproduits par Ferdinand Brunot dans son Histoire de la langue française :
Article 110. « Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrests, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et escrits si clairement, qu’il n’y ait ne puisse auoir aucune ambiguïté ou incertitude, ne lieu à demander interprétation ».
Article 111. « Et pour ce que de telles choses sont souuent aduenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’ores en auant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souueraines et autres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel françois et non autrement » ;
L’importance juridique et politique accordée par le « roman national » à l’ordonnance de Villers-Cotterêts est néanmoins relativisée par l’historiographie contemporaine de ce texte ou de la politique linguistique de l’Ancien régime sous différents aspects : la question de l’équivalence linguistique entre le « langage maternel françois » désigné par l’ordonnance et la langue française, la question du caractère pionnier ou non de ce texte dans la « politique linguistique » de la monarchie, la conception ou non de ce texte dans une perspective politique monolinguistique, son degré d’application effective[8]. D’ailleurs, plusieurs textes prescrivant l’emploi de la langue française en matière d’actes publics sont postérieurs à l’ordonnance de 1539. Tel est le cas de l’article 35 de l’ordonnance dite de Roussillon prise par Charles IX en janvier 1563 : « Les vérifications de nos cours de parlements sur nos édits, ordonnances ou lettres patentes, et les réponses sur requêtes, seront dorénavant faites en langage français, et non en latin, comme ci-devant on avait accoutumé faire en notre cour de Parlement à Paris ; ce que voulons et entendons être pareillement gardé par nos procureurs généraux ». Tel est encore le cas de l’ordonnance royale de janvier 1629 dont l’article 27 impose l’usage du français pour les actes, sentences et conclusions des juridictions ecclésiastiques, à l’exception de ceux qui avaient vocation à être expédiés à Rome. Les idiomes locaux furent quant à eux désignés comme repoussoir lorsque la rédaction en français des actes publics fut exigée dans le Béarn (1621), en Flandre (1684), en Alsace (1685), en Roussillon (1700, 1753) ». (…) »
L’histoire politique et juridique de la langue française en France des Serments de Strasbourg à la Révolution (dates et références)
On reproduit ici en substance le travail de bénédictin auquel s’est livré M. Rémi Rouquette dans sa thèse de doctorat Le régime juridique des langues en France, Thèse de doctorat en droit, Université de Paris X, 1987. Comme cette thèse de doctorat n’a pas été publiée, le recensement des textes de droit qui ont fait l’histoire politique et légale de la langue française en France fait par M. Rouquette n’est guère connu par les historiens ou par les linguistes.
842. Serments de Strasbourg
1481. Edit du duc de Lorraine rendant obligatoire et exclusif l’usage du français ou du latin dans les procédures judiciaires
1490 (28 décembre). Ordonnance royale (Charles VIII) relative au « Règlement de justice au pays de Languedoc ». Cette ordonnance impose l’usage du « langage françois ou maternel ».
1510 (juin). Ordonnance royale (Louis XII) relative à la « réformation de la justice ». L’article 47 de l’ordonnance dispose que « dans les pays de droit écrit, les enquêtes se feront en langue vulgaire ».
1531. Lettres patentes de François Ier. Elles décident qu’en Languedoc « les contrats seront en langue vulgaire des contractants ».
1533. Lettres patentes de François Ier « enjoignant aux notaires de passer et écrire tous les contrats dans la langue vulgaire des contractants ».
1535. Edit de Joinville supprimant l’autonomie de la Provence
1535. Ordonnance de François Ier d’Is-sur-Thille sur la réformation de la justice en Provence. « Les procez criminels, et lesdites enquêtes en quelque matière que ce soit , seront faits en françois, ou à tout le moins en vulgaire du pays ».
10 août 1539. Ordonnance de Villers-Cotterêts, articles 110 et 111
1563 (janvier). Ordonnance du Chancelier de L’Hospital sur la justice et la police du royaume. « Les vérifications de nos cours de parlement sur nos édits, ordonnnances ou lettres-patentes, et les réponses sur resquestes, seront faites dorénavant en langage françois et non en latin » (article 35).
11 octobre 1620. Edit de création du parlement de Pau (par suite de l’édit d’octobre 1607 de réunion du Béarn à la France) imposant l’usage exclusif du français
1624. Faculté légale de soutenir des thèses en français
1629 (janvier). Ordonnance imposant l’usage du français devant les tribunaux ecclésiastiques (article 27).
26 mai 1633. Lettres de Colbert en justice l’usage du français en Flandre.
22 février 1635, Publication par Richelieu des Statuts de l’Académie française
1648 (octobre). Traité de Westphalie plaçant l’Alsace sous l’autorité de la France
1657. Ordonnance créant le Conseil souverain d’Alsace
7 novembre 1659. Traité des Pyrénées
1661 (juillet) Lettres-patentes de Louis XIV (Lorraine)
1663 (mai). Lettre royale aux magistrats de Dunkerque
Traité d’Aix-la-Chapelle réunissant à la France certaines parties de la Flandre
1670 (août). Ordonnance criminelle sur le droit à interprète
31 mai 1702. Arrêt du Conseil du roi rendant obligatoire la rédaction en français des actes de l’état civil.
30 mai 1752. Règlements pour l’Académie française
11 janvier 1790. Décret sur les traductions.
2 octobre 1790. Décret instituant la lecture en français des textes officiels à la fin de la messe dominicale
10 septembre 1791. Rapport de Talleyrand
1792. Annexion du pays niçois
4 décembre 1792. Décret sur les traductions
26 vendémiaire an II (17 octobre 1793). Décret de la Convention disposant que « dans toutes les parties de la République française, l’enseignement ne se fait qu’en langue française ».
30 vendémiaire an II (21 octobre 1793). Décret de la Convention disposant que « Les enfants apprennent à parler, lire, écrire la langue française » (article 3)
5 brumaire an II (26 octobre 1793). Décret de la Convention sur l’obligation d’enseigner en français.
21 nivôse an II (10 janvier 1794). Le français devient obligatoire pour les inscriptions sur les monuments.
8 pluviôse an II (27 janvier 1794). Rapport Barère
16 prairial an II. Rapport Grégoire
2 thermidor an II (20 juillet 1794). Décret sur la langue des actes
16 fructidor an II (5 septembre 1794). Suspension du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794).
27 brumaire an III (17 novembre 1794). Décret Lakanal (articles 2 et 3)
17 ventôse an III (7 mars 1795). Décret de la Convention supprimant les collèges et les remplaçant par les écoles centrales
3 brumaire an IV (25 octobre 1795). Loi Daunou (article 5 sur l’enseignement en français non adopté)
19 brumaire an VI (9 novembre 1797). Décret faisant du français la langue du culte catholique
1er frimaire an VIII (22 novembre 1799). Arrêté du préfet de police relatif à la protection de la langue française.
24 prairial an XI (13 juin 1803). Arrêté obligeant à la rédaction en français des actes publics.
——————————————————————————————
[1] De très nombreux textes ont par ailleurs été pris sur l’usage du français dans différents territoires occupés ou colonisés par la France.
[2] Paul-Marie Coûteaux n’est pas moins élégiaque dans être et parler Français, Paris, Perrin, 2006, p. 13-18.
[3] Pascal Quignard, Les larmes, Paris, Grasset, 2016, p. 122-123.
[4] Il fit également le récit de cet épisode historique dans son Histoire des fils de Louis le Pieux (841-843) : traduit et édité par Philippe Lauer, Paris, Honoré Champion, 1926, Paris, Les Belles Lettres, 2012 – traduit par François Guizot, édité par Yves Germain et Éric de Bussac, Clermont-Ferrand, Paléo, 2009 (et 2014). Sur Nithard, voir de Pascal Quignard, op. cit., p. 13 et suiv. ainsi que de Bernard Cerquiglini, « Tombeau de Nithard », in catalogue de l’exposition L’Europe avant l’Europe-les Carolingiens, Abbaye de Saint-Riquier, 2014, p 86-94.
[5] étienne Dumont, La francophonie par les textes, Vanves, EDICEF, 1992, p. 58-59.
[6] Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, tome 16, 5e édition, 1826, p. 393.
[7] F. Brunot, Histoire de la langue française. Des origines à 1900, tome II, Le Seizième siècle, Paris, Librairie Armand Colin, 2e édition, 1927, p. 30.
[8] H. Peyre, La Royauté et les langues provinciales, Paris, Presses Modernes, 1933 ; P. Cohen, « L’imaginaire d’une langue nationale : l’État, les langues et l’invention du mythe de l’ordonnance de Villers-Cotterêts à l’époque moderne en France », Histoire Épistémologie Langage, 2003, vol. 25, n° 1, Politiques linguistiques 2/2, p. 19-69.