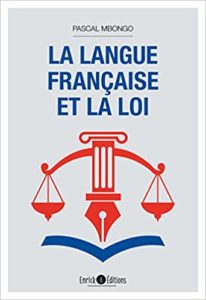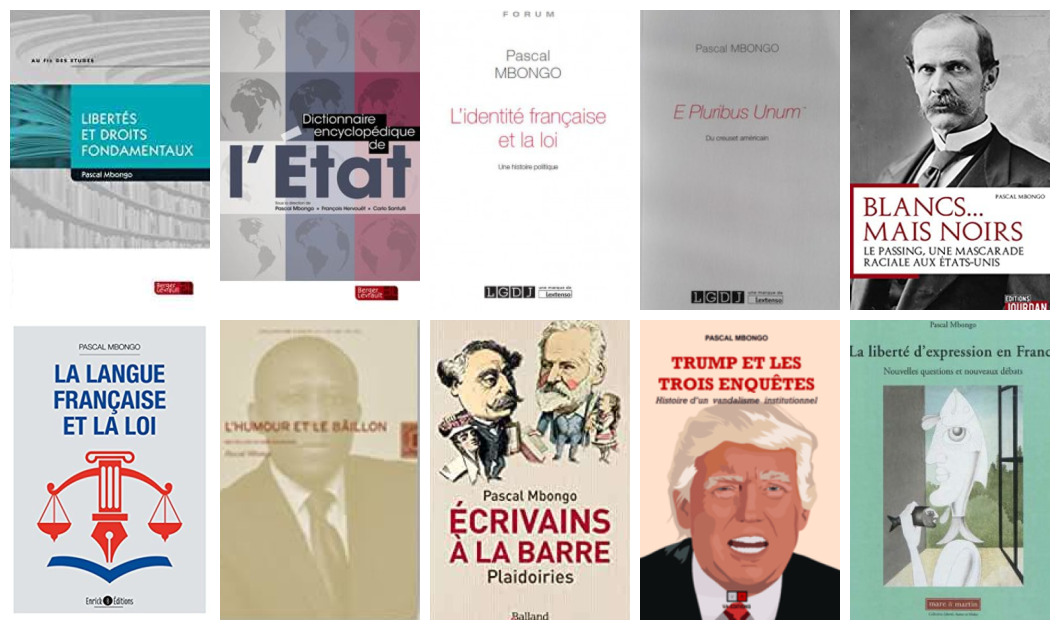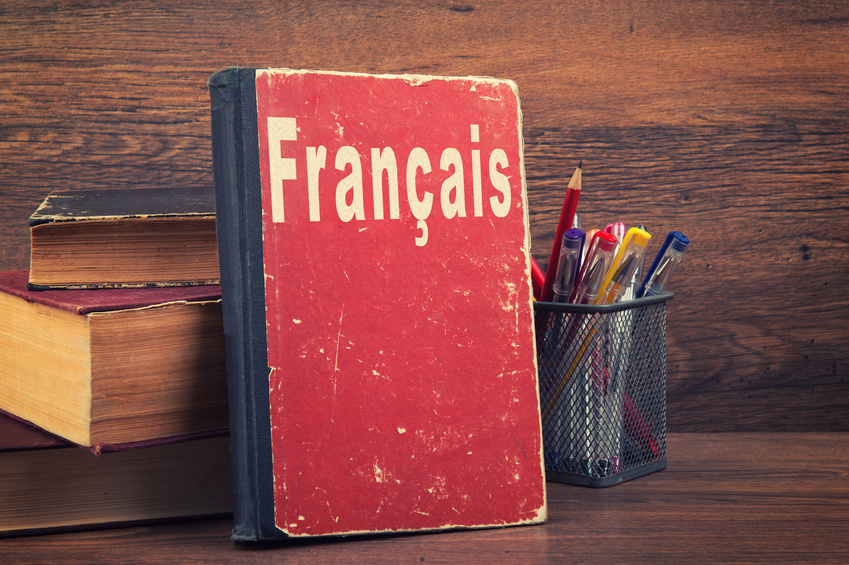Question écrite n° 25427 de M. Paul Molac (Libertés et Territoires – Morbihan ), JO, 24/12/2019, p. 11273.
Paul Molac alerte M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les conséquences désastreuses de la récente réforme du baccalauréat sur l’enseignement des langues régionales. En effet, en plus d’instaurer des épreuves rénovées, la réforme a mis un terme aux séries L, ES, S. Pour rappel, auparavant, au sein de la série L, il était possible de choisir la langue régionale comme LV2, à l’écrit comme à l’oral, avec un coefficient 4 représentant un peu plus de 10 % de la note finale. Ce coefficient était doublé si l’élève choisissait l’enseignement dit approfondi ; et la langue régionale pouvait par ailleurs être choisie comme LV3. Dans les autres séries (ES et S et voie technologique), la langue régionale pouvait être choisie, mais en LV2 seulement, et avec des coefficients nettement moins avantageux. Malheureusement, avec la nouvelle réforme et la fusion des anciennes filières, c’est une harmonisation par le bas qui s’est opérée à l’encontre des langues régionales. La nouvelle réforme conserve la LV2 (désormais appelée LVB), et elle seule, dans le cadre des enseignements communs, sur le mode du contrôle continu, avec un coefficient qui ne représente plus que 6 % de la note finale. Quant à la possibilité de choisir la langue régionale en LV3 (LVC dans la terminologie nouvelle), cette possibilité ne s’inscrit plus dans le cadre des enseignements communs jusqu’ici possibles en série L, mais uniquement comme enseignement optionnel, en concurrence avec quatre autres options. Par ailleurs, dans la voie technologique, cela n’est autorisé que pour une filière qu’est celle l’hôtellerie et restauration. Autre nouveauté : avec la réforme il n’existe plus qu’une option facultative pour les langues et cette seule option possible n’a plus d’attractivité en ce sens qu’elle ne représente que 1 % de la note finale et qu’elle peut même faire perdre des points, ce qui n’était pas le cas précédemment. De plus, comme elles le faisaient depuis deux années, les associations de promotion des langues de France demandent à ce que le coefficient soit aligné sur celui dont bénéficient les langues anciennes (coefficient 3). Cette demande n’a jamais été prise en considération. Pire, dans la réforme proposée, non seulement les langues anciennes conservent leur coefficient, mais elles se trouvent la seule option cumulable avec une autre, laissant complètement pour compte les langues régionales. Pourtant, la Constitution, par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République qui affirme que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », devrait confirmer la volonté institutionnelle d’œuvrer pour la préservation et la valorisation des langues régionales. D’ailleurs, les chiffres le prouvent : avec la réforme du baccalauréat, la baisse des effectifs en langues régionales dans les lycées est brutale. Pour ne prendre que deux exemples : dans l’académie de Toulouse, sept lycées viennent de supprimer les cours d’occitan sur les 42 où il était enseigné avant l’été 2019, ce qui représente une baisse de 16 %. En Bretagne, la chute des effectifs est également saisissante en ce qui concerne l’enseignement optionnel : le nombre d’élèves de seconde est passé de 48 à 29 cette année en lycées publics. C’est pourquoi il demande au Gouvernement de respecter la Constitution, la « loi Peillon » qui stipule que l’enseignement des langues régionales doit être favorisé et les conventions signées par l’État afin de stopper ses politiques « linguicides ». A contrario, il lui demande d’opter en faveur de politiques linguistiques porteuses d’espoir pour l’avenir des langues régionales, et plus précisément visant à assurer leur survie.
Réponse du ministre de l’Education nationale, 24 mars 2020, p. 2359.
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse est attaché à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des régions françaises : la circulaire n° 2017-072 du 12 avril 2017 a ainsi rappelé, d’une part, cet attachement, et d’autre part, le cadre du développement progressif de l’enseignement des langues et cultures régionales. Lors de la concertation pour la réforme du baccalauréat, des responsables des associations des langues régionales, ainsi que des représentants de la Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public, ont été reçus plusieurs fois. Dans le cadre de la réforme du baccalauréat et du lycée, qui entre en vigueur pour les élèves de première à partir de la rentrée 2019 et pour les élèves de terminale à partir de la rentrée 2020, l’enseignement de spécialité » langues, littératures et cultures étrangères et régionales » (LLCER), proposé dans la voie générale, conforme à la dynamique de renforcement de la place des langues régionales, présente la possibilité de choisir une langue vivante régionale à l’instar des langues vivantes étrangères. Le choix d’une langue vivante régionale est effectué par l’élève parmi les langues suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan langue d’oc, tahitien, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2021. Cela est possible dès lors que l’élève suit par ailleurs un enseignement dans cette langue régionale en langue vivante B ou C. La spécialité bénéficie à ce titre d’un enseignement à hauteur de 4 heures hebdomadaire en classe de première, puis de 6 heures en classe de terminale, en plus des heures de l’enseignement commun en langues vivantes. Elle est évaluée dans le baccalauréat pour un coefficient 16 sur un coefficient total de 100. Ceci correspond à un réel progrès par rapport à la situation précédente où la langue vivante régionale approfondie ne pouvait être choisie que par une minorité d’élèves, ceux de la série L. En outre, les programmes spécifiques à l’enseignement de spécialité « langues, littératures et cultures étrangères et régionales » ont été publiés dans l’arrêté du 28 juin 2019 (BOEN du 11 juillet 2019) modifiant l’arrêté du 17 janvier 2019 (BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019) pour la classe de première, et dans l’arrêté du 19 juillet 2019 pour la classe de terminale (BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019), avec un programme spécifique proposé pour chacune des langues régionales précitée. A la rentrée 2019, pour la classe de 1ère, on compte 24 élèves pour LLCER breton, 20 pour LLCER occitan. Par ailleurs, pour le baccalauréat général, il est toujours possible pour le candidat de choisir une langue vivante régionale (LVR), en tant qu’enseignement commun au titre de la langue vivante B, et également en tant qu’enseignement optionnel, au titre de la langue vivante C. En ce qui concerne la voie technologique, dans toutes les séries, le choix d’une langue vivante régionale demeure possible au titre de la langue vivante B dans les enseignements communs. Pour l’enseignement optionnel de la voie technologique, le choix d’une langue vivante régionale est toujours proposé dans la série « sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration » (STHR), en raison de l’intérêt que comporte un tel enseignement pour des élèves se destinant à des carrières où l’accueil du public est primordial. Le rétablissement d’un enseignement optionnel dans toute la voie technologique n’est pas pour l’instant envisagé pour la LVR. En effet, du fait d’horaires déjà élevés en raison d’une pédagogie spécifique, très peu d’élèves choisissent aujourd’hui de suivre un enseignement facultatif. A la rentrée 2019, pour la classe de 1ère, on compte 65 élèves pour LVC breton (102 pour la LVB), 272 pour LVC occitan (45 pour la LVB). Au même moment, pour la classe de seconde GT, on compte en LVB 36 élèves pour l’occitan, 110 élèves pour le breton, et en LVC 396 élèves pour l’occitan, 93 élèves pour le breton. En conséquence, la réforme du baccalauréat conforte le poids des langues régionales dans l’examen. Ainsi, la langue vivante régionale (LVR) choisie au titre de la langue vivante B constitue l’un des six enseignements communs ayant exactement le même poids dans l’examen, c’est-à-dire que tous ces enseignements comptent dans leur ensemble à hauteur de 30 % de la note finale, et en y incluant les notes de bulletin, la note de langue régionale compte pour environ 6 % de la note finale. S’agissant de la LVR choisie au titre d’enseignement optionnel comme langue vivante C, tous les enseignements optionnels ont exactement le même poids et les notes de bulletins de tous les enseignements comptent dans leur ensemble à hauteur de 10 % de la note finale de l’examen. La situation précédant la réforme dans laquelle seules les notes au-dessus de la moyenne étaient prises en compte dans l’examen disparaît. Désormais, il faut suivre les enseignements optionnels en cours de scolarité tout au long du cycle terminal et la note annuelle obtenue au titre des enseignements optionnels compte pour l’examen, quelle que soit sa valeur. La valorisation des LVR peut enfin s’opérer grâce à l’accent mis par la réforme sur l’enseignement des disciplines non linguistiques en langue vivante, notamment régionale. L’arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l’indication discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, publié au JORF du 22 décembre 2018, prévoit ainsi que, hors des sections européennes ou de langue orientale, les disciplines autres que linguistiques (DNL) peuvent être dispensées en partie en langue vivante donc en langue régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées. Par exemple, sur 3 heures d’histoire-géographie, 1 heure peut être dispensée en langue vivante régionale. Dans ce cas, et cela est nouveau, le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l’indication de la discipline non linguistique (DNL) ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante étrangère ou régionale, suivie de la désignation de la langue concernée, si par ailleurs le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu’il a acquis. Enfin, la ressource enseignante en langues vivantes régionales est pérennisée. L’enseignement des langues régionales dans le second degré dispose de professeurs titulaires du CAPES langues régionales (basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d’oc) et du CAPES section tahitien, ainsi que du CAPES section corse. Une agrégation de langues de France a été créée en 2017, cette disposition permettant de recruter des IA-IPR de langues de France. Le suivi de la mise en œuvre de la politique des langues vivantes régionales au niveau académique est assuré par des chargés de mission, au statut divers, dont des enseignants. Toutes ces nouvelles dispositions œuvrent en faveur de la valorisation de l’apprentissage des langues vivantes régionales pour les élèves du lycée général et technologique.