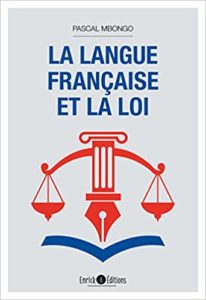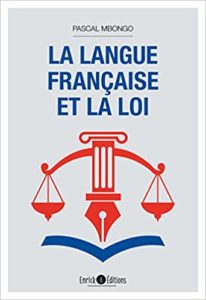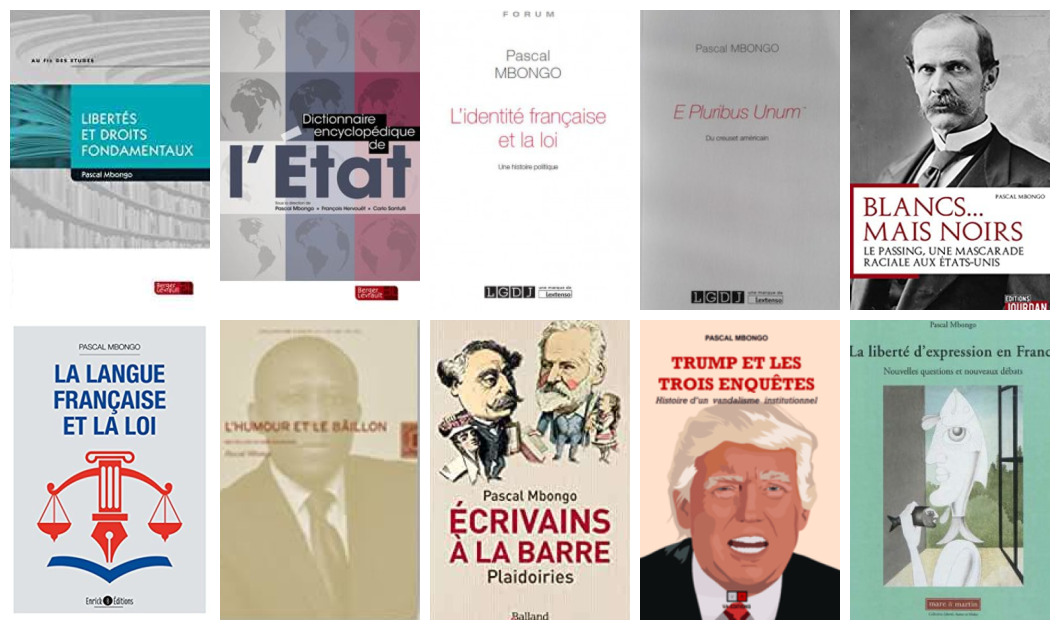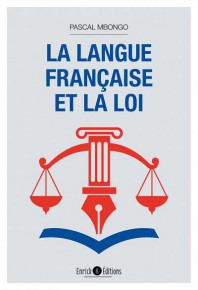Dans la La langue française et la loi, il n’est pas moins question de la Francophonie en tant que grand complexe politico-bureaucratique, et jusque y compris les polémiques contemporaines sur l’adhésion d’Etats tels que… l’Arabie saoudite ou le Qatar. Il n’est pas moins question de la francophonie comme catégorie légalo-administrative en France même, et jusque y compris aux débats sur la question de savoir s’il devrait s’agir d’une dépendance du ministère de la Culture ou plutôt du ministère des Affaires étrangères.
Quant aux Etats-Unis, ils ont partie liée avec l’histoire légale de la langue française à deux titres principaux, déclinés dans l’ouvrage. En premier lieu, leur rôle et leur place dans la guerre de 1914 sont déterminants dans la désignation de la langue anglaise comme langue concurrente du français aux négociations et pour le traité de Versailles . Comme le montrent les archives rapportées dans l’ouvrage, cette équivalence, que l’on a vite fait de prêter à l’américanophile Georges Clemenceau, contraria ou choqua beaucoup, depuis des écrivains jusqu’au président Poincaré, en passant par l’Académie française. Au motif que la langue française était l’unique langue diplomatique depuis, supposément, le traité de Rastatt de 1714 (cette datation de la préséance diplomatique française est néanmoins discutable, pour les raisons exposées dans l’ouvrage). En second lieu, les Etats-Unis sont le repoussoir des discours critiques de l’invasion de la langue anglaise (comme celui de René Étiemble dans son fameux Parlez-vous franglais ? paru en 1964) et des premières propositions d’intervention législative dans les années 1960 en vue de « défendre la langue française ».
En regardant les choses de plus près, l’on voit qu’en réalité l’inquiétude française sur l’avenir international du français naît à la fin du XIXe siècle, et d’abord dans une peur équivalente de la puissance nouvelle de l’Allemagne (certains imaginent alors que l’allemand était voué à dépasser l’anglais, le français ou l’espagnol) et de l’Amérique (c’est son addition à l’Angleterre qui est alors en sous-texte des discours dépréciatifs de la langue anglaise).
Francisque Sarcey, « Le Français à l’étranger », Les Annales politiques et littéraires, 6 mars 1898, p. 146-147.
Vous savez sans doute que Boston passe pour être la ville d’Amérique la plus éprise de littérature et de beaux-arts. La connaissance de notre langue y est, plus que partout ailleurs aux États-Unis, répandue dans la bonne compagnie. Il y a deux ans, quelques amis de la langue française se réunirent et posèrent les bases d’un Cercle qui aurait pour nom : l’« Alliance française ». Ce Cercle fut constitué vers la fin de novembre 1897. Il se compose de cent membres ; et la première condition pour en faire partie est de savoir notre langue. Le Cercle but d’offrir à ses membres un moyen « social » de s’exercer dans cette langue : ils écoutent une conférence faite en français ; par un Français, et se livrent ensuite à une conversation, d’où est exclu tout mot qui n’est pas français. Ils se proposent de vivre la langue.
Je reçois, sur cette institution, une lettre des plus curieuses d’un de nos compatriotes, qui est membre de ce Cercle. Ils ne sont qu’une dizaine de Français sur cent. Les autres sont Américaines.
Après m’avoir parlé du but que les fondateurs du cercle veulent atteindre, il ajoute :
« Nous en avons un autre qui, pour nous, est plus important : oui, sans doute, nous désirons propager le goût de notre langue, mais, ce que nous souhaitons avant tout et d’un cœur bien passionné, c’est de relever dans ce pays-ci le prestige de la France, de faire comprendre et apprécier notre admirable littérature ; de faire aimer ou tout au mois de faire juger plus sainement les mœurs généreuses et les qualités chevalesresques de notre nation.
La tâche n’est pas facile, je vous prie de le croire. Depuis la funeste guerre de 1870, les Allemands ont conquis en Amérique, grâce au prestige de la victoire, grâce aussi à l’effroyable pullulement de la race, une prépondérance, au détriment de la France.
Ah ! c’est qu’aussi tous les Allemands d’Amérique ont pris part à cette lutte contre notre influence. Ils ont travaillé ferme à répandre leur langue ; ils ont fait de leur mieux valoir la prétendue supériorité de la littérature allemande, des mœurs allemandes, tandis que les Français, pauvre et infime minorité, isolés les uns des autres, sans aucune aide de leurs frères de France, s’abandonnaient au découragement, et, jour à jour, battaient en retraite devant l’envahisseur.
Lorsque, il y a douze ans, je vins pour la première fois en Amérique, la langue étrangère qui jouissait alors de la faveur publique était l’allemand ; la littérature en vogue, la littérature allemande ; la musique que l’on portait aux nues, la musique allemande ; et de tout ainsi.
Le français, en revanche, était négligé ; la musique française tombée dans le mépris ; et quant à notre littérature, elle était si bien mise à l’index qu’il est né de cette proscription une locution idiomatique : on appelle tout livre immoral, qu’il soit français ou non, peu importe ! French novel : roman français.
Je vous assure que la tâche a été et qu’elle est encore rude, pour nous autres Français qui luttons toujours. La chose triste à dire, c’est que les plus grands obstacles à notre réussite nous viennent de la France même et des Français. Nous avons à lutter contre l’impression fâcheuse laissée par un nombre malheureusement trop grand de chevaliers d’industrie français qui ne parcourent l’Amérique que pour l’écumer ; contre les répugnances soulevées par cette littérature de sentiments impudiques et de langage malpropre, que, bien des fois, j’ai eu le plaisir de vous voir flétrir dans vos chroniques.
Mais le pire de tout, c’est de voir la haine et la calomnie à l’ordre du jour en France. Comment pouvons-nous faire aimer la France, quand, chaque jour, une partie de la nation accuse l’autre d’être composée de voleurs, de vendus et de fripouilles, et que l’autre répond du même style. Vous n’êtes pas sans savoir quel le mal est toujours cru plus aisément que le bien. Toutes ces ignobles calomnies sont acceptées comme argent comptant.
Qu’arrive-t-il ? C’est que tous les journaux étrangers se plaisent à dénigrer et à vilipender notre pauvre pays. Ils disent de lui qu’il est tombé au dernier degré de l’abjection et de la pourriture. Lisez plutôt l’article que je vous envoie. Il est du correspondant du Boston Herald à Londres. Il est ignoble ; c’est un tissu de mensonges et d’infamies.
Ah ! que j’eusse avec plaisir coupé les oreilles au drôle qui l’a écrit. Mais, au fond, la faute n’en est-elle pas à ces Français de France qui, par intérêt de parti ou même sincèrement, attirent l’attention sur nos scandales. Deux cent mille Américains ont lu cet article ; cent cinquante mille l’ont pris pour l’expression de la vérité.
La création du Cercle de l’Alliance française est le résultat de longs et constants efforts. Quelques amis et moi nous sommes arrivés à éveiller à Boston un vif intérêt pour la langue et la littérature françaises. Le Cercle n’est que pour Boston, il est vrai ; mais au point de vue littéraire, Boston est la principale ville d’Amérique et son influence se fait sentir dans tous les autres États. »
Ainsi me parle un de nos compatriotes, M. Camille Thurwanger, qui est un des membres du Cercle de Boston et qui en est le président pour l’exercice 1897-1898.
D’autres efforts sont faits en Amérique et ceux-là par des Américains, pour propager aux États-Unis le goût de la littérature. Vous avez pu lire dans les feuilles publiques que M. René Doumic va partir, ce mois même, pour aller là-bas faire une série de dix « lectures », — nous disons, nous, de dix conférences sur l’histoire du romantisme. Il y est appelé par le Cercle français de l’Université de Haward [sic]. Ce Cercle existe déjà depuis 1886, et il compte aujourd’hui plus de cent membres, qui parlent le français, comme s’ils étaient nés en Touraine.
Depuis l’année 1891, on joue chaque année, sur le théâtre du Cercle, des pièces empruntées soit au répertoire de Molière, comme les Précieuses ridicules et le Malade imaginaire, soit à celui de Labiche, comme la Poudre aux yeux. Je n’ai pas besoin d’ajouter que les pièces sont interprétées en français. Cette année, on a joué le Médecin malgré lui. L’année dernière, M. Brunetière, au cours de sa tournée de conférences en Amérique, est venu rendre visite à l’Université de Haward [sic], et il a été nommé membre honoraire du Cercle.
Il paraît que le voyage de M. Paul Bourget en Amérique et son livre si curieux, Outre-Mer, ont fait beaucoup pour la propagande en faveur d’échanges intellectuels réguliers entre la France et l’Amérique.
On a songé à créer entre les Universités américaines et les centres littéraires français un lien permanent. Rien ne se fait sans argent.
Par bonheur, le Cercle français de l’Université de Haward [sic] avait pour président M. James Hyde, qui est un des étudiants de cette Université. M. James Hyde est le fils du directeur d’une des plus grandes Compagnies d’assurances américaines, l’Equitable, de New York. Il a offert, cette année, pour ses étrennes, au Cercle français, un capital de 150,000 francs, destiné à permettre l’organisation de conférences publiques annuelles sur la littérature, l’art ou l’histoire de la France ; ces conférences doivent toujours être confiées à un Français.
Ce sont justement ces conférences que M. René Doumic est chargé d’inaugurer.
Plût à Dieu qu’il y eût parmi les fils des directeurs des Compagnies d’assurances américaines ou parmi ceux des grands financiers des États-Unis quelques hommes aussi amoureux de notre art, de notre littérature, aussi épris de la France que le jeune homme à qui nous conserverons dans notre cœur un souvenir reconnaissant.
Et nous, ne ferons-nous rien pour rendre plus faciles et plus étroites ces relations qu’il nous serait si utile d’entretenir avec les États-Unis.
Les Américains et surtout les Américaines se donnent beaucoup de mal pour apprendre notre langue. Apprenons l’anglais.
Adolphe Brisson vous a déjà parlé de cette admirable méthode Berlitz à l’aide de laquelle M. Collonge et ses collaborateurs mettent en quelques mois un Français en état de parler et de comprendre n’importe quelle langue étrangère. J’ai vu, de mes yeux vu, je vois encore chaque jour des résultats étonnants de cette méthode. Ah ! si j’étais moins vieux !
Étienne Lamy (de l’Académie française), « La langue française », Les Annales politiques et littéraires, 13 octobre 1912, p. 319.
M. Etienne Lamy est allé porter au Canada la bonne parole. Il avait choisi le plus beau des sujets : l’éloge de la langue française… Un accueil émouvant a été fait à ce morceau achevé, qui n’est pas seulement un éloquent discours, mais un acte. Nos frères d’outre-mer n’oublieront point ce que leur a dit l’« ambassadeur de l’Académie »… Et ces pensées, et ce langage n’auront pas moins d’écho ici que là-bas.
APRÈS le quinzième siècle, les humanistes, qui renaissaient Grecs et Romains, tentèrent de transformer le français en une langue pédantesque par une invasion de vocables et de tours étrangers, et faillirent ensevelir sa beauté vivante sous les beautés mortes de l’antiquité. Notre sève robuste résista : jamais plus de mouvement, d’originalité, de surabondance ne marque l’influence du génie populaire sur la littérature. Cette fécondité risquait même d’étouffer le goût sous son fouillis luxuriant, lorsque, au seizième siècle, le français devient la langue légale par l’ordonnance de Villers-Cotterêts. La royauté, à ce moment, peut disposer du langage, parce qu’elle est devenue la maîtresse non seulement d’un État, mais d’une société. La royauté continue ce magistère en fondant l’Académie française, c’est-à-dire en confiant à une compagnie d’écrivains la charge de veiller sur cette langue. L’Académie sera un Conseil de révision pour les mots : ceux qu’elle tiendra bons pour le service seront inscrits par elle dans le « dictionnaire de l’usage ». Un des premiers écrivains qui aient exercé cet office, Vaugelas, rappelait le double caractère, de notre langue, quand, il définissait l’usage « la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conformément à la façon d’écrire de la plus saine partie des auteurs du temps ».
Alors, viennent les classiques jardiniers qui, au moment où tout se régularisait dans l’État, tracent dans cette végétation spontanée leurs allées à la française. L’art, à son tour, envahissait trop, la nature. Sous Louis XIV, la Cour a attiré tout ce qui dans la nation s’élève, la France se vide de ses élites pour Versailles, et l’éclat qu’elles projettent sur la couronne semble rayonner de la couronne même. Le monarque paraît n’usurper sur personne quand il dit : « L’État, c’est moi », et choisit pour emblème le soleil. Le péril de cette magnificence solitaire serait que, trop, majestueuse, elle devînt gênante pour les jours ouvrables de la vie et imposât trop silence à la voix du peuple.
Mais, au dix-huitième siècle, le soleil s’abaisse, la joie d’admirer finit, la lassitude d’obéir commence. L’opposition n’a pas de place à Versailles, ville de la Cour, mais se retrouve chez elle à Paris, ville de la Fronde. Bien avant le pouvoir politique, l’influence littéraire a ses journées des 5 et 6 octobre, est ramenée de Versailles à Paris, et ce sont les salons qui donnent la mode à la Cour. A Paris, l’élite de ceux qui parlent et écrivent fixe la langue dans la capitale du peuple par qui et pour qui la langue lest faite. Ces salons prétendraient, à leur tour, devenir les seuls arbitres du langage. Les lettres et la science sont non seulement la gloire, mais la mode de l’époque, et toutes les modes exagèrent. Les grammairiens veulent soumettre « les fantaisies de l’usage » aux raideurs d’une syntaxe toute logique. Les savants renchérissent sur l’exactitude. Pour être précise, la langue se coupe les ailes, s’abstrait, se dessèche. Mais le peuple, qui n’a plus de place, la prend toute par la Révolution. Aux régularités minutieuses du lexique et du laboratoire succèdent les rumeurs puissantes et capricieuses de la place publique.
L’enthousiasme d’un espoir universel rend l’éloquence au verbe anémié dans sa clarté sans chaleur. Puis, comme la félicité publique fuit devant les paroles qui l’appellent, il faut surmener l’espoir pour le soutenir. Dans les tragédies de la liberté et dans les apothéoses de la gloire, l’imagination populaire prend l’habitude du démesuré, oublie le naturel pour une façon de parler et d’écrire pompeuse, théâtrale, et qui, pour atteindre au sublime, touche au ridicule. Tout se répare et se renouvelle au dix-neuvième siècle, par une réaction de réalité. Au milieu d’événements ramenés aux proportions ordinaires, l’homme, las des crédulités aux formules abstraites, se tourne vers ce qui trompe le moins, la nature. Il la regarde en lui et hors de lui ; il explore deux immensités : son cœur et le monde. La langue se dépouille, à la fois, de la maigreur didactique et de l’enflure déclamatoire. Elle ajoute à ses dons anciens une sensibilité experte) à s’analyser et scrupuleuse de se peindre telle qu’elle est, une richesse renouvelée de sensations et d’images, une âpreté de mélancolie et Une profondeur de lyrisme en apparence.
Jamais, donc, n’a manqué à notre langue ni la source toujours jaillissante de l’imagination nationale, ni la digue intellectuelle qui filtre le flot pour en recueillir la pureté. Cette collaboration séculaire de, la multitude et de l’élite, œuvre où chacun travaille pour tous, a fait la langue une et indivisible. Plus absconse et scientifique, plus conforme aux préciosités d’une aristocratie, elle fût descendue malaisément jusqu’aux multitudes et peut-être, scindée en deux dialectes l’un savant, l’autre vulgaire, la parole faite pour unir tous ceux de la race les aurait tenus divisés. Œuvre de tous, expression de l’unité nationale, la langue n’a pas cessé de fortifier en France une âme et un génie communs.
M. Etienne Lamy, s’adressant aux Canadiens, conclut ainsi :
Vous n’avez jamais cessé de garder intactes les mœurs, la foi et la langue que ; vous avez reçues du passé. Ces traditions, seul trésor que vous ayez porté de l’ancienne patrie dans la nouvelle, ont maintenu la sagesse dans votre volonté et l’ordre dans votre action. Vous aviez à accomplir une tâche immense : peupler et cultiver Un continent. Vous la poursuivez en paix sous un pouvoir d’autant plus respecté que vous ne lui demandez pas de remplacer soudain et d’autorité les œuvres de l’effort personnel et du temps.
Vous regardez n’est pas pour nous seulement une joie, mais un exemple. Vous êtes nos frères, mais mieux préservés que nous des expériences où s’égarent les énergies. Tandis que nous parcourions nos destinées comme l’enfant prodigue, vous êtes restés dans la maison paternelle et nous goûtons son charme en y étant reçus par vous. Nous y voyons quelles vertus conservent une race. Vous êtes ce que nous avons été, nous apprenons de vous à redevenir ce que vous êtes. La France, en voulant se faire nouvelle, s’est vieillie. En ne vous détachant pas de vos traditions, vous avez perpétué votre jeunesse. Tandis que, chez nous, les vivants ont parfois semé la mort, vos morts vous ont gardé le secret de la vie. Et notre commun langage est beau dans votre bouche, parce que tout y est sain : les mots et les pensées.
Canada, petite colonie d’hier, nation d’aujourd’hui, empire de demain ; Canada séparé de la France avant que la France se séparât de son passé et qui as gardé la plénitude de notre vie ancienne ; Canada terre de fécondité, fertile en blé, fertile en hommes, fertile en avenir, qui multiplies par un travail solidaire les moissons dans tes plaines et les enfants dans tes foyers et qui, dans les solitudes immenses où se perdaient tes. premiers explorateurs, verras un jour ta race à l’étroit ; Canada, terre de constance qui as affermi la sagesse de tes mœurs et de tes lois sur ta foi catholique et tiens pour ta plus précieuse liberté d’être soumis à un maître surhumain ; Canada qui as trouvé dans la fidélité la récompense et offres au monde le modèle d’une société où les vertus privées et les vertus publiques rendent hommage à Dieu ; Canada, la France t’aime, t’admire et te salue.
Henry Gaillard de Champris, Professeur à l’Université Laval, Québec, Canada. Du « Canadian French » – 25 janvier 1925.
« Avec quelle fidélité, intelligente et pieuse, les Canadiens conservent les traditions françaises, un petit livre nous en apporte une nouvelle preuve, et bien touchante.
Le titre en est modeste : Zigzags autour de nos Parlers ; le sous-titre, plus modeste encore : Simples Notes. En réalité, c’est un recueil singulièrement précieux.
Dans les milieux anglais ou anglicisants des Etats-Unis et même du Canada, on affecte volontiers quelque dédain pour le français des Canadiens. Ce n’est pas, décident ces superbes, du Parisian French, c’est du Canadian French. Vous voyez la différence et la moue qui la rend sensible.
D’autre part, des puristes — notre auteur dit poliment des surpuristes — suspectent volontiers d’origine anglaise tel mot, telle locution peu familiers à leur oreille délicate.
Contre ce mépris et contre cet ostracisme, M. L.-P. Geoffrion, secrétaire de la Société du Parler Français de Québec, a entrepris une lutte tranquille, mais persévérante.
Fort de l’expérience personnelle qu’il doit à ses origines paysannes, instruit, par l’étude prolongée, méthodique et passionnée de tous les dictionnaires, lexiques et glossaires, de toutes les grammaires, de tous les traités, de tous les précis, de tous les essais, qui depuis trois siècles ont été consacrés au français moderne, au français ancien, aux dialectes, aux provincialismes, aux patois, riche d’innombrables lectures, M. Geoffrion restitue aux mots, aux expressions jugés bâtards ou barbares leur véritable état civil et, du coup, leur dignité.
Si, vous promenant dans les rues de Québec, vous voyez à la devanture d’un commerçant l’annonce alléchante d’un gros « bargain », vous vous indignerez ou vous vous attristerez, suivant votre humeur, de cet anglicisme provocant. — Voire ! dira M. Geoffrion, avec son œil malicieux et son petit sourire de côté.
Et il vous expliquera que, comme tant d’autres, l’anglicisme bargain n’est qu’un gallicisme démarqué. Comme le verbe « barguigner » veut dire « marchander », les vieux substantifs français « bargain, bargaine » désignaient un marché avantageux, une bonne affaire, une occasion. On comprend que ces mots aient plu à nos amis les Anglais, bons commerçants. Mais n’ayons pas l’air de leur emprunter, une fois de plus, ce que nous leur avons d’abord donné.
Et ne nous scandalisons pas si, dans les familles les plus pieuses, les plus patriarcales de la campagne canadienne, le fils le plus respectueux se félicite d’avoir, le 1er janvier, reçu a le torchon paternel ». Il veut dire la bénédiction paternelle, et il le dit sans irrévérence aucune.
— Pourtant, direz-vous…
Oui, pourtant. Ou, plutôt, en effet.
Torchon a, dans le parler populaire, un synonyme : guipon. Or, guipon, c’est goupillon. Le goupillon, c’est, à l’église, l’instrument de la bénédiction. Par une métonymie fréquente, le nom de l’instrument a désigné l’action elle-même : goupillon a signifié bénédiction ; ce sens est passé à son équivalent : guipon et de celui-ci à son synonyme : torchon.
À vrai dire, M. Geoffrion, modeste et probe, ne propose là qu’une hypothèse.
Mais n’est-elle pas aussi vraisemblable qu’ingénieuse ?
En tout cas, elle révèle la méthode de M. Geoffrion. Si celui-ci n’ignore rien de la science des mots, il connaît encore mieux leur vie. Et non seulement il sait comment ils évoluent dans leur prononciation (pione pour pivoine), leur orthographe (avouene pour avoine) et leur sens, mais il sait quels rapports étroits les unissent, et dans il eut origine et dans leurs transformations, à la vie des hommes. Cet historien des mots est un historien des coutumes et des mœurs. D’où des croquis, esquisses et tableautins qui ressuscitent pour nous la vie de nos ancêtres et de ceux qui les perpétuent ici.
Lisez, par exemple, le joli développement sur les mots biger, bicher, et sur les exigences angevines en matière de bise (pages 60-61).
Le livre savant de M. Geoffrion est donc plein d’agrément.
Spirituel comme pas un, l’auteur décoche à ses adversaires de petits traits nonchalants et cruels. À ceux qui trouvent malséant qu’un juge « monte sur le banc », il réplique qu’un roi monte bien sur le trône. Ou bien, à propos du mot gosser, il explique joliment que si les écoliers se contentent de gosser (taillader) les tables, les jeunes gens aiment mieux gosser les filles (se gausser d’elles), et que dans les ménages un peu somnolents on ne peut plus que gosser des copeaux pour raviver le feu.
Sensible à la beauté d’un paysage, il cite, à propos de « clair d’étoiles », une page délicieuse du juge Adjutor Rivard, maître conteur.
Gourmet, il se délecte de cette locution trois fois savoureuse : « Graisser une beurrée avec des confitures. » Discutant du mot beigne, pris pour beignet, il apporte une recette digne de Vatel, et il nous apprend en quoi un croquignole canadien diffère d’une croquignole française.
Grammaire et poésie, grammaire et friandise. La formule n’est-elle pas nouvelle et jolie ?
Mais à insister sur le charme du livre, je risque d’en affaiblir le caractère principal, qui est d’un livre de science. La compétence me manque pour l’apprécier comme tel. Mais je crois pouvoir être tranquille sur le jugement des spécialistes. Un profane ne pouvait que proposer aux profanes un plaisir délicat un français du Canada ne pouvait que signaler ce que ce petit livre canadien révèle d’amour intelligent pour la langue française. »
(*) Jacques Steinberg, « Speaking Frankly ; Parlez-vous français ? But Why Bother ? », The New York Times, 27 décembre 1998.