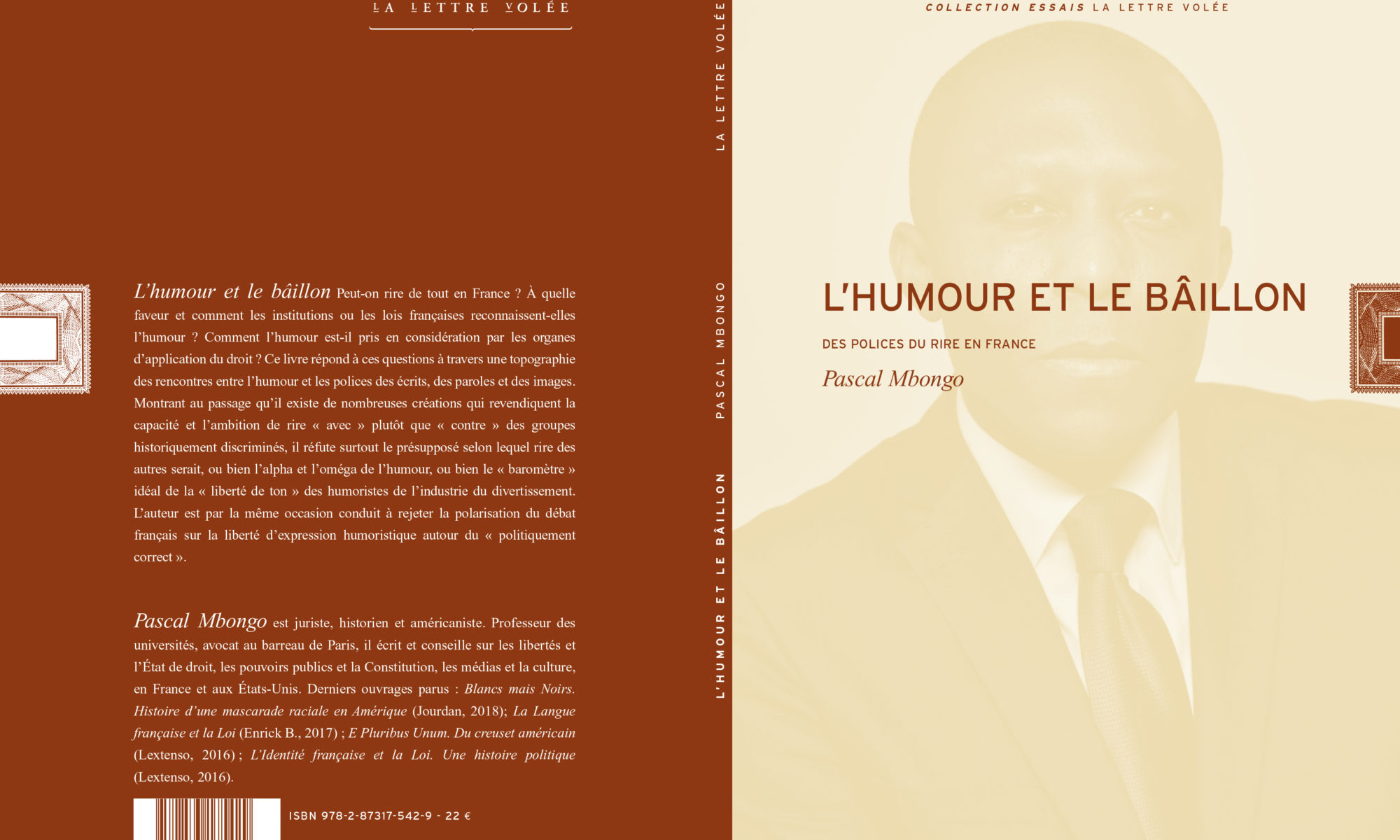Une historiographie courante des médias en France tend à ramener l’histoire juridico-politique du journalisme à l’histoire juridico-politique de la presse[1] et donc à considérer les grands moments de la réglementation de la presse, que ces moments aillent dans le sens du libéralisme ou qu’ils aient consisté en un refus du libéralisme, comme autant de moments de réglementation du journalisme. Cette assimilation a pour elle la définition usuelle du journaliste comme étant « celui qui fait, publie un journal » – définition au regard de laquelle il apparaît que « Th. Renaudot fut le premier journaliste français » – ou toute « personne qui collabore à la rédaction d’un journal » (Petit Robert).
Cette assimilation se heurte néanmoins en droit à un fait : pour avoir toujours été très présente dans le débat politique, la notion de journaliste n’est pas vraiment une catégorie légale en France avant le vingtième siècle, c’est-à-dire avant la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes (« loi Brachard ») ; d’où son absence des tables des recueils de législation et de jurisprudence du XVIIIème siècle et du XIXème siècle (en l’occurrence le Recueil Duvergier), d’où son absence de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse[2].
C’est donc dans le contexte d’une réflexion et d’une action intéressant les conditions de travail et de vie des journalistes, autrement dit par le prisme de la question sociale[3], qu’intervient la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes. La question d’une définition légale du journalisme se pose ainsi dans un contexte de renouvellement des supports et de professionnalisation des pratiques : s’agissant des supports, si la presse écrite existe alors depuis près de trois siècles, la radio pour sa part est en plein essor, et la télévision en est à ses débuts ; quant à la professionnalisation des pratiques, elle est témoignée par une forte intégration bureaucratique des entreprises (hiérarchisation des fonctions et spécialisation des tâches), par l’apparition des premières organisations professionnelles et syndicales (la naissance du Syndicat national des journalistes date de 1918), par la promotion des premiers codes de déontologie (la première « charte des devoirs professionnels des journalistes français » date de 1918), des premières écoles professionnelles (l’École de Journalisme de Dick May date de 1899).
La loi Brachard consacre donc explicitement et formellement le « journaliste » ou, plus exactement, le « journaliste professionnel »[4] en ces termes :
« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France, ou dans une agence française d’informations, et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel, s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité, et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. »
Définissant ainsi le journalisme pour la première fois, le législateur crée en même temps la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP), chargée de délivrer la « carte de presse » aux « journalistes professionnels » tels que définis par la loi. Par suite de la loi, les relations entre journalistes et employeurs furent codifiées en 1937 par l’adoption de la Convention collective nationale des journalistes[5].
L’invention législative de 1935 est remarquable par sa stabilité. Si elle a été amendée par les lois du 13 décembre 1956, du 2 janvier 1973 ainsi que par la loi du 4 juillet 1974 (« loi Cressard ») qui a fait bénéficier aux « pigistes » les droits accordés aux « journalistes professionnels », les éléments-clés de labellisation du « journaliste professionnel » qu’elle a posée n’ont jamais été remis en cause : une pratique du journalisme en tant que savoir-faire spécifique ; l’exercice pour le compte d’une structure entrepreunariale (éditeur d’une publication, agence de presse, etc.) ; une pratique gratifiée d’une rétribution significative (critère des ressources procurée). Au demeurant, les dispositions afférentes de l’ancien code du travail ont été reprises à l’identique dans le nouveau code du travail, la définition du « journaliste professionnel » en particulier basculant telle quelle de l’article 761-2 de l’ancien code aux articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du nouveau code du travail[6].
Cette stabilité est d’autant plus remarquable que le système de la loi Brachard, d’une part, dédouble la compétence juridictionnelle en matière de labellisation journalistique et, d’autre part, induit une herméneutique délicate du critère reconnaissance des « journalistes professionnels » tenant à la pratique d’un savoir-faire spécifique.
I. Le dualisme juridictionnel en matière de labellisation journalistique
La multiplication récente d’occurrences de la notion de « journaliste » dans le droit français prête souvent à un contresens dans les articles de presse ou dans la doctrine juridique lorsqu’il est dit qu’il s’agit d’autant de « définitions » des journalistes ou que telle loi a « réglé » le problème de la définition du journaliste en droit français. Ce contresens découle de la confusion entre les contextes normatifs et procéduraux labellisants du « journaliste professionnel » de ceux qui ne le sont pas.
A. La répartition du contentieux de la reconnaissance entre la juridiction administration et la juridiction judiciaire
La définition légale du « journaliste professionnel » se prête à deux types de contentieux : le contentieux devant les juridictions judiciaires de la violation par l’employeur des droits sociaux attachés à la qualité de « journaliste professionnel » ; le contentieux devant le Conseil d’État des décisions de la Commission de la Carte d’identité des journalistes professionnels[7], autrement dit le contentieux des décisions négatives de l’autorité administrative[8] et compétente depuis pour délivrer la « carte de presse » – la carte professionnelle du « journaliste professionnel »[9].
Ce « dualisme juridictionnel » ne pose pas de problèmes pour deux raisons : d’une part la possession ou la non-possession de la « carte de presse » délivrée par la Commission compétente est indifférente aux juridictions judiciaires (en leurs formations sociales) lorsqu’elles statuent sur les droits sociaux des « journalistes professionnels » au sens de la loi[10] ou, plus exactement, la circonstance que l’on ne soit pas titulaire de la « carte de presse » ne fait pas nécessairement conclure les juridictions judiciaires à l’inapplicabilité des droits sociaux dévolus aux « journalistes professionnels » par le code du travail ; d’autre part, dans l’exercice de leurs compétences respectives, le Conseil d’État et les juridictions judiciaires ont des interprétations assez concordantes des critères légaux.
De fait le contentieux de la « carte de presse » devant le Conseil d’État est particulièrement faible (à peine une vingtaine d’arrêts du Conseil d’État répertoriés depuis le début des années 1980) rapporté à la progression significative des demandes[11]. Certains professionnels voudront considérer que l’explication de la faiblesse de ce contentieux est liée au libéralisme de la Commission[12]. Plus sûrement, cette faiblesse doit à la subsomption durable dans le champ d’application de la loi des collaborateurs directs de la rédaction, des rédacteurs-traducteurs, des sténographes-rédacteurs, des rédacteurs-réviseurs, des reporters-dessinateurs, des reporters-photographes. Et l’incorporation des « pigistes » en 1974 dans le champ d’application de la définition légale n’a pas moins fait disparaître une source traditionnelle de contentieux. Il en va de même de l’incorporation dans le champ d’application de la loi de journalistes salariés des entreprises de communication audiovisuelle au sens de la loi du 29 juillet 1982, celle des « entreprises de production » – soit les « entreprises audiovisuelles ayant pour activité la création d’œuvres audiovisuelles destinées à être diffusées dans le public même lorsque les entreprises en question ne diffusent pas directement les œuvres qu’elles produisent »[13] – celle encore des « journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique »[14].
Une autre explication rationnelle de la faiblesse de ce contentieux tient à l’existence d’un certain nombre d’incompatibilités légales avec la qualité de « journaliste professionnel », soit l’incompatibilité qui frappe les publicitaires, les chargés de relations publiques et les attachés de presse[15], les agents publics (fonctionnaires ou contractuels)[16]. Enfin, le maillage du territoire par de nombreuses écoles professionnelles « dispensant un cursus de formation reconnu par la Convention Collective Nationale des Journalistes » (une quinzaine aujourd’hui), en installant une sorte de présomption d’aptitude en faveur de nombre d’entrants dans la profession (en tout cas parmi les plus jeunes générations de journalistes), a lui aussi facilité le travail d’adoubement de la Commission.
B. Les contextes procéduraux non-labellisants
Ce sont deux occurrences récentes de la notion de « journaliste » dans le droit français – le droit de la propriété intellectuelle et le contentieux de l’exploitation des œuvres des journalistes d’une part, la procédure pénale et la protection de sources des journalistes d’autre part – dont il faut dire pourquoi elles sont « accessoires » par rapport au point fixe définitionnel que représentent les dispositions de la loi Brachard.
1. Le contentieux de l’exploitation des œuvres des journalistes
L’article 20 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (« loi Hadopi ») introduit en effet dans le code de la propriété intellectuelle une section 6 relative au « droit d’exploitation des œuvres des journalistes » (articles L. 132-35 à L. 132-45 du code la propriété intellectuelle) qui s’est proposée de résoudre un conflit durable entre les journalistes salariés pour l’essentiel [lesquels, lorsque leurs articles ont les propriétés d’une « œuvre originale » prétendant à la protection du droit d’auteur, voudraient voir rémunérées leurs réutilisations] et leurs employeurs [lesquels, en tant qu’ils sont propriétaires ou gérants d’une « œuvre collective » au sens du code de la propriété intellectuelle qu’est une publication, voulaient aller au-delà des dérogations que cette qualité d’« œuvre collective » autorisait déjà pour l’étendre aux réutilisations des articles de leurs journalistes].
C’est donc nécessairement à des « journalistes professionnels » au sens du code du travail que la loi du 12 juin 2009 s’intéresse (d’où la référence qu’elle fait au code du travail) mais pas à tous « les journalistes professionnels » puisque, précisément, c’est en fonction de la nature du lien contractuel entre le « journaliste professionnel » et l’employeur, de la nature même de l’employeur (éditeurs de presse et de services de communication en ligne), de l’importance économique que représente pour le « journaliste professionnel » ses productions, de la nature des réutilisations du travail journalistique, qu’est définie par la loi la rémunération spécifique sous forme de droits d’auteur ou de salaires de ces réutilisations[17].
2. Le contentieux du secret des sources
Il n’y a pas davantage de confusion ou de substitution dans la définition légale du « journaliste professionnel » du fait de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes[18]. C’est un contre-sens juridique que de prétendre que cette loi ferait désormais coexister en France plusieurs catégories de journalistes. La loi du 4 janvier 2010 est moins intéressée à définir le « journalisme » ou le « journaliste » qu’à caractériser (au-delà des journalistes professionnels » au sens du code du travail) le champ d’application des protections qu’elle organise : les « journalistes professionnels » proprement dits ; les directeurs de la publication ; toute personne qui concourt directement au recueil d’informations et à leur diffusion au public, et ce quelques soient les ressources qu’elle en tire et qu’il s’agisse ou non de son activité principale[19]. Ici aussi, la définition légale du « journaliste professionnel » reste un invariant à partir duquel le législateur part pour concevoir une garantie effective de la liberté journalistique qui tienne compte par ailleurs du caractère d’« œuvre collective » de l’offre éditoriale d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle[20] ou d’une entreprise de communication au public par voie électronique[21].
II. Le journalisme comme savoir faire intellectuel spécifique
Sans prétendre vouloir donner à son énoncé les caractères d’une théorie générale, le Conseil d’État a pu soutenir que « peut seule être regardée comme un journaliste, au sens et pour l’application des articles 761-1 et suivants du code du travail et, en particulier, pour la délivrance de la carte d’identité professionnelle instituée par l’article L. 761-15, la personne qui, soit par la rédaction d’articles d’actualité générale ou sur des sujets spécialisés et, notamment, professionnels, soit par la conception, la réalisation ou la présentation d’émissions d’information, apporte une contribution intellectuelle ou de création à l’entreprise à laquelle elle apporte son concours »[22]. Plus fondamentalement, le juge dit pouvoir autonomiser un savoir-faire journalistique et substantialiser « l’actualité » dont les journalistes sont supposés rendre compte.
A. La doctrine juridique du savoir-faire journalistique
Le savoir-faire auquel les organes juridiques (la Commission, le Conseil d’État, les juridictions judiciaires) d’application de la « loi Brachard » se réfèrent est (évidemment) extérieur à toute considération déontologique ou éthique ou de police des discours journalistiques (injures, diffamations, offenses, atteinte à la vie privée, atteinte à la présomption d’innocence). Ce savoir-faire renvoie plutôt à une tentative de substantialisation et d’objectivation de l’exercice journalistique.
Dans un cas où il s’était agi de dire si les contributions d’historiens professionnels à une publication de presse leur permettaient de prétendre au label de « journaliste professionnel », le Conseil d’État a répondu qu’il fallait tenir compte de la manière dont les thèmes abordés par ces historiens sont « traités dans les publications en cause »[23]. Le Conseil d’État suggère ainsi qu’il existe des méthodes spécifiques du journalisme distinctes, par exemple de celles des historiens, autrement dit un savoir-faire proprement journalistique. Si cette distinction faite par le juge dit quelque chose du développement d’écoles de journalisme vouées à la transmission de techniques professionnelles[24], la portée générale que lui donne le Conseil d’État – la distinction du « journalisme » au sein des « travailleurs du savoir » utilisant la plume (ou le verbe) – est néanmoins discutable pour des raisons qui tiennent : pour une part aux champs réputés voisins du journalisme parmi les professions intellectuelles qui ont en commun avec lui de pratiquer l’écriture (les sciences humaines et sociales en général et l’Histoire en particulier, les écrivains) ; pour une autre part au champ journalistique lui-même.
D’un côté, cette distinction fait abstraction de ce qu’il existe des pratiques discursives dans les sciences humaines et sociales (spécialement parmi les sociologues et parmi les historiens en particulier) que certains autres spécialistes de ces savoirs considèrent pour leur part comme relevant du « journalisme », soit parce que les objets au centre de ces pratiques discursives sont considérés par eux comme n’étant pas des objets pertinents[25], soit parce que ces pratiques ne satisferaient pas aux « canons » ou à certaines exigences méthodologiques[26]. A quoi il faut d’ailleurs ajouter la réduction pure et simple de la connaissance historique à un genre littéraire et narratif parmi d’autres (une réduction pratiquée notamment par les tenants du Linguistic Turn en histoire). Quant à la distinction suggérée par le Conseil d’État entre un savoir faire journalistique et un savoir faire littéraire, elle peut être hypothéquée par : l’existence de productions journalistiques parvenues à la dignité littéraire[27] ; l’existence – plus fréquente il est vrai – de productions en matière de roman ou de récit dont le label littéraire est contesté au profit d’un label journalistique ; l’originalité statutaire au sein du journalisme du journalisme économique, et plus encore, du journalisme scientifique[28] ; l’antériorité dans le journalisme du Storytelling[29] et la prospérité du New Journalism, du Literary Journalism ou du Narrative Journalism.
D’un autre côté, l’appréhension holiste du savoir-faire des journalistes qui est derrière la distinction entre ce savoir-faire et celui de certains autres « travailleurs du savoir » fait abstraction de l’extrême diversification et division des tâches à l’intérieur de la profession[30] et de ce qu’il existe des pratiques discursives en matière de journalisme (que celles-ci soient le fait de journalistes diplômés d’écoles professionnelles ou non) que certains journalistes pour leur part peuvent considérer comme ne relevant pas « vraiment » du « journalisme » (l’éditorial, la tribune, le journalisme « people », et même le Gonzo Journalism[31]).
B. L’« actualité » comme standard qualifiant
Être « journaliste professionnel » au sens de la loi française suppose donc également d’avoir comme matériau « l’actualité ». C’est ainsi, par exemple, qu’un dessinateur illustrant de manière pertinente un « fait d’actualité » pourra être qualifié de journaliste au sens de la loi, mais pas l’illustrateur en bandes dessinées d’œuvres de fiction[32].
En 1996, le Conseil d’État a par ailleurs conclu à la légalité du refus de la « carte de presse » à un demandeur qui excipait de ses fonctions de responsable de la rédaction dans une publication périodique éditée par une société exploitant une chaîne de télévision et destinée d’une part à faire connaître à la presse les programmes de cette chaîne, d’autre part à être diffusée à l’intérieur des services de la société[33]. En substance le Conseil d’État aura considéré qu’un travail rédactionnel de type promotionnel ne peut prétendre au label d’activité de « journaliste professionnel » au sens de la loi[34]. L’arrêt Mme Eyraud de 1997 ne mérite pas moins d’être cité puisque le Conseil d’État y a fait valoir qu’une personne employée en qualité d’illustrateur par une revue pouvait se voir reconnaître la qualité de reporter-dessinateur et donc de « journaliste professionnel » au sens de la loi si les illustrations qui lui sont confiées présentent « un caractère suffisant de rapport avec l’actualité »[35].
Cette mobilisation du concept « d’actualité » ou de « fait d’actualité » est remarquable par son décalage avec la référence anglo-américaine aux « news » ; elle suggère au fond un évitement de la notion d’« information » bien que celle-ci soit plus convenue dans les textes juridiques portant définition de la liberté de la presse, des privilèges statutaires et des immunités afférentes. Cette préférence des organes juridiques pour le critère tiré de « l’actualité » plutôt que celui tiré de « l’information » n’est pas innocente puisque dans le premier cas l’on est en présence d’une notion relativement neutre renvoyant à tout fait ayant un caractère d’immédiateté, (que son objet soit politique, économique, sportif, sociétal, culturel, religieux, un fait divers et qu’il puisse prétendre ou non à la qualification d’« événement ») alors que dans le second l’on est en présence d’une notion ayant une forte charge axiologique et symbolique parce que renvoyant à la recherche de la vérité, à la recherche du progrès humain, à l’éthique de la démocratie. De fait, le critère tiré du traitement de « l’actualité » permet d’inclure dans le « journalisme professionnel », par exemple, le traitement de la vie privée des célébrités et autres personnes publiques (« presse people », « presse mondaine », « presse à scandale », « presse de caniveau ») sans formaliser ou expliciter juridiquement le privilège symbolique et/ou moral attaché en France comme ailleurs à certains objets journalistiques et spécialement à la « politique ».
*
Tout porte ainsi à penser que la définition légale du « journaliste professionnel » posée en France depuis 1935 a encore de beaux jours devant elle, ce pour deux raisons au moins. D’un côté, cette définition a pour elle sa force d’absorption dans l’État social de tous les « auteurs » des médias traitant de « l’actualité », soumis à un lien de subordination par rapport à un employeur et vivant plus ou moins de leur écriture[36], ce qui est tout sauf le cas, par exemple, des blogueurs ou de ceux des journalistes qui choisissent le statut d’« auto-entrepreneur » [37]. De l’autre côté, cette définition n’est pas incommodante : ni pour les entreprises légales de définition de facilités financières, administratives ou fiscales (aides publiques à la presse et aux services d’information en ligne) ; ni pour les entreprises légales de définition de privilèges ou d’immunités (secret des sources[38]) ; ni pour les polices légales du discours, puisqu’il n’y a pas en droit français (ni ailleurs) d’exception journalistique ou d’excuse journalistique à l’intérieur des sanctions des abus de la liberté d’expression[39].
La définition légale du « journaliste professionnel » codifiée au code du travail n’est pas non plus incommodante pour une éventuelle entreprise de définition d’une police professionnelle. La véritable difficulté juridique inhérente à la création d’un « code de déontologie »[40] et d’un organe d’autorégulation n’est pas tant de concevoir leur champ d’application ou de compétence ratione personae, soit une question qui a exagérément occupé le débat français en raison d’une comparaison avec la situation de ceux des ordres professionnels attachés aux professions dont l’accès est absolument conditionné par la détention d’un diplôme spécifique (architectes, avocats, médecins, experts-comptables). Or ce rapprochement est tout sauf utile : d’abord parce qu’une instance d’autorégulation peut exister en dehors des professions dont l’accès est conditionné par la détention d’un titre spécifique[41]; surtout parce que si, comme prévu, l’on adosse le code de déontologie des journalistes à une convention collective des journalistes qui elle-même renvoie à la définition du « journaliste professionnel » donnée par le code du travail, la question du champ d’application ratione personae de ce nouveau texte serait nécessairement, mais implicitement, tranchée. Le véritable défi juridique dans l’entreprise contemporaine de définition d’une police professionnelle est donc ailleurs. Il est plutôt dans la substantialisation de la faute déontologique et dans l’articulation entre le déontologique dévolu à la commission envisagée, le pouvoir disciplinaire propre à l’employeur du « journaliste professionnel » (pouvoir exercé sous le contrôle du juge du travail), le pouvoir répressif dévolu au juge civil et au juge pénal en cas de disfonctionnements sanctionnés par la loi civile et/ou pénale[42].
[1] Voy. notamment : Pierre Albert, La presse française, Paris, La documentation française, coll. « Les études », 2008 ; Ch. Delporte, Les journalistes en France, 1880-1950. Naissance et construction d’une profession, Paris, Seuil, 1999 ; Géraldine Muhlmann, Une histoire politique du journalisme (XIXème-XXème siècle), Paris, PUF, 2004 (réédition : Points, 2007) ; Michel Mathien, Les journalistes. Histoire, pratique et enjeux, Paris, Ellipses, 2007.
[2] Cette inexistence légale (formelle), le rapporteur de la proposition de loi relative au statut professionnel des journalistes dont est née la loi du 29 mars 1935 en convenait d’ailleurs. Voy. le Rapport fait au nom de la commission du travail chargée d’examiner la proposition de loi de M. Henri Guernut et plusieurs de ses collègues relative au statut professionnel des journalistes, par M. Brachard, député : document parlementaire n° 4516, Chambre des députés, quinzième législature, session de 1935, Annexe au procès-verbal de la séance du 22 janvier 1935.
[3] Voy. à ce propos : Christian Delporte, op. cit. ; Patrick Éveno, Histoire de la protection sociale de la presse, Paris, Jacob-Duvernets Éditions, 2009. Il est d’ailleurs remarquable qu’à la Chambre des députés, ce soit la commission du travail qui ait été chargée d’examiner le texte dont est issu la loi du 29 mars 1935.
[4] Les dispositions de la loi Brachard avaient substantialisé une section spéciale III intitulée « Des journalistes professionnels » que ledit texte a ajouté au chapitre 2 du livre Ier (titre II) du Code du travail de l’époque.
[5] Convention adoptée le 23 novembre 1937. En l’état c’est la convention collective nationale des journalistes datée du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté ministériel le 2 février 1988 qui est applicable.
[6] La circonstance que la convention collective nationale des journalistes se contente de renvoyer à la loi s’agissant de son propre champ d’application n’a guère d’importance en droit puisque cette convention ne peut pas, en tout état de cause, être en deça de la loi.
[7] Créée par la loi du 29 mars 1935, la Commission de la Carte d’identité des journalistes professionnels statue d’abord en « Commission de première instance » puis en « Commission supérieure ».
[8] On notera que le Conseil d’État a jugé que la Commission supérieure, lorsqu’elle statue sur les refus de carte d’identité de journaliste professionnel, ne prend pas de décision de caractère juridictionnel (Conseil d’État, 10 juin 1994, Duriez-Costes, tables, p. 1094). La Commission est donc une autorité administrative qui n’est cependant guère citée dans les répertoires des « autorités administratives indépendantes ».
[9] On lira avec intérêt l’article en ligne de Denis Ruellan, « Expansion ou dilution du journalisme » ? (Source : http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2005/Ruellan/index.php).
[10] Cour de cassation, chambre sociale, 1er avril 1992, Bull. civ. V, n° 221 ; D. 1992. IR. 157 ; CSB 1992. 137, A 25. Il convient néanmoins de noter que l’article 6 de la convention collective des journalistes fait de la « carte de presse » un élément de la sécurité juridique des « journalistes professionnels » en disposant qu’« aucune entreprise visée par la présente convention ne pourra employer pendant plus de trois mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle de l’année en cours ou pour lesquels cette carte n’aurait pas été demandée ». C’est la même exigence de sécurité juridique qui fait par exemple démarrer à la première délivrance de la carte le délai d’ancienneté nécessaire au calcul de certaines primes (articles 23 et 24 de la Convention collective). La « carte de presse » emporte également d’autres avantages et facilités (réductions fiscales, gratuité de certains lieux et manifestations culturels, etc.).
[11] http://www.ccijp.net/article-33-cartes-attribuees.html
[12] Il est vrai que des polémiques, assez circonscrites au demeurant, ont pu agrémenter telle ou telle dévolution de la carte à une personnalité non diplômée d’une École de journalisme.
[13] Conseil d’État, 5 avril 2002, RJS 2002. 683, n° 909.
[14] Article L. 7111-5 du code du travail. Cette précision législative annihile un malentendu. En effet, de ce que le Conseil d’État avait validé une décision de refus de la carte de la presse par la CCIJP à des rédacteurs sur Internet, on a pu se poser la question : « les rédacteurs de sites internet peuvent-ils bénéficier de la carte de presse ? » (Frédéric Rolin, note sous Conseil d’État, 6ème et première sections réunies, 26 juillet 2007, M A, Légipresse, 1er janvier 2008, n° 248, p. 14 -16. Or le problème n’était pas qu’il s’agisse de rédacteurs de sites internet mais d’un site internet créé par un établissement public, la Cité des sciences et de l’industrie, en vue de la valorisation de ses expositions. C’est donc le fait que le rôle et l’activité du site en question « se confondent avec ceux de l’établissement public », qui a été déterminant et non la circonstance qu’il s’agisse « en soi », si l’on ose dire, d’un site internet.
[15] Article 3 de l’arrêté du 23 octobre 1964 portant définition des professions de conseiller en relations publiques et d’attaché de presse (Journal officiel, 1e novembre 1964, p. 9801).
[16] Conseil d’État, 30 mai 1986, Mme Moglia, p. 155. Le Conseil d’État a jugé qu’un agent public contractuel de la ville de Lyon, affecté à temps plein à des tâches de journaliste au sein de publications municipales, n’a pas pour autant la qualité de « journaliste professionnel » au sens de la loi.
[17] Sur les prescriptions de ce texte, voy. spécialement d’Emmanuel Derieux et d’Agnès Granchet, Lutte contre le téléchargement illégal. Lois DADVSI et HADOPI, Paris, Lamy, 2010, p. 154-165.
[18] Sur ce texte, voy. notre contribution au présent ouvrage : « Secret des sources des journalistiques, légistique et appréciation souveraine des juges ».
[19] Article 2, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi n°2010-1 du 4 janvier 2010, relative à la protection du secret des sources des journalistes.
[20] Article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
[21] Article L7111-5 du Code du travail.
[22] Conseil d’État, 20 avril 2005, Saborit, Tables, p. 1007 (Voy. également : Cour d’appel de Paris, 7 avril 1960, JCP, 1960, II, n°11600). Le Conseil a inféré de sa proposition que le label légal ne s’appliquait donc pas à une personne « qui n’apporte, notamment dans un reportage audiovisuel, qu’une contribution technique, alors même que celle-ci comporte, pour la bonne exécution du travail, certains choix et ne se borne pas à une pure exécution ».
[23] Conseil d’État, Bludzien, 22 mai 1992, n° 99402, tables, p. 1188.
[24] Des techniques dont l’existence – s’agissant en particulier des techniques d’écriture – est témoignée notamment par l’existence d’une offre de manuels et guides. Voy. notamment : Yves agnès, manuel du journalisme. Écrire pour le journal, paris, la découverte, coll. « repères », 2002 ; Jean-François Bège, Manuel de la rédaction : les techniques journalistiques de base, Paris, CFPJ Éditions 2007 ; Jean-Luc martin-lagardette, Le guide de l’écriture journalistique, Paris, Éditions La découverte, 7ème édition, 2009 ; Jacques mouriquand, L’écriture journalistique, PUF, coll. « que sais-je » ?, 3ème édition, 2005.
[25] Voy. par exemple à ce propos la controverse historiographique sur la question de savoir si l’« Histoire du temps présent » était bien de l’Histoire ou plutôt du journalisme. Voy. de la même manière les controverses suscitées par la « sociologie de l’intimité ». Voy. plus généralement : Vincent Goulet et Philippe Ponet, « Journalistes et sociologues. Retour sur des luttes pour « écrire le social » », Questions de communication, 2009, n° 16, p. 7-26.
[26] Voy. par exemple en France les relations « distantes » entre les historiens universitaires et les historiens « grand public » (Jacques Bainville ou André Maurois hier, Max Gallo aujourd’hui), que les premiers analysent plutôt comme étant, au mieux des « essayistes », au pire des journalistes.
[27] Entre autres figures de référence de cette « traversée des frontières », l’on peut citer Albert Londres, Joseph Kessel, les précurseurs de la Beat Generation (William Burroughs, Allen Ginsberg et Jack Kerouac), Colette ou, plus récemment, Ryszard Kapuscinski.
[28] Sur cette originalité, voy. notamment : Françoise Tristani-Potteaux, Les journalistes scientifiques. Médiateurs des savoirs, Paris, Économica, coll. « Médias Poche », 1997.
[29] Sur le storytelling comme « vieille méthode journalistique » et sur les limites de l’ouvrage (Christian Salmon, Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte, 2008) qui a popularisé cette expression en France en en faisant un paradigme d’interprétation de la politique contemporaine, voy. A. Weinberg, « Le storytelling, une arme de distraction massive », Sciences humaines, n° 209, novembre 2009, p. 34.
[30] Voy. notamment : Érik Neveu, Sociologie du journalisme, Paris, La Découverte, 2004 ; Collectif, Les Journalistes français à l’aube de l’an 2000, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2001.
[31] Sur le Gonzo journalism, on lira notamment la biographie de l’une de ses plus grandes figures, Hunter S. thompson : William Mckeen, Hunter S. Thompson. Journaliste et hors-la-loi (traduction française), Paris, Éditions Tristram, 2010.
[32] Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 1987, Domenech, n°83-41138.
[33] Conseil d’État, 21 octobre 1996, Mme Fouillaud, tables 1064.
[34] Dans le même sens, voy. Conseil d’État, 22 juin 2001, Lahache, Tables p. 1076 ; voy. Conseil d’État, 24 octobre 2001, Mme Chenot-Jeandot, Rec. 490 : le fait d’illustrer la présentation des programmes figurant dans les magazines adressées aux abonnés de Canal + et de Canal Satellite ne présente pas le caractère d’une activité de journaliste professionnel car l’objet en est d’assurer la promotion des programmes de ces chaînes.
[35] Conseil d’État, 24 octobre 1997, Mme Eyraud, Rec. 373.
[36] Voy. supra l’articulation autour de cette définition des dispositions de la loi Hadopi I relatives au droit d’exploitation des œuvres des journalistes. C’est une autre question que de savoir si les droits de rétribution accordés par les dispositions introduites dans le code de la propriété intellectuelle sont satisfaisants ou non.
[37] Cette notion désigne en réalité le statut de « l’entrepreneur individuel » qui a été créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 portant modernisation de l’économie et qui est entré en application le 1er janvier 2009. Voy. Xavier Ternisien, « Les jeunes journalistes sont contraints de s’adapter dans une presse en pleine crise », Le Monde, 26 mai 2010.
[38] Voy. supra l’articulation autour de cette définition des dispositions de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes.
[39] En matière de diffamation par exemple, l’« excuse de bonne foi » ou l’« exception de vérité des faits allégués » n’est pas circonscrite aux seules allégations litigieuses des journalistes. De la même manière le critère exonératoire de responsabilité pénale ou civile tiré par la Cour européenne des droits de l’homme de la contribution au « débat d’intérêt général » d’allégations litigieuses sur le terrain de l’injure, de la diffamation, de l’atteinte au droit à la vie privée, n’est pas circonscrit aux seules allégations avancées par des journalistes.
[40] Dans le prolongement des États généraux de la presse (2008-2009), un « comité des sages » présidé par Bruno Frappat (la « commission Frappat ») a été réuni par les pouvoirs publics afin de rédiger un « code de déontologie » ayant vocation à être introduit dans la convention collective des journalistes. Le « Projet de code de déontologie des journalistes » de la Commission Frappat a été présenté le 20 octobre 2009 et proposé à la négociation des partenaires sociaux.
[41] Voy. plus loin les chapitres sur l’autorégulation au Royaume-Uni ou au Québec.
[42] Sur les possibilités de concurrence et de complémentarité des énonciations déontologiques et des exigences légalo-judiciaires au Canada, voy. plus loin de Marc-François Bernier : « L’appropriation par les tribunaux civils canadiens des règles déontologiques dans les procès en diffamation dirigés contre les journalistes ».