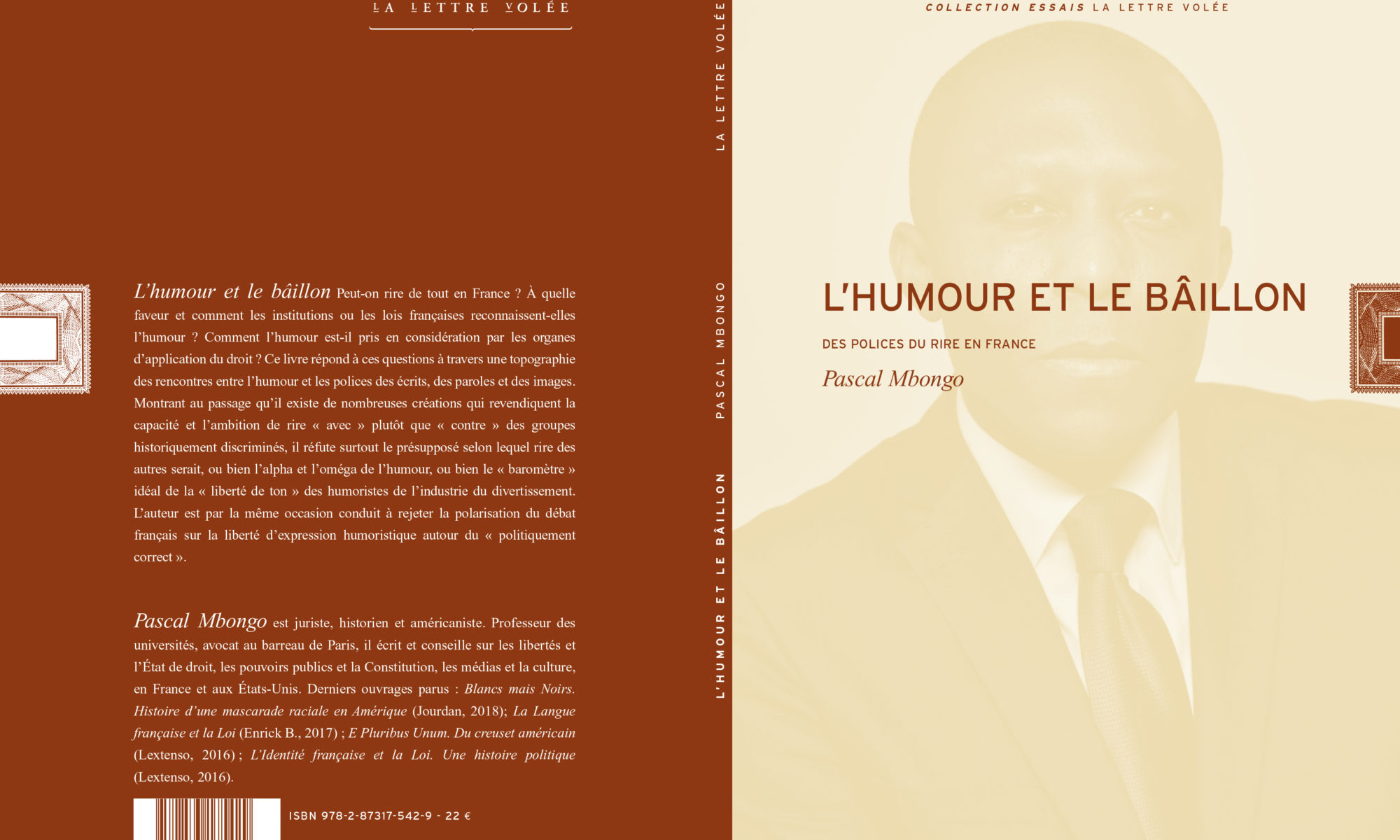Bien qu’oublié de nos jours, Francis de Croisset fut une plume parmi les plus prolixes de Paris entre 1900 et son décès en 1937. Né Edgar Franz Wiener le 22 janvier 1876 « dans une petite commune de la province de Brabant » en Belgique, il suit des cours de philosophie et de lettres à l’Université de Bruxelles où il obtient une licence en droit. En 1895, il décide de « tenter la Grande aventure » de Paris. Bien lui en a pris. Il s’y distingue très vite sous le nom d’emprunt Francis de Croisset en tant que poète (Musset et Baudelaire sont ses références absolues), journaliste (Gil Blas, L’écho de Paris, Le Matin, Le Journal, Le Figaro, Le Gaulois), et comme dramaturge. Le jeune homme a beaucoup d’esprit, et autant d’imagination. Le tout auréolé d’un certain cynisme, selon le mot de son biographe Pierre Barillet (Les Seigneurs du rire. Flers – Caillavet – Croisset, Paris, Arthème Fayard, 1999, p. 385). C’est ce « cynisme », ce « sens de la provocation » dirait-on aujourd’hui, qui valut à Francis de Croisset plus d’une difficulté avec la censure. Ce fut le cas dès L’Homme à l’oreille coupée, une comédie en trois actes, cosignée avec Jacques Richepin et créée au Théâtre de l’Athénée, le 23 janvier 1900(*). « Après cinq représentations, raconte Pierre Barillet, le 27 janvier, la pièce est interdite par mesure arbitraire, et reprise quatre jours plus tard, le 2 février, et non sans humour sous un titre différent : Une mauvaise plaisanterie ». On prête à Francis de Croisset l’intention d’avoir régulièrement « cherché » la censure théâtrale à des fins publicitaires – on ne parlait pas encore de « faire du buzz ». Cette considération importa peu au journaliste, écrivain et homme politique Henry Fouquier (1838-1901) qui, dans la tribune ci-après publiée dans Le Temps du 13 février 1900, livra l’une de ses dernières batailles contre une censure théâtrale dont L’humour et le bâillon raconte la laborieuse suppression.
*
La Société des auteurs dramatiques vient d’adresser à la censure un petit « billet » qui ne sera pas agréable à celle-ci. Il s’agit, dans cette note, de l’interdiction prononcée contre une pièce de théâtre, après coup et alors que cette pièce avait obtenu le visa du Bureau des théâtres. La Société des auteurs proteste. Mais il ne faudrait pas se tromper sur le sens de la protestation. Je ne crois pas un instant que la Société des auteurs, représentée par un homme tel que M. Halévy, ait approuvé, en son texte primitif, une pièce comme celle dont il s’agit L’Homme à l’oreille coupée. Elle n’ a pas entendu défendre, au nom de la liberté, une œuvre qui avait choqué les moins pudibonds. Il n’est pas question d’un fait particulier, mais d’un principe. Et, sur ce principe, la Société des auteurs paraît avoir pleinement raison.
Lorsque, maintenant l’institution antique de la censure, on a voulu lui donner un autre nom, on a essayé de faire une chose juste en soi et qui correspondait à la réalité. La coutume l’a emporté. La censure est restée la censure, au moins de nom. Mais, sous le gouvernement de la République, elle est devenue tout autre chose qu’autrefois. Jadis, l’Etat entendait à la fois jouer un rôle dans la direction de l’esprit public et exercer une sorte de droit régalien sur les œuvres de l’intelligence. Il a dû, dans notre très libre démocratie, abandonner cette double prétention. Son droit et son devoir sont tout autres. Il ne juge plus les doctrines et leur expression. Suivant une tendance qui s’étend jusqu’à l’exercice de la justice, ce qu’on a appelé le « garantisme » remplace la raison d’Etat. De tribunal arbitraire, la censure est devenue un tribunal arbitral. La théorie, c’est que les manifestations de la pensée sont absolument libres. Nul pouvoir ne saurait les contrôler et les atteindre à l’avance. Elles ne sont tangibles que lorsqu’elles sont délictueuses au regard du droit commun, et il est bien clair que le « lecteur royal » a vécu. Mais le droit commun, pour les directeurs de théâtres et pour les auteurs, est fort redoutable : Pour ne citer qu’un exemple, avoir un couplet coupé n’est rien à côté d’une condamnation pour outrage aux mœurs. La censure protège moins les oreilles du public qu’elle ne fixe, pour les auteurs et les directeurs, la limite des libertés qu’ils peuvent prendre sans s’exposer aux rigueurs des lois. C’est ainsi que doit être entendu le rôle de la censure sous la République et c’est ainsi qu’il est pratiqué. Aussi « Anastasie », fort oubliée et qu’on laissait tranquille, vivait-elle en bonne intelligence avec directeurs et auteurs.
Seulement, en revanche de leur soumission, ceux-ci voulaient pouvoir compter sur une sécurité. Leur manuscrit visé, leur mise en scène montrée à la répétition, ils estimaient être à l’abri de toute aventure, sauf dans le cas d’un grave désordre qui ne s’est pas produit dans l’espèce dont il s’agit. Entre la censure et le théâtre, une sorte de contrat bilatéral se crée. C’est la thèse que j’ai, jadis, soutenue à la tribune de la Chambre, à propos de Thermidor. Je fus combattu et battu par des ministres amis qui trouvaient que j’avais raison. Mais il y avait, là-dessous, de la politique, Robespierre, M. Clemenceau et le « bloc ».
Aujourd’hui, rien de semblable et la politique, pas plus que la liberté de l’art, ne sont de rien dans l’affaire. Pourquoi ne pas en parler nettement ? Un peu énervées par de longues complaisances dont le mauvais goût du public ne s’est que trop fait complice, la censure a fait une « gaffe ». On l’a vivement constatée. Le censeur responsable sévèrement a eu l’oreille fendue. La Société des auteurs dramatiques a formulé un rappel à une jurisprudence que personne ne songe contester. L’incident me semble clos. L’essentiel, c’est que l’attention de la censure reste éveillée et que, d’autre part, après trop de faiblesses, elle n’exagère pas les rigueurs. On a pu le craindre quand on l’a vue interdire, sur une affiche, le mot « sergot », pour désigner les gardiens de la paix. « Sergot » n’est que de la langue familière et populaire et n’est pas injurieux en soi. L’interdiction de ce vocable a été demandée, d’ailleurs, par le préfet de police. Il paraît que les gardiens de la paix étaient furieux. A la place du préfet, j’en aurais simplement envoyé une douzaine à la première représentation du drame où le « sergot » est montré sous les traits d’un héros. Ils auraient entendu la foule l’acclamer et en auraient conclu que « sergot » se prend aussi en bonne part, comme disent les grammairiens. Cette solution eût été la meilleure et on me permettra de penser qu’elle eût été spirituelle et parisienne. Mais ce n’était pas une solution administrative ».
Henry Fouquier
*
(*) Pierre Barillet résume ainsi cette pièce : « Edmond, un jeune viveur, revient d’un voyage en Egypte mutilé par un chef nègre qui lui a coupé « les oreilles » pour le châtier d’avoir séduit son épouse. Cette nouvelle n’est qu’une invention forgée par Claude, son vieux valet de chambre et destinée à écarter de son maître tous les parasites et les compagnons de débauche. La nouvelle se propage rapidement et provoque un chœur de commisérations chez les amis et maîtresses du jeune homme. Le futur beau-père d’Edmond, soucieux d’assurer sa descendance, l’oblige à rompre ses fiançailles avec sa fille Rose. Les quiproquos se multiplient. Au téléphone : « Ne coupez pas… mais non, je ne parle pas de ça », etc. Mais la mère de Rose est en désaccord avec son époux. Elle estime que l’impuissance d’un mari est garante de fidélité… Les jeunes mariés reviennent d’un (très long) voyage de noces flanqués de jumeaux qu’on fait passer pour les enfants adultérins du père de Rose ! »