Ce diaporama nécessite JavaScript.
Le Grand oral du CRFPA (V). Cas pratique et plaidoiries.
A la demande d’une association de locataires, une société propriétaire d’un ensemble immobilier a fait installer une clôture des lieux et a limité l’accès par des portes s’ouvrant par digicode. Toutefois, certains résidents font valoir que, pour des motifs religieux, il leur est interdit d’utiliser ces systèmes de fermeture pendant le Shabbat et certaines autres fêtes. Ils sollicitent donc du juge des référés qu’il ordonne à la société propriétaire de l’ensemble immobilier d’y installer une serrure mécanique. Comment vous y prendriez-vous, en qualité d’avocat de la société concernée, pour amener le juge des référés à ne pas accéder aux exigences des demandeurs ?
Exposé du candidat (10-15 mn)
Madame, Monsieur, le cas dont nous sommes saisis est le suivant : […].
Avant de répondre directement et précisément à la question qui nous est posée – à savoir comment nous nous y prendrions dans la défense de la société propriétaire de l’ensemble immobilier – (II), nous nous proposons d’analyser la demande de l’association des locataires, afin d’en préciser le sens juridique (I). La 1re partie me sert à imaginer le type d’argumentation juridique que l’association des locataires peut avoir développé à l’appui de sa demande ; La 2ème partie me sert à la contrecarrer. Mon exposé n’en est que plus simple, « carré ».
I- Ainsi donc, la demande dont nous sommes saisis touche à la question du retentissement ou des conséquences en matière d’exécution d’un contrat des convictions religieuses de l’un des cocontractants, lorsque ces convictions n’ont pas été intégrées au contrat par les parties elles-mêmes. Cette demande appelle certaines précisions.
Manifestement – et c’est là notre première précision – les requérants entendent faire admettre au juge des référés qu’indépendamment du silence des parties au contrat sur ce point, l’exécution du contrat doit s’approprier les conditions religieuses de l’une des parties.
Or – et c’est notre deuxième précision – cette interprétation ne peut se développer qu’à la faveur d’une combinaison entre la liberté constitutionnelle et conventionnelle de religion d’une part et le principe d’exécution de bonne foi des contrats d’autre part.
Le premier de ces principes – la liberté de pensée, de conscience et de religion – n’a pas seulement un aspect négatif qui interdit aux États ou aux pouvoirs publics de s’immiscer dans les croyances philosophiques ou religieuses des citoyens ; il a également un aspect plus positif qui veut que les États, à travers leur législation, garantissent un exercice des croyances religieuses.
La combinaison de ce principe avec le principe d’exécution de bonne foi des contrats énoncé à l’article 1134 al. 3 du code civil pourrait donc conduire le juge des référés à accéder à la demande du requérant tendant à obliger notre client à installer une serrure mécanique dans son immeuble. Plus généralement, cette demande, si elle était satisfaite, obligerait les bailleurs à adapter les lieux loués aux prescriptions religieuses dont se réclament les locataires.
II- Il nous semble au contraire – et telle est la substance de l’argumentation que nous développerions devant le juge des référés – que sauf stipulation expresse, les convictions et pratiques religieuses des cocontractants ne sauraient être considérées comme un élément du contrat lui-même ou de son exécution. Trois arguments militent en faveur de cette interprétation.
Le premier argument est tiré de la jurisprudence sociale de la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 1998, la Cour a en effet posé que « s’il est exact que l’employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail et que l’employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché, dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public ». Cette jurisprudence nous paraît d’autant plus remarquable qu’elle tend paradoxalement à protéger les convictions religieuses, puisque sinon l’on ne voit pas comment serait conjurée la discrimination pour motifs religieux dans l’exécution du contrat de travail alors que cette discrimination est sanctionnée par les articles L. 122-45 du code du travail et 225-1 du code pénal.
D’autre part, et c’est le second point de notre argumentation, la liberté de pensée, de conscience et de religion n’a pas la portée générale et absolue que suggère la demande des requérants. S’il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme admet que l’article 9 de la Convention a un effet horizontal, au point de s’opposer par exemple au licenciement par un hôpital catholique d’un médecin s’étant déclaré favorable à l’avortement (Comm. Rommelfanger c/ France, 6 sept. 1989), on peut néanmoins mettre en évidence de nombreux arrêts de la Cour fixant plutôt les limites de la liberté des croyances religieuses.
- CEDH, Refah Partisi c. Turquie du 31 juillet 2001 portant condamnation de la Charia ;
- CEDH, Pichon et Sajon c. France DU 2 octobre 2001 relatif à la validation des sanctions infligées à deux pharmaciens pour un refus de vente de produits contraceptifs fondé sur leurs convictions religieuses.
Le troisième et dernier argument justifiant à nos yeux le rejet de la requête par le juge des référés relève du « bon sens ». En effet, la demande du requérant créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. L’on ne voit en effet pas comment l’on pourrait donner satisfaction aux locataires de confession juive sans courir le risque d’une discrimination au regard des articles 9 et 11 de la CESDH en ne donnant pas satisfaction à d’autres locataires d’autres confessions qui, sur la question même de l’accès aux immeubles peuvent avoir des demandes d’une autre nature mais néanmoins dictées également par la religion. De la même manière, l’on ne voit pas comment l’on pourrait donner satisfaction aux locataires de confession juive sur la question de l’ouverture des portes sans leur donner satisfaction plus générale sur toutes demandes intéressant la vie de l’immeuble dictées par le respect des croyances au risque de conflits avec les autres locataires de confessions différentes, athées ou agnostiques.
Conclusion 1 (le candidat n’a pas vu ou ne sait pas que la Cour de cassation a déjà statué sur cette question) : « Madame, Monsieur, pour les différentes raisons que nous venons de dire le juge des référés devrait donc raisonnablement rejeter la demande de l’association de locataires ».
Conclusion 2 (le candidat sait que la Cour de cassation a déjà statué sur un tel cas et le candidat connaît cet arrêt ; dans ce cas celui-ci doit lui servir d’argument d’autorité à la fin de ses conclusions car invoquer cet arrêt dès le début c’est se préparer à disserter sur lui alors qu’il s’agit de rédiger des conclusions) : « Madame, Monsieur, ce sont ces différentes raisons qui ont conduit la Cour de cassation, dans une espèce identique à celle dont nous sommes saisis à conclure précisément….. »
A suivre
Le Grand Oral du CRFPA. Le commentaire de texte (IV).
Comprendre un texte (jugement, arrêt, texte non-juridique) et organiser un commentaire suggère une démarche en deux temps: – procéder à une lecture-analyse préliminaire. – bâtir le commentaire.
I. L’analyse préliminaire
Elle doit marquer un temps de réflexion et d’approfondissement de la lecture, avant que la rédaction du commentaire ne soit entreprise. Les étapes en sont : – La lecture réfléchie et attentive du texte. – L’analyse du contenu du texte.
La lecture réfléchie et attentive du texte
Elle a pour but de déterminer dans l’ensemble le « sujet » du texte, l’idée directrice, sans entrer dans le détail. Effectuée calmement, elle permet d’éviter toute interprétation fausse, tout contresens, sur le texte. Cette lecture tient compte :
– des indications éventuelles d’introduction,
– des indications spécifiques de « production » du texte (date, auteur, etc.).
– du titre, qui n’est jamais choisi au hasard mais qui peut avoir des rapports avec l’idée directrice du texte
– du genre auquel appartient le texte: récit, exposé, discours, texte polémique, etc.
– du ton, du style, et plus particulièrement lorsqu’ils constituent en eux-mêmes un aspect fondamental de l’idée directrice,
– de la langue employée: langue technique (juridique), langue ordinaire, ……
L’analyse du contenu du texte
Elle a pour objet de saisir:
– les idées principales du texte, leur enchaînement. La lecture réitérée du texte doit être conduite crayon en main. Il est recommandé de souligner sur le texte :
. les mots clés et leurs rapports, les termes évoquant des thèmes importants.
. les liaisons et articulations logiques du texte, lorsqu’elles sont évidentes. Exemple : « sans doute….mais », « cependant », « toutefois », « mais encore ». On peut indiquer en marge les liaisons non explicitées.
– Le mouvement du texte: Il s’agit de marquer les différents mouvements du texte en s’efforçant de leur donner un titre bref et précis qui indique leur contenu, mais en évitant de recopier les phrases du texte: on obtient ainsi un véritable canevas de l’analyse.
Il est recommandé de noter à part toutes les idées intéressant la discussion, à mesure qu’elles se présentent, soit dans le texte, soit dans l’esprit du commentateur….
II. Le commentaire proprement dit
Il faut disposer d’un plan simple et clair, qui peut être construit sur le modèle suivant :
Hypothèse où il s’agit de commenter un texte non-juridique en rapport avec les libertés (article de presse, etc.)
a) L’introduction doit fournir :
- des indications de « production » du texte (date, auteur, etc.).
- des indications sur le genre auquel appartient le texte : récit, exposé, discours, texte polémique, etc.
- la problématique développée par l’auteur ;
- la thèse principale de l’auteur du texte.
b) Le corps du commentaire doit exposer les vues personnelles du candidat sur la question principale traitée dans le texte, étant entendu que cet exposé doit être lui-même ordonné.
Compte tenu du fait que vous disposez de très peu de temps, il vous faut organiser votre réflexion autour de deux points :
– la proposition principale de l’auteur (sa « thèse ») ;
– les « propositions secondaires » de l’auteur, c’est-à-dire les arguments qu’il invoque afin d’étayer sa thèse. Stratégiquement, vous devriez vous attacher à dire :
. soit que vous partagez sa thèse et que vous avez les mêmes propositions secondaires que lui, dans ce cas vous devez approfondir ces propositions secondaires ;
. soit que vous partagez sa thèse mais par à partir des mêmes propositions secondaires que lui ; dans ce cas vous devez quelles sont les vôtres ;
. soit que voue ne partagez pas sa thèse principale ; dans ce cas vous devez dire à la fois pourquoi et critiquer ses propositions secondaires.
Hypothèse où il s’agit d’une décision de justice :
a) L’introduction : Les faits – La procédure – Le « problème de droit » en cause dans l’arrêt – La solution développée par l’arrêt.
b) Faute d’avoir beaucoup de temps, il vous faut organiser le corps de votre exposé autour de deux axes :
- axe 1. L’analyse des bases légales [il faut prendre bases légales ici au sens le plus large, comme désignant les normes constitutionnelles, les normes conventionnelles, les normes législatives] retenues par le juge. « Dans une première partie, nous apprécierons les bases légales de la décision de la Cour d’appel de Paris (I) ».
- axe 2. L’analyse des conséquences tirées par le juge de ces bases légales. « Dans une seconde partie, nous évaluerons l’usage fait par la Cour d’appel de Paris des bases légales applicables au cas d’espèce (II) »
► C’est ici que vous devez dire ce que vous pensez de la manière dont le juge a utilisé les modes d’argumentation et les méthodes traditionnelles d’interprétation ;
► C’est ici que le candidat doit dire ce qu’il pense de la manière dont le juge a utilisé les méthodes d’interprétation spécifiques aux normes constitutionnelles.
► C’est ici que le candidat doit dire ce qu’il pense de la manière dont le juge a utilisé les méthodes d’interprétation spécifiques à la CESDH.
Simulations à venir
*
Le Grand Oral du CRFPA. La dissertation (III)
I. Les exigences fondamentales de la dissertation
Outre de solides, une bonne composition demande, en toutes circonstances, la mise en œuvre de quelques qualités.
Essayer d’être complet : cela veut dire une connaissance complète du sujet proposé ; elle engage donc à une restitution des connaissances nécessaires à l’argumentation.
Essayer de rester objectif. Les jugements de valeur péremptoires sont à proscrire ; cela ne veut pas dire que des opinions ne peuvent pas être exprimées et défendues mais à la condition d’être étayées par des éléments de connaissance.
Essayer d’être clair. Par définition, c’est le refus de la confusion. C’est aussi la nécessité de démontrer et d’illustrer (des exemples !) toute idée avancée dans le devoir par une référence à un texte précis, à une décision juridictionnelle précise ou à un événement précis.
Être absolument rigoureux. C’est le refus des approximations. En matière de connaissance politique – mais cela vaut également pour la connaissance économique et sociale – chaque mot, chaque groupe de mots a une signification particulière, sinon ne parlerait-on pas de « concepts juridiques », de « concepts politiques », de « notions juridiques » ou de notions politiques. Il est donc important que le candidat ait constamment à l’esprit qu’il sera jugé par des personnes ayant un certain bagage.
Être logique. Une dissertation bien pensée et bien ordonnée doit nécessairement s’organiser à partir d’un point fixe, d’une idée directrice dont découle le reste du raisonnement. Quant à la démonstration, elle doit adopter une progression logique.
II. Les écueils à éviter
La mauvaise délimitation du sujet. Il ne faut étudier que le sujet, rien que le sujet, mais tout le sujet. Par conséquent, il faut éviter la confusion entre le sujet et la matière à laquelle celui-ci se rapporte. Inversement, l’étudiant évitera de n’envisager que trop partiellement le sujet.
La récitation simpliste de connaissances. Comme il arrive souvent que la formulation du sujet se rapproche de l’intitulé d’un chapitre, d’une section ou d’un paragraphe du cours, l’étudiant évitera de restituer ces développements du cours sans envisager les questions pertinentes se rapportant au sujet.
Le temps de composition. L’on peut trouver ce temps long, court ou raisonnable. Il reste qu’un examen est aussi une épreuve physique (vous êtes assis, enfermé dans une salle) et une manière d’éprouver la capacité de l’étudiant à bien composer – ce qui suppose un certain éveil et une certaine attention – pendant le temps qui lui est imparti. Sans qu’il soit possible de fixer une règle en la matière, vous devez néanmoins concevoir une organisation structurée autour des points suivants : temps d’analyse du sujet ; temps de mobilisation des connaissances; temps d’élaboration du plan détaillé ; temps de rédaction (1h30-2h) ; temps de relecture.
Attention à la grammaire et à la syntaxe !
III. Typologie des sujets de dissertation en Libertés et droits fondamentaux
1. Une notion, un principe, une valeur
. Le gouvernement des juges
. Le Conseil constitutionnel
. La liberté
. Le secret
. Le droit à l’enfant
. Le juge d’instruction
. Le devoir de mémoire
. La double peine
. La prééminence du droit
. Le populisme pénal
. Le Patriot Act.
. L’humanisme
. Les frontières de l’Europe
. Les statistiques ethniques
. La délation
. Les polices privées
Observations.
S’il s’agit d’une valeur, d’une notion, d’un principe, l’on attendra de vous que vous mettiez en évidence, notamment : 1. la construction historique de la notion, du principe ou de l’institution en question 2. La place qu’il (ou elle) occupe dans le cadre contemporain 3. les problèmes de principe ou pratiques auxquels il (ou elle renvoie) 4. les moyens de remédier à ces problèmes.
S’il s’agit plus précisément d’une institution juridique, vous devez nécessairement penser à deux choses : 1. quelle est sa place dans le système juridique dans lequel elle s’inscrit : prééminence ou subordination à d’autres institutions ? lesquelles ? à quoi voit-on cette prééminence ou cette subordination? Vous noterez qu’en général dans un système juridique une institution est toujours prééminente sur d’autres institutions et elle-même subordonnée à d’autres, ce qui autorise en général deux sous-parties 2. quel est son rôle dans le système juridique dans lequel elle s’inscrit ? Vous noterez qu’en général l’on analyse le rôle des composantes d’un système institutionnel à partir de ces trois concepts : rôle de contrepoids (si oui, à quoi le voit-on ? comment se manifeste-t-il) – rôle de régulateur – rôle de médiateur.
Nota bene : si le sujet ne renvoie qu’au rôle (« Le rôle du Conseil constitutionnel ») ou à la place d’une institution (« La place de la Cour de cassation, etc. »), l’on serait « Hors sujet » en traitant de l’autre problème.
2. Deux notions liées par une conjonction additive (« ET »)
. Constitution et liberté
. Internet et libertés
. Torture et preuve judiciaire
. Secret des sources journalistiques et vérité judiciaire
. Tolérance et laïcité
Observations
L’on vous demande de dégager la nature des rapports entre les deux notions, les deux institutions. Trois hypothèses sont logiquement envisageables : 1. Des rapports d’antagonisme ? 2. Des rapports de complémentarité ? 3. Des rapports de consubstantialité ? Ce type de sujet se prête en général à un balancement dialectique entre le 1 (en apparence des rapports d’antagonisme – I) et le 2 (en réalité, des rapports de complémentarité).
3. Deux notions liées par une conjonction supplétive (« OU »)
. Ordre public ou Liberté ?
. Démocratie ou libéralisme ?
Une proposition comprenant une alternative entre les termes de laquelle il vous est demandé d’exprimer une préférence
. Faut-il préférer…. ?
. Est-il préférable de …. ?
. Faut-il légaliser l’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires ?
. Faut-il aider les pays pauvres ?
. Faut-il débattre encore de la peine de mort ?
. Faut-il légiférer sur l’euthanasie ?
Observations.
L’on vous demande de dire votre préférence entre les deux valeurs ou les deux institutions ainsi opposées. Le piège dans ce type de sujet est qu’il renvoie souvent à une alternative entre deux valeurs d’une égale importance pour la démocratie libérale. Quel peut être le sens de la liberté sans ordre ? Quel peut être auj. le sens d’un régime libéral mais hostile au suffrage universel.
Il vous faut donc savoir éviter le piège théorique du sujet pour offrir un balancement dialectique ; par exemple entre la difficulté de faire coexister ces deux valeurs (I) et la possibilité-nécessité de cette coexistence (II).
4. Une question ouverte
. Que pensez-vous de ?
. Existe-t-il une identité européenne ?
. Y a-t-il une vertu de l’oubli ?
. Le droit a-t-il réponse à tout ?
. Qu’est-ce qu’être Français ?
. L’humanisme a-t-il un avenir ?
. Une guerre peut-elle être juste ?
. Quelles politiques d’intégration ?
Observations
Ici vous ne pouvez pas vous permettre d’escamoter la question qui vous est posée. Simplement, avant d’arriver à l’explicitation de votre propre préférence vous devez vous approprier les arguments de la partie adverse pour en montrer les limites, les insuffisances.
IV. Les sujets de dissertation dits « atypiques » ou « historiques »
Les sujets dits « atypiques » ou « historiques » proposés au Grand Oral dans certains IEJ demandent au candidat de faire des connexions avec le droit des libertés fondamentales et non de vouloir réciter des connaissances : l’enjeu du grand oral est, pour le candidat, de mettre en évidence la résonance en droit des libertés fondamentales du sujet dont il est saisi. Et tous les sujets authentiquement ou prétendument « atypiques » ou « historiques » se prêtent à des connexions avec le droit des libertés fondamentales.
Les sujets authentiquement atypiques
Ce n’est le cas que lorsque le sujet désigne une notion non-juridique mais soit une institution sociale, soit un objet social, soit une pratique sociale, soit un affect, soit une valeur :
→ Les fleurs (objet social)
→ Le soleil (objet social)
→ L’amitié (valeur)
→ Les jardins (objet social)
→ La fidélité (valeur)
→ L’école (institution sociale)
→ Le sport (pratique sociale)
→ L’hospitalité (valeur)
→ La haine (affect)
→ L’amour (affect)
Des thèmes tels que la confiance, la loyauté, le consentement, la force sont pour leur part d’authentiques catégories juridiques : il suffit de prendre les index des codes pour les y trouver.
En toute hypothèse, le candidat doit faire des connexions avec le droit des libertés fondamentales tel qu’il l’a appris dans le Bréviaire et tel qu’il ressort des codes.
Exemple : Les fleurs.
Connexions :
→ Fleurs et droit à un environnement sain
→ Fleurs et protection de la santé publique (motif de limitation des libertés)
→ Fleurs et droit de propriété (propriété olfactive)
→ Fleurs et règles de civilité (elles sont offertes dans de nombreuses occasions de la vie sociale).
Et puis on peut essayer de concevoir un plan qui regroupe les différentes connexions.
Exemple :
Les fleurs, reflet de la civilité
Les fleurs, reflet du droit au bien-être
La méthode idéale pour concevoir son exposé pour ce type de sujets consiste à partir de deux pistes :
→ les modalités de la reconnaissance par le droit de cet objet social, de cette valeur, de cette institution sociale, de cette pratique sociale, de cet affect (telles que ces modalités ressortent des codes)
Ex. : l’amour = le mariage, l’adoption, les successions, les dons, etc.
Ex. : le sport = le sport comme élément culturel, à l’école, à la télévision – l’organisation par le droit des fédérations sportives – l’encadrement des manifestations sportives.
→ la sanction par le droit des pathologies liées à cet objet social, à cette valeur, à cette institution sociale, à cette pratique sociale, à cet affect (telle que cette sanction ressort de la législation administrative, civile, pénale).
Ex. : l’amour = les interdits liés à certains types d’unions, même fondées sur l’amour
Ex. : le sport = la triche dans le sport – la corruption dans le sport – le racisme dans le sport, etc.
Les sujets prétendument historiques
Le Grand oral porte sur les libertés et les droits fondamentaux. Ce que les candidats (Paris II) appellent « sujets historiques » ce sont en réalité une occurrence historique dont on attend du candidat qu’il dise la résonance qu’il lui trouve en libertés et droits fondamentaux.
Le contresens absolu consiste à penser que sur un sujet tel que « Le procès de Socrate », il s’agit de faire un exposé historique sur le procès de Socrate. En réalité, le candidat doit faire des connexions avec le droit des libertés fondamentales tel qu’il l’a appris dans le Bréviaire et tel qu’il ressort des codes.
Dans le cas du procès de Socrate, si le candidat sait ce dont il s’agit, il devrait logiquement faire des connexions :
→ le procès de Socrate et le droit à un procès équitable
→ le procès de Socrate et la question de la loi injuste (droit de résistance à l’oppression)
→ le procès de Socrate et la liberté de pensée des jeunes (Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse par sa pensée philosophique)
→ le procès de Socrate et le pluralisme
A partir de là, on construit un plan cohérent ; et dans son exposé, on s’oblige à faire des allers retours entre le sujet historique et les données juridiques.
Sur un sujet tel que « La Révolution américaine », les connexions envisageables sont nombreuses :
→ La Révolution américaine et les idéaux du libéralisme politique au XVIIIe sècle
→ La Révolution américaine et la Révolution française : la DDHC est le miroir des déclarations des droits des colonies britanniques libérées (bréviaire : déclaration des droits de la Virginie, du Maryland, etc.)
→ La Révolution américaine et l’égalité : hier (esclavage et ségrégation) et aujourd’hui (affirmative action, Obama)
A partir de là, on construit un plan cohérent ; et dans son exposé, on s’oblige à faire des allers retours entre le sujet historique et les données juridiques.
Sur un sujet tel que « Henri IV », les connexions envisageables sont évidentes : guerres de religions, liberté religieuse, séparation des églises et de l’Etat. A partir de là, on construit un plan cohérent ; et dans son exposé, on s’oblige à faire des allers retours entre le sujet historique et les données juridiques.
Henri IV : un acteur de référence dans l’histoire de la liberté religieuse
Henri IV : un moment matriciel dans l’histoire de la séparation des églises et de l’Etat.
Les sujets prétendument atypiques
Il convient d’éviter d’envisager comme « atypiques » des sujets qui le sont d’autant moins qu’ils prennent une catégorie juridique ou une catégorie spécifique du droit des libertés fondamentales. Simplement il importe au candidat de se rappeler deux choses : a) les libertés ont un effet vertical (relations entre pouvoirs publics et personnes privées) et horizontal (relations entre personnes privées) ; il faut donc penser à ces deux registres lorsque l’on réfléchit sur une dissertation ; b) les libertés ont souvent une dimension transdisciplinaire (c’est elle qui justifie la disponibilités des codes le jour de l’examen) et cette dimension transdisciplinaire ne pose pas de problème si le candidat s’oblige à utiliser les index des codes.
Voici des exemples de sujets qui n’ont rien d’« atypiques » mais demandent simplement au candidat une bonne analyse des termes du sujet et l’établissement des connexions avec le droit des libertés.
Exemple 1. Le domicile
Le candidat ne peut pas ne pas penser immédiatement au droit à la vie privée, aux visites et perquisitions domiciliaires, au droit à un logement décent : tout cela est dans les codes. Et il est loisible en 5 minutes maximum de concevoir un plan du style : I. Le droit au domicile comme droit fondamental II. L’intimité du domicile comme corollaire du droit au domicile.
Exemple 2. Le silence
Le sujet appelle des connexions immédiates telles que : le silence de l’administration à une demande des administrés, le silence des mis en cause dans une procédure policière et pénale (spécialement en garde à vue), le silence et les nuisances sonores rapporté au droit à un environnement sain, etc. Tous ces éléments de connexion de base sont dans les codes (code administratif, code de procédure pénale, code général des collectivités territoriales → nuisances sonores, police du bruit, etc.).
En cinq minutes ces connexions sont faites, il ne reste plus qu’à trouver le plan. Il vient aisément comme celui-ci : I. Le silence comme modalité relationnelle entre Administration et Administrés II. Le silence comme modalité du droit à un environnement sain.
Exemple 3 : Minorité et commerce
L’analyse du sujet suggère des connexions immédiates avec les libertés.
« Minorité » = enfants = droits des enfants. → Quid de la faculté des mineurs de faire des actes de commerce ? Quid de la protection des mineurs face aux actes de commerce ?
→ Il suffit de prendre le code civil, le code de commerce et le code pénal pour identifier dans leurs index les règles pertinentes et composer quelque chose.
Exemple 4 : L’entreprise a-t-elle des droits fondamentaux?
Une analyse du sujet permet de faire des connexions avec le droit des libertés fondamentales et d’éviter le piège du sujet (et donc le risque d’un hors sujet). Le sujet n’est pas Les droits fondamentaux dans l’entreprise mais L’entreprise a-t-elle des droits fondamentaux ? ça change tout !
Intro : qu’est-ce qu’une entreprise ? Une personne morale, une personne morale caractérisée par le code du commerce, le code des sociétés, le code du travail… La question n’est pas « les personnes morales ont-elles des droits fondamentaux » : il y a d’autres personnes morales que des entreprises qui sont plus immédiatement liées aux droits fondamentaux (partis politiques, syndicats, associations, congrégations religieuses… etc.).
A partir de l’analyse du sujet et des connexions, l’on peut alors concevoir le plan. Les entreprises sont bénéficiaires plutôt que titulaires des droits fondamentaux
A. Le bénéfice des droits économiques 1. droit de propriété 2. liberté d’entreprendre – avec à chaque fois : protection constitutionnelle, protection conventionnelle + illustrations du style : nationalisations/expropriations et indemnisation – fusions, acquisitions, etc.
Le bénéfice de droits classiques : la liberté d’expression, la liberté de la presse (publications des entreprises, publicité) : protection constitutionnelle, protection conventionnelle + illustrations : publications des entreprises, publicité – La liberté d’association, la liberté syndicale (associations d’entreprises, syndicats patronaux) : protection constitutionnelle, protection conventionnelle + illustrations.
Les entreprises sont bénéficiaires de protections légales dans le cadre de leur responsabilité pénale… (on prend le code pénal et on décline le régime de la responsabilité pénale des personnes morales) en le rapportant aux prescriptions fondamentales du droit processuel et du droit de la sanction (droit à un procès équitable, principe non bis in idem, etc.).
TRES IMPORTANT !
Une bonne introduction doit comprendre trois temps, lesquels peuvent être articulés en trois paragraphes, avant l’annonce du plan :
- l’analyse du sujet (Voir la colonne 2 du tableau ci-dessus où vous avez des modèles d’analyse du sujet qu’il suffit de reprendre à votre compte) ;
- l’actualité du sujet, autrement dit les événements de l’actualité institutionnelle et politique qui rendent ce sujet pertinent ;
- les questions pertinentes soulevées par le sujet (c’est ici que le jury doit entendre des phrases telles que : « l’on peut se demander si… » ; « l’on peut encore se demander si…. » ; « au surplus l’on peut se demander si…. ».).
- Chaque partie de l’exposé doit correspondre à une proposition principale (Grand I et Grand II), cette proposition principale étant elle-même étayée par deux propositions secondaires (Grand A et Grand B). Il ne faut pas chercher à faire « compliqué », ni sophistiqué. En cas de doute ou si vous voyez le temps filer, choisissez des propositions secondaires simples mais efficaces du genre : A. Les manifestations de la chose/B. L’explication de la chose – A. Les manifestations de la chose/B. La portée de la chose – A. La difficulté de la chose/B. La possibilité de la chose, etc.
Autrement dit : de la même manière que les deux propositions principales doivent se répondre dans un rapport dialectique, les propositions secondaires elles aussi doivent se répondre dans un rapport dialectique.
Ne pas oublier non plus que : les manifestations des phénomènes juridiques sont à classer selon leur nature (manifestations juridiques, manifestations sociologiques, manifestations économiques, etc.) ; de la même manière, l’explication des phénomènes juridiques doit toujours faire l’objet d’une systématisation (explications de type juridique, explications de type sociologique, explications de type politique, explications de type psychanalytique, explication de type anthropologique, etc.).
*
Sujet. L’incrimination de la « prédication subversive ».
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet et d’autres députés « Les Républicains » ont déposé à l’Assemblée nationale le 31 août 2016, une proposition de loi pénalisant la prédication subversive.
Cette proposition de loi est remarquable au premier regard :
- la proposition de loi est signée par un nombre très faible de députés « Les Républicains ». Autrement dit le groupe « Les Républicains » ne se retrouve pas en elle ;
- la proposition de loi n’est pas, formellement, l’« interdiction du salafisme » que Mme Kosciusko-Morizet a plusieurs fois annoncé à la télévision : ou bien sa formulation pour les télévisions était-elle du marketing dans le cadre de sa candidature aux primaires ; ou bien a-t-elle pris la mesure de l’absurdité de l’idée générale généralisante d’« interdire le salafisme ». Ou bien les deux (M. Geoffroy Didier expliquait récemment que les parrainages d’adhérents pour sa candidature aux primaires « affluaient chaque fois » qu’il faisait « une proposition choc à la télévision », comme sa proposition d’un « test de radicalisation » pour les adolescents).
L’incrimination envisagée de la « prédication subversive » est une ingérence dans : – la liberté de religion garantie par la Constitution, la CESDH, etc. – la liberté d’expression garantie par la Constitution, la CESDH, etc. ; – le droit à la vie privée ; – la liberté de réunion.
Cette incrimination demande donc à être analysée (discutée) au prisme de sa justification libérale (« test des motifs légitimes de restriction des libertés ») et de sa définition libérale (« test de sa proportionnalité au but poursuivi », etc.).
I. La difficulté d’une justification libérale de l’incrimination de la « prédication subversive »
Par hypothèse, les motifs susceptibles de justifier cette incrimination sont : – la protection de la sécurité nationale ; – la protection de la sûreté publique ; la défense de l’ordre ; – la prévention des infractions pénales.
« Le prêche, l’enseignement et la diffusion des idéologies politico-religieuses radicales constituent réellement une menace pour notre sécurité, ainsi qu’une atteinte aux intérêts fondamentaux de notre Nation », est-il écrit dans la proposition de loi. Cette formulation est floue car le concept de « sécurité » qu’elle utilise peut désigner : – soit la sécurité nationale ; – soit a sécurité publique.
En toute hypothèse, l’admissibilité de ce motif est plaidable, comme son inadmissibilité.
A. Admissibilité du motif tiré de la « sécurité »
→ Le fait qu’il existe bien des prêches apologétiques ou incitatifs de (à) la violence : soit des prêches apologétiques d’actes de terrorisme ; soit des actes apologétiques d’actes de violence vis-à-vis de personnalités dont les opinions sont jugées blasphématoires ou islamophobes (Robert Redeker, par exemple, qui vit depuis plusieurs années sous surveillance policière).
B. Inadmissibilité du motif tiré de la « sécurité »
→ L’absence d’un lien de causalité immédiate entre des prêches hostiles aux valeurs fondamentales de la France et des actes de terrorisme :
- d’ailleurs l’exposé des motifs de la proposition de loi est très ambigu puisqu’il suggère que, en vérité, ce sont des valeurs particulières promues par la « prédication subversive » qui est le problème, indépendamment de toute considération relative à des actes commis par les prédicateurs subversifs :
« La radicalité politico-religieuse est prêchée, enseignée et diffusée par des prédicateurs qui défendent la supériorité de leurs lois religieuses sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République, en prônant notamment une ségrégation identitaire et communautaire à rebours de l’État de droit ».
- d’ailleurs la proposition de loi vise spécialement les prêches dans les mosquées alors que la radicalisation est réputée se faire principalement sur les réseaux numériques ;
II. La difficulté d’une incrimination libérale de la « prédication subversive »
La discussion sur la définition libérale de cette infraction emprunte un format classique :
A. Comme il s’agit d’une infraction pénale, les partisans de cette incrimination (ou les plaideurs en sa faveur) voudront démontrer qu’elle ne méconnaît pas le principe constitutionnel de « clarté et de précision des infractions » (ou de « prévisibilité » de la « loi », selon la CEDH). Les adversaires du texte (ou les plaideurs contre lui) voudront montrer qu’il n’en est rien (exemple : qu’est-ce qu’un « principe constitutionnel et fondamental de la République » ? La laïcité de l’état ? Mais en quoi le fait de dire que l’on est contre la laïcité de l’état ou l’égalité entre les hommes et les femmes constitue-t-il un discours plus subversif que celui de l’anarchiste qui veut la fin de l’état lui-même ?)
B. Cette incrimination est-elle proportionnée au but poursuivi ?
– n’existe-t-il pas des réponses non-juridiques et non-limitatives des libertés à certains prêches ?
– n’existe-t-il pas des réponses juridiques alternatives et plus respectueuses des libertés à l’incrimination envisagée ?
*
Simulation Grand oral du CRFPA : Sommes-nous en guerre ?
Madame, Monsieur,
Le sujet dont nous sommes saisis est « Sommes-nous en guerre ? ».
En guise d’introduction, nous voudrions faire deux observations.
Notre première observation porte sur le sens du sujet. A bien y regarder, ce sujet peut se rapporter à la compétition économique mondiale, auquel cas faudrait-il le comprendre ainsi « Sommes-nous en guerre économique ? ». L’on peut très bien aussi se demander si nous sommes « en guerre technologique ». Toutefois, nous nous proposons de saisir ce sujet à la lumière de son actualité la plus immédiate qu’est le terrorisme et la « guerre contre le terrorisme ». La question est donc bien celle-ci : le terrorisme contemporain est-il assimilable à une guerre et qui cette guerre hypothétique engage-t-il ?
Cette question est vaste car, en réalité, elle soulève de nombreuses questions d’ordre philosophique et politique, ainsi que des questions d’ordre juridique. Parmi ces questions, l’on peut citer quelques-unes :
- Qu’est-ce que la guerre ?
- Si, par hypothèse, nous sommes en guerre, quels sont nos buts de guerre ?
- Si, par hypothèse, nous sommes en guerre, jusqu’à quel point sommes-nous prêts aux sacrifices humains qui est le lot des guerres ?
Nous verrons donc que si la qualification du terrorisme comme « guerre » peut sembler opportune (I), elle est néanmoins risquée (II).
I. L’assimilation du terrorisme à la guerre peut sembler opportune
En effet, les actes terroristes sont souvent l’occasion pour les responsables politiques et les médias de dire « nous sommes en guerre ». Cela ne date d’ailleurs pas d’aujourd’hui : au moment des attentats de Paris de 1986, le gouvernement disait déjà « nous sommes en guerre ». Au lendemain des attentats du 11 septembre, le gouvernement américain déclara à son tour qu’« il s’agit d’une guerre ». Ces déclarations ne sont pas nécessairement absurdes si l’on admet, d’une part qu’elles ont une certaine utilité politique (A), d’autre part que le concept de guerre est élastique (B).
Une assimilation politiquement utile
On le sait, l’article 421-1 du code pénal définit comme actes terroristes un certain nombre d’infractions de droit commun lorsque celles-ci sont « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». On sait aussi les problèmes d’interprétation de cette définition peut soulever.
Ce qui nous importe dans le cadre de cet exposé, c’est l’élément de définition du terrorisme consistant dans « l’intimidation » ou la « terreur ». Si cet élément est assez commun aux textes internationaux et européens, c’est parce qu’il permet de dire deux choses :
- primo, que le terrorisme a des effets politiques ; en cela il n’est d’ailleurs pas original puisque de nombreuses autres infractions pénales peuvent avoir des effets politiques ;
- surtout, cet élément lié à l’intimidation ou à la terreur permet de dire que le terrorisme a des effets politiques très particuliers. Or le terrorisme a un effet de sidération qui produit une peur sans commune mesure avec la peur que peuvent générer des formes de violence politique traditionnelle telles que des manifestations, des émeutes, des violences urbaines, etc. (1)
C’est dans cette dernière mesure que l’on peut comprendre que les responsables publics puissent parler d’« actes de guerre » à propos de certains types d’actes terroristes : l’on peut comprendre que le concept de guerre soit dans ces cas, une facilité rhétorique qui leur permet, somme toute, de montrer qu’ils ont pris la mesure de la sidération de l’opinion publique et qui leur permette de suggérer qu’ils à la fois une volonté et une capacité d’agir.
Voyons à présent dans quelle mesure le concept de « guerre » lui-même facilite son appropriation dans la question terroriste…
Une assimilation facilitée par le concept même de guerre
Il nous semble que cette assimilation du terrorisme à la guerre est facilitée par plusieurs facteurs.
Le premier facteur est que les auteurs d’actes terroristes peuvent eux-mêmes placer leur action sous ce label. Cela est vrai du terrorisme politique « laïque », comme celui de certains mouvements de libération nationale. Cela n’est pas moins vrai du terrorisme politique religieux d’Al Qaïda, de Daesh ou de Boko Haram. Pour ainsi dire, si « Eux » disent « nous faire la guerre », répondre que « Nous leur faisons aussi la guerre » peut sembler cohérent (2).
Le deuxième facteur est que le concept de guerre s’applique depuis très longtemps à d’autres formes de violence politique que des conflits armés entre des états. Ainsi, le concept de « guerre civile » sert depuis déjà le XIXe siècle à qualifier certaines formes de violence armée à l’intérieur des états : les émeutes, les rébellions, etc. Et ce concept de « guerre civile » a même pu être utilisé lorsque les armes utilisées dans le cadre de ces violences armées n’étaient pas militaires, par exemple les machettes du Rwanda ou les voitures explosives. D’ailleurs, les conventions de Genève n’utilisent pas le concept quelque peu daté de « guerre » mais ceux de « conflits armés internationaux » (CAI) et de « conflit armés non-internationaux ».
Troisième et dernier facteur : il existe désormais des guerres qui ne portent pas leurs noms. C’est ainsi que la France n’est pas en guerre au mali ou à Syrie mais qu’elle agit dans ces pays dans le cadre d’« opérations extérieures » (OPEX).
Après cet effort de compréhension de la proposition « nous sommes en guerre », il faut à présent voir qu’elle comporte des risques importants…
II. L’assimilation du terrorisme à la guerre est néanmoins très risquée
Deux types de risques sont assortis à l’assimilation du terrorisme à une guerre. Le premier type de risque est celui des réponses déraisonnables au terrorisme (A). Le deuxième type de risque est celui de la guerre sans fin (B).
La tentation de réponses déraisonnables
Entre l’emphase guerrière et l’antijuridisme, il n’y a qu’un pas à franchir. Cette première tentation demande à être précisée.
En effet, des restrictions aux droits et aux libertés en vue d’une lutte plus efficace contre le terrorisme peuvent très bien avoir une justification libérale, puisque la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales sont des motifs de limitation des libertés et des droits prévus par la CESDH et que des motifs comparables ne sont pas moins protégés par le Conseil constitutionnel en tant notamment qu’« objectifs de valeur constitutionnelle ». Et il ne suffit pas qu’une mesure ait une justification libérale, encore faut-il qu’elle soit définie par le droit d’une manière qui ne soit pas disproportionnée, à tout le moins, par rapport au but poursuivi.
Cette approche, libérale, est résolument distante de l’antijuridisme. L’antijuridisme en partant du principe selon lequel l’invocation de l’état de droit équivaut à des « arguties juridiques », relativise le principe même de la limitation du pouvoir (policier, étatique) qui est au fondement de l’état de droit et qui exige de regarder les choses au cas par cas. Ou, plus exactement, l’antijuridisme suggère que ce principe est un luxe. À partir de là, tout est possible, comme le rétablissement de la « loi des suspects » pour les « fichés S ».
Une guerre sans fin ?
L’idée de « guerre » est en général associée à celle d’une « fin de la guerre ». Et cette fin est souvent identifiée à des dispositifs juridiques : un traité de paix entre états, un accord de paix, un dispositif de réconciliation nationale, une scission…
Dans le cas du terrorisme contemporain, ce schéma peut être inopérant (B. Manin) en raison du « caractère décentralisé » des organisations terroristes et la forte autonomie des acteurs ou des sympathisants locaux : on l’a vu certains terroristes peuvent avoir un simple lien numérique d’allégeance à Daesh. Cette « décentralisation » emporte elle-même une « dispersion de la menace » qui a deux importantes conséquences :
- en premier lieu, cette dispersion « implique qu’aucun démantèlement d’un groupe terroriste particulier (…) ne garantirait la fin des dangers liés au terrorisme djihadiste » ;
- en second lieu, cette dispersion « rend extrêmement difficiles les compromis politiques » (3).
———-
(1) « La notion de terrorisme est notoirement difficile à définir. On peut cependant discerner un noyau commun aux différentes définitions analytiques du terrorisme. Ce noyau comporte deux éléments. Les actes terroristes sont des actes de violence (1) commis contre des civils ou des non-combattants, et (2) conçus pour avoir un impact sur des publics plus vastes que les victimes directes. Ces publics plus larges, ainsi que les effets recherchés pour chacun d’eux, sont différenciés. Les actes terroristes visent d’abord à intimider l’adversaire, en instillant la peur chez lui. Mais ils ont aussi pour fin d’encourager et de mobiliser des soutiens potentiels en exposant au grand jour les faiblesses de l’adversaire, et en amenant celui-ci à réagir de façon excessive, suscitant ainsi une opposition en retour. Enfin, un troisième objectif est d’inspirer chez les partisans déjà gagnés à la cause le désir d’imiter l’action commise. Les caractéristiques matérielles de l’acte reflètent l’importance donnée à ces différents effets sur les perceptions publiques. Les terroristes choisissent leurs cibles et leurs modes d’action de façon à obtenir la plus large publicité. Les caractéristiques du terrorisme ainsi compris sont indubitablement présentes dans les attentats de la dernière décennie » (Bernard Manin).
(2) Ce point renvoie à la célèbre distinction « ami-ennemi » comme critère du politique (Carl Schmitt) et à la célèbre déclinaison qu’en avait donnée le philosophe Julien Freund lors de la soutenance de thèse de Jean Hippolyte, dirigé en thèse par Raymond Aron.
Aux objections de Julien Freund lui faisant valoir que sa critique de la distinction schmittienne était naïve, Jean Hippolyte répondit :
− « Sur la question de la catégorie de l’ami-ennemi, si vous avez vraiment raison, il ne me reste plus qu’à aller cultiver mon jardin. »
Réponse célèbre de Julien Freund :
− « Écoutez, Monsieur Hippolyte, vous avez dit […] que vous aviez commis une erreur à propos de Kelsen. Je crois que vous êtes en train de commettre une autre erreur, car vous pensez que c’est vous qui désignez l’ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d’ennemis, nous n’en aurons pas, raisonnez-vous. Or c’est l’ennemi qui vous désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d’amitiés. Du moment qu’il veut que vous soyez son ennemi, vous l’êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. »
Réponse célèbre de Jean Hippolyte :
− « Dans ce cas, il ne me reste plus qu’à me suicider. »
(3) « Supposons que les pays visés parviennent à un compromis, impliquant des concessions de part et d’autre, avec la direction d’Al-Qaïda, un tel accord, passé avec des acteurs dont le contrôle sur leur organisation est incertain, n’offrirait pas une garantie suffisante pour que les pays cibles renoncent à leurs dispositifs de sécurité ».
Nouvelles simulations à venir…
Le Grand Oral du CRFPA. La préparation (II)
Il convient de distinguer la préparation générale de l’exercice Grand Oral de la préparation de l’épreuve le jour de l’examen.
I. Préparation générale
Une bonne préparation individuelle au Grand Oral devrait commencer par une réappropriation pendant l’année préparatoire des catégories catégories politiques et philosophiques des libertés fondamentales (culture politique et philosophique), par une replongée dans les fondamentaux du droit (culture juridique) avant une plongée dans le droit des libertés fondamentales (culture des droits et des libertés fondamentaux). Un travail de fond qui s’accompagne d’une veille sur les libertés et le droit dans le débat public.
Réappropriation des concepts politiques et éthiques fondamentaux du droit (culture politique)
Les Notions politiques
L’Autorité
Le civisme
La communication
La Démocratie
La Délation
L’Etat
L’égalité
L’esclavage
La fraternité
Le Gouvernement
L’Idéologie
L’Individualisme
La Justice, l’équité
La Laïcité
La Légitimité
Le Communautarisme
Le Libéralisme
La Liberté
La Morale
Le Multiculturalisme
Le Nationalisme
La Neutralité (de l’État)
L’Ordre
L’Ordre moral
Le Pluralisme
Le Pardon
La Police
La Politique
Le Pouvoir
La Raison d’État
La République
La Souveraineté
La Tolérance
Le Totalitarisme
L’Utilitarisme
Les Valeurs
La liberté
La Nation, l’Etat-Nation
La Peuple
La Raison d’Etat
La Représentation
La République
La séparation des pouvoirs
La souveraineté
Le suffrage universel
Le totalitarisme
Le terrorisme
Les notions politico-juridiques
L’État de droit
Le crime contre l’Humanité
Les droits des minorités, les droits culturels
Les droits de l’enfant
Les droits de l’étranger
Les Droits de l’Homme
Le droit nature, le droit positif
Les droits des femmes
Le droit d’ingérence
Le génocide
Guerre et Paix
La loi
Le pouvoir discrétionnaire
Les notions économiques et sociales
L’aliénation
Le capitalisme
L’économie de marché
Le commerce
La concurrence
Le développement
La famille
Le Genre
L’identité
L’opinion publique
La propriété
La société
La société civile
Le travail
Les doctrines et idéologies
L’altermondialisme
Le bonapartisme
Le colonialisme
Le communisme
Le conservatisme
L’élitisme
Le fascisme
Le gaullisme
La décolonisation
Le féminisme
Les Lumières
Le populisme
Le racisme
Le stalinisme

Revenir aux fondamentaux du droit (culture juridique).
Il s’agit de revenir aux fondamentaux de l’histoire du droit français, du droit constitutionnel (essentiellement le droit constitutionnel de la Cinquième République), du droit civil, du droit administratif, du droit international, des institutions européennes et du droit européen, du droit pénal, du droit social, c’est-à-dire au fond une partie du programme de L1 et L2 en droit.
En effet, ce n’est pas un hasard si l’enseignement des Libertés fondamentales est dispensé seulement en 3e année de droit, qu’il y est obligatoire et qu’il est considéré comme l’un des cours fondamentaux. Plus précisément, ce qui rend le Grand Oral de Libertés fondamentales particulièrement « pernicieux », c’est qu’il révèle très vite les grosses lacunes caractéristiques de la culture juridique et politique des candidats.
Culture juridique historique
Esprit concret et stratège. Du mois de décembre de l’année – 1 à la fin juin de l’année du CRFPA, l’on dispose de 28 semaines. Chaque semaine, l’on s’accorde deux heures pour lire et « ficher » une trentaine de pages de L’histoire des institutions et des faits sociaux de P. C. Timbal. de très anciennes éditions (jusqu’en 1960-1970), simples et claires, peuvent parfaitement faire l’affaire. Il suffira de relire ses fiches à l’automne, au moment du CRFPA.
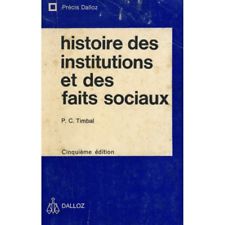
Culture juridique du barreau et de la justice
Celles des fiches de culture juridique et historique (voir paragraphe précédent) se rapportant à la justice ne seront pas moins utiles ici.
La lecture des Grandes plaidoiries des ténors du barreau (livre de poche) permet un loisir lettré sur un certain nombre de grands procès.

Les stages faits en cabinets d’avocats auront permis d’engranger un capital culturel relatif aux gens de justice, à leurs codes et à leurs usages. Spécialement ceux des avocats : Devoirs professionnels : Probité : Respect du serment — Vie privée — Dettes et engagements. — Engagements compromettants — Secret Indépendance : Affaires étrangères à la profession — Mandats, dépôts et comptes — Mandats ad litem ; auprès des officiers ministériels — Recherche de clientèle Désintéressement : Honoraire de l’avocat – Devoirs envers le confrère – Réclamations contre l’avocat – Réclamations d’honoraires – Modes de paiement – Reçus d’honoraires Confraternité : Ancienneté — Appui réciproque — Communication des pièces… Vie professionnelle : Le cabinet de l’avocat – L’avocat à l’audience – La modération – Devoirs envers le confrère Libertés de l’avocat : dans l’exercice professionnel – à l’égard du client, de l’adversaire, des témoins, des experts, irresponsabilité, poursuites.
Veille sur les libertés et le droit dans le débat public
Les libertés fondamentales, et plus généralement le droit, sont constamment convoqués dans le débat public de différentes manières :
– des procès ayant un certain écho médiatique ;
– des initiatives législatives (propositions de loi et projets de loi) ;
– des décisions (juridictionnelles ou non) remarquées ou controversées ;
-des événements d’actualité politique et sociale ayant une importante dimension ou résonance juridique.
L’expérience montre que les réseaux sociaux ne permettent pas vraiment d’avoir une bonne veille sur ces quatre registres grâce aux réseaux et médias sociaux, pour une raison : les usages des réseaux et médias sociaux sont « tribalisés », en ce sens que l’on ne s’y fixe en général que sur ses propres centres d’intérêt. Un abonnement au Monde (même électronique) est un peu cher et pas indispensable pour le CRFPA. En revanche une lecture quotidienne d’Aujourd’hui fait l’affaire.

La révision proprement dite des libertés et droits fondamentaux
Dans la phase de révision des Libertés fondamentales proprement dites, le candidat doit s’efforcer de ne pas se disperser ou se perdre dans plusieurs manuels. De la même manière, l’idée de travailler dans le manuel le plus exhaustif peut se révéler contre-productive pour deux raisons : parce que l’on finit par ne plus y distinguer l’essentiel de l’accessoire ; parce que, comme cela a été expliqué au point I, ce n’est certainement pas l’encyclopédisme des candidats qui est évalué au Grand Oral.
L’ouvrage qui doit servir de support à la révision doit être le plus à jour possible du droit positif. Il n’est pas inutile de savoir que les ouvrages universitaires sont en général édités tous les deux ans – il vaut donc mieux travailler sur la dernière édition – et que certaines rééditions ne sortent qu’en novembre ou en décembre, c’est-à-dire à un moment où tout ou presque est fini !
L’entraînement à l’expression orale
La préparation individuelle du candidat au Grand Oral passe également par un travail régulier sur son expression orale et sur sa forme d’éloquence. Il s’agit concrètement pour le candidat, de s’exercer régulièrement seul devant une glace et avec un magnétophone.
L’objectif de cette préparation est de permettre au candidat : 1° de savoir « gérer » sa voix, sa respiration afin que, le jour J, son exposé soit « fluide », audible, « musical » ; 2° de savoir quel volume de notes il lui faut pour tenir dans la durée de l’exposé devant le jury.
II. Préparation de l’épreuve le jour du Grand Oral
Nombre de candidats au Grand Oral ne semblent pas avoir idée de la nécessité pour eux de gérer le temps de préparation qui leur est imparti. Il convient pourtant de se fixer :
- un temps pour l’analyse du sujet, le dégagement des faits, de la procédure, de la question de droit s’il s’agit d’un cas pratique (une feuille de notes);
- un temps pour l’identification des questions pertinentes sur le sujet (une feuille de notes) ;
- un temps pour l’identification de l’actualité du sujet (une feuille de notes) ;
- un temps pour la recherche des références juridiques au regard desquelles il convient de composer :
– les normes constitutionnelles de référence (une feuille de notes avec une distinction entre le statut de ces normes dans le bloc de constitutionnalité et leur portée normative).
– les normes conventionnelles de référence (une feuille de notes avec une distinction entre le statut de ces normes dans les conventions internationales et leur portée normative).
– les normes législatives et réglementaires pertinentes (une feuille).
Nota bene : De nombreux candidats n’ont pas le réflexe de consulter systématiquement certains codes (code civil, code administratif, code pénal) quelque soit leur sujet, pour être sûr de ne pas passer à côté d’une référence importante. Surtout, certains candidats peu inspirés par un sujet n’ont même pas l’idée d’aller consulter les index de certains codes pour identifier par cette voie les normes de référence !
- un temps pour la préparation de sa composition (idées, plan) ;
- un temps pour relire ses notes, penser à ses transitions et à ses enchaînements – toutes choses qui ne s’écrivent pas – relire encore ses notes pour pouvoir se les approprier et les restituer avec naturel ou un semblant de naturel.
Important ! Cette proposition de consigner dans une feuille séparée chacune des étapes de la préparation de son intervention présente au moins deux avantages :
+ Cela évite de se perdre dans ses propres notes comme cela arrive trop souvent.
+ Cela permet de disposer d’une soupape de sortie dans le cas où l’on n’a pas eu le temps de faire un plan satisfaisant ou un plan tout court ; l’on aura malgré tout de quoi faire un exposé qui, à défaut d’être structuré en deux parties, au moins sera clair.
SAVOIR-FAIRE : LE JOUR J
I- La préparation en loge
Elle doit consister en 3 étapes.
L’analyse du sujet
Dans les 15-60 secondes qui suivent le tirage, le candidat doit être fixé sur le type de démarche intellectuelle qu’il doit suivre (voir plus haut) :
selon qu’il s’agit d’un sujet théorique ;
selon qu’il s’agit d’un commentaire ;
selon qu’il s’agit d’un cas pratique.
L’analyse des documents
Le candidat doit ensuite :
– repérer les écrits les plus utilisables, c’est-à-dire les codes les plus pertinents, les juris-classeurs les plus pertinents ; il faut éviter d’être submergé par des livres ou des documents, les doublons documentaires.
– Exploiter les index des codes.
Dans le cas des IEJ qui accompagnent le cas pratique d’un document annexe, le candidat doit commencer par lire et comprendre ce document annexe pour savoir notamment si ce document contient des informations qui vont ou non dans le sens de la thèse qu’il lui est demandé de défendre. Et, d’ailleurs, le candidat devra dire dans son introduction : 1. l’objet du cas pratique ; 2. dire au jury qu’à l’appui de sa réflexion il lui a été donné tel ou tel document (il faut présenter ce document et dire dans quel sens il va) ; 3. Dire l’actualité de la problématique du cas pratique et non pas du document annexé au cas car ce n’est pas un commentaire de texte que l’on vous propose ! 4. annoncer son plan de résolution du cas pratique.
La prise de notes
Elle doit être systématique ; autrement dit à chaque type de notes (normes constitutionnelles, normes conventionnelles, normes législatives, fond, procédure, etc.) doit correspondre une feuille ou des feuilles distinctes.
Les notes relatives aux normes fondamentales doivent être classées dans le respect de la hiérarchie des normes (1. normes constitutionnelles ; 2. normes conventionnelles ; 3. normes législatives).
Ne pas écrire au verso de ses feuilles ; cela peut être très compliqué à gérer ensuite.
Écrire au crayon à papier ; c’est plus simple et plus propre d’avoir des notes gommées plutôt que des notes raturées ou recouvertes de blanc partout.
II- L’exposé devant le jury
Remarques générales
Comment faire pour être certain de ce que le temps imparti ne sera pas dépassé ? En faisant des simulations pour savoir le volume de notes dont on a besoin pour tenir pendant 10-15 mn.
Le temps imparti aux candidats a-t-il un caractère « absolu » ? Non. Ce qui compte : c’est de ne pas être coupé parce que l’on « déborde » ; c’est de ne pas s’interrompre trop tôt parce que cela voudra dire que votre exposé aura été aride ou superficiel (une marge de 2 mn est encore convenable)
La maîtrise corporelle
Le trac : le candidat doit donner le sentiment de maîtriser le sujet. Des exercices de respiration abdominale avant de se présenter devant le jury permettent de dissiper les tensions corporelles.
La tenue. Elle doit être adaptée. Il faut éviter tout ce qui peut bloquer la respiration et tenir compte de la température ambiante.
La posture, le maintien. Éviter des balancements de jambes ou des pieds en éventail, autant de signe de nervosité, de relâchement ou de désinvolture. – Les mains doivent être libres et ….visibles sur la table : éviter de manier un stylo ou des feuilles pendant que l’on s’adresse au jury – il faut donc plutôt faire glisser ses feuillets au fur et à mesure de son exposé.
La voix. Il faut articuler (il est encore temps d’apprendre à le faire !) et porter sa voix d’une manière pertinente (ni trop fort, ni trop bas).
La langue utilisée doit être soutenue, claire, précise, didactique.
III- La conversation avec le jury
La nature des questions du jury
Les questions du jury peuvent se répartir entre 3 catégories :
Les questions-objections ; Il faut toujours commencer par dire que l’on comprend l’objection avant d’expliquer la raison pour laquelle l’on pense « autre chose ».
Les demandes de précisions ou de renseignements complémentaires ; ces précisions doivent être apportées « tranquillement ». Si ce sont des précisions sur des choses que vous avez dites, alors répétez-vous (« ce que j’ai voulu dire, c’est que…. »).
Les questions de connaissances. Si vous savez, répondez « tranquillement ». Si vous ne savez pas, ne dites pas « je ne sais », dites plutôt : « je ne suis pas certain(e) d’avoir la réponse précise à cette question mais [mutatis mutandis] cette question me fait penser à [invoquer une règle une procédure comparable sur laquelle vous pensez être plus sûr(e)] ».
Attention : certaines questions du Jury renvoient à des enjeux sur lesquels (l’avortement, l’euthanasie, le mariage homosexuel, la lutte contre le terrorisme, l’entrée et le séjour des étrangers, etc.) plusieurs opinions, plusieurs points existent ou sont envisageables. Il vous faut savoir être libéral c’est-à-dire :
Commencer toujours par montrer que vous savez que cette question met aux prises plusieurs points de vue ou qu’elle divise le corps social.
Ensuite savoir montrer les termes rationnels et raisonnables du problème (la tension entre la souveraineté de l’État et les droits des personnes dans le cas de l’immigration ; la tension entre ordre public et libertés dans le cas du terrorisme ; la tension entre la liberté d’expression et le droit au respect des croyances religieuses dans l’affaire des caricatures de Mahomet ; la tension entre le droit à l’auto-détermination des personnes et la difficulté d’objectiver la volonté de mourir chez une personne souffrante dans le cas de l’euthanasie.
Ce n’est que dans un troisième temps que vous pouvez dire « qu’à titre personnel » vous « pencheriez plutôt vers telle point de vue, vers telle solution ». Mais il vous faut savoir ajouter une petite pointe de modestie et une conclusion libérale : « C’est le point de vue vers lequel je balance actuellement mais il est possible que ce point de vue évolue parce que ce sont des questions complexes ».
La règle d’or n° 1. Écouter attentivement le jury.
Cela veut dire qu’il ne faut jamais couper la parole à un membre du jury. C’est vrai que cela ne se fait pas de couper la parole !
Cela veut dire aussi qu’il faut avoir ce que les comportementalistes appellent « une attitude d’écoute ». Dans cette perspective, il faut éviter de faire des mimiques ou des moues, de jouer fébrilement avec son stylo, ses feuilles. Il faut tout simplement imiter le Penseur de Rodin (en gardant cependant le corps droit c’est-à-dire sans être voûté ou courbé)
La règle d’or n° 2. Ne jamais agresser le jury.
Si l’on n’a pas compris la question ou si l’on n’est pas sûr de l’avoir comprise, il faut la reformuler : « Pardonnez-moi M. le président, je voudrais être sûr(e) d’avoir compris votre question. Vous me demandez bien de dire si…. ».
Si votre formulation correspond à l’idée du membre du jury, il vous répondra « Oui c’est bien ce que je vous demandais ».
Si votre formulation ne correspond pas à l’idée du membre du jury, il vous répondra « Non ce que je vous demandais …. » et vous, vous enchaînerez par « Je vous prie de m’excuser [et non pas « Je m’excuse ! »], j’avais en effet mal compris… » et vous ferez ensuite votre réponse.
Si un membre du jury vous demande d’expliquer un passage de votre communication, vous ne devez pas vous démonter et penser que tout est foutu ni développer la prétention de croire que votre interlocuteur est « bête » car après tout il est possible que vous vous soyez mal exprimé ! Vous répondez « tranquillement ».
Extraits de bons échanges au Grand Oral
Le jury. Ne pensez-vous pas que, à cause de l’ambiance de peur instaurée par le terrorisme nous sommes en train de marcher en direction d’un durcissement de la loi vis-à-vis des libertés ?
Le candidat. Je dirais d’abord qu’il est indiscutable que, depuis le « 11 septembre » en particulier, tous les États démocratiques ont révisé leurs législations afin de doter la police et les juges de plus de pouvoir dans la lutte contre le terrorisme. La première question qu’il faut se poser est de savoir si les motifs qui fondent ces textes sont légitimes. Or de deux choses l’une : ou bien l’on considère que le terrorisme existe ou que le 11 septembre a existé, alors il n’est pas illégitime qu’un État de droit se dote de moyens juridiques ; ou bien l’on considère que le terrorisme ou le 11 septembre n’ont pas existé ou ne sont pas si graves, alors va-t-on considérer que les États démocratiques n’étaient pas fondés à réagir.
Une fois que l’on admet que le but poursuivi par les législations en cause est légitime, il reste encore à savoir si les restrictions aux libertés prévues par ces législations sont nécessaires et proportionnées au but poursuivi. C’est ici que l’espace de débat est très grand et où la discussion est très difficile puisque l’on n’a pas nécessairement les moyens de démontrer rationnellement que les nouvelles prérogatives dont la police et les juges disent avoir besoin, et qui leur sont ainsi accordées, ne servent à rien.
Commentaire. La réponse est courte. Elle est structurée d’une manière qui laisse évidemment apparaître que le candidat sait comment raisonner sur ce type de questions. Elle est circonspecte, puisque le candidat s’attache d’abord à montrer la difficulté de la question plutôt qu’à dire « c’est scandaleux » ou « c’est pas scandaleux ».
————————————————————————-
Le jury. Ne pensez-vous pas que le secret des sources des journalistes devrait être garanti par la Constitution comme en Suède ?
Le candidat. Sur le plan symbolique c’est en effet quelque chose de marquant. Mais sur le plan juridique la portée d’une constitutionnalisation est limitée pour deux raisons : d’abord parce que la Suède est partie à la Convention européenne des droits de l’homme et que le secret des sources des journalistes, tel qu’il est garanti par cette Convention s’impose à sa législation interne ; d’autre part parce que les juristes savent bien que ce qui compte c’est la manière dont un principe juridique ou un droit – qu’il soit protégé constitutionnellement, conventionnellement ou par la loi – est mis en œuvre au niveau inférieur, soit par le législateur, soit par les juges dans l’exercice de leur pouvoir d’interprétation des textes.
De quels codes faut-il se munir le Jour J ?
Cette question comprend deux aspects :
Il existe sur le marché, des ouvrages appelés « codes » (code constitutionnel, code de la convention européenne des droits e l’homme, code administratif, code de la communication, code de la fonction publique) et qui sont une recension offerte par des éditeurs juridiques de textes applicables à telle ou telle activité ou secteur d’activité. C’est auprès de son IEJ que chaque candidat doit vérifier si ces « codes non-officiels » sont également accessibles aux candidats au Grand Oral.
En toute hypothèse, comme l’on ne saurait mobiliser une fourgonnette de Codes pour le Grand Oral, il convient d’identifier ceux des codes que l’on ne peut pas ne pas avoir par avec soi le jour du Grand Oral.
a) Les codes officiels indispensables :
– Code civil
– Code pénal
– Code de procédure pénale
– Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
– Code général des collectivités territoriales
– Code de procédure civile
– Code de la santé publique
– Code du travail
b) Les codes « non-officiels » indispensables, pour autant que ces « codes » sont admis par l’I.E.J. du candidat.
– Code de la Convention européenne des droits de l’homme.
– Code administratif : ce code est une mine d’informations pour n’importe quel sujet touchant de près ou de loi aux pouvoirs publics et au droit public (Constitution, associations, armées, carte nationale d’identité, éléments du code de justice administrative, domaine public, enseignement, étrangers, expropriation, fonctions publiques, sécurité, etc.) ; malheureusement, rares sont les candidats qui pensent à le poser sur leur table de travail et à l’exploiter.
– Code de la communication : tout ce qui touche de près ou de loin aux médias s’y trouve.
Le Grand Oral du CRFPA. Présentation (I)
Dans la perspective du Grand Oral, beaucoup de candidats aux écoles d’avocats sont obsédés par l’idée qu’il leur faut « tout savoir ». Du coup il arrive souvent que ceux des candidats qui croyaient « tout savoir » et qui n’ont pas réussi leur Grand Oral ne comprennent pas pourquoi tel ou tel candidat qui n’a apparemment pas « avalé » des encyclopédies juridiques a pu, pour sa part, faire un bon Grand oral.
Ce type de réactions est révélateur de la fausse idée que beaucoup de candidats se font de ce qu’est un bon juriste ; ils s’imaginent que le bon juriste – en l’occurrence le bon avocat – est celui qui a une connaissance encyclopédique du droit. Or cette connaissance encyclopédique est rationnellement impossible ; surtout, la connaissance des énoncés du droit n’est pas synonyme de qualité juridique, puisque cette dernière renvoie plutôt à la qualité de l’argumentation et du raisonnement éprouvés par une personne.
Ce type de réactions est révélateur de la fausse idée que beaucoup de candidats se font du Grand Oral d’entrée aux CRFPA. En effet, beaucoup de candidats s’imaginent que le Grand Oral est un moment de détection de « têtes bien pleines » alors qu’il s’agit plutôt d’un moment de détection de « têtes bien faites », c’est-à-dire de personnes ayant une bonne culture juridique, politique, économique, sociale et capable de rapporter cette culture aux modes d’argumentation et de raisonnement des juristes.
Si l’objectif du Grand Oral du CRFPA était de détecter des « encyclopédies vivantes », pourquoi mettre à la disposition des candidats des codes et autres ouvrages dans lesquels figurent les informations nécessaires au traitement des différents sujets ?
Malgré tout, la difficulté prêtée par les candidats au Grand Oral de Libertés fondamentales sanctionnant l’accès aux Écoles d’avocats n’est pas factice. Cette difficulté est imputable aussi bien à des facteurs propres aux « Libertés fondamentales » qu’à des facteurs propres à l’exercice même du Grand Oral. C’est la connaissance de ces difficultés qui doit éclairer la préparation du candidat.
I. L’identité trouble du Grand Oral
L’arrêté organisant les épreuves de l’examen d’entrée aux CRFPA fixe, s’agissant du Grand Oral de « libertés et droits fondamentaux », le programme suivant :
Origine et sources des libertés et droits fondamentaux :
- histoire des libertés : évolution générale depuis l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine en France et dans le monde ; les générations de droits de l’homme ;
- sources juridiques, internes, européennes et internationales ;
- libertés publiques, droits de l’homme et libertés fondamentales.
Régime juridique des libertés et droits fondamentaux :
- l’autorité compétente pour définir les règles en matière de libertés et la hiérarchie des normes.
- l’aménagement du statut des libertés fondamentales : – régime répressif ; – régime préventif ; – régime de la déclaration préalable ; – régime restitutif et droit à réparation ;
- la protection des libertés fondamentales : – les protections juridictionnelles (internes, européennes et internationales) ; – les protections non juridictionnelles (par les autorités administratives indépendantes, par l’effet du système constitutionnel, politique, économique et social) ; – les limites de la protection des libertés fondamentales dans les sociétés démocratiques et dans les différents systèmes politiques ; – les régimes exceptionnels d’atténuation de la protection des libertés et droits fondamentaux.
Les principales libertés et droits fondamentaux :
- les principes fondateurs et leurs composantes : – dignité de la personne humaine (droit à la vie et à l’intégrité physique de la personne, bioéthique) ; – liberté (liberté d’aller et venir, droit à la sûreté personnelle) ; – égalité (devant la justice, en matière de fonction publique, devant les charges publiques, entre les hommes et femmes, entre Français et étrangers) ; – fraternité ;
- les droits et libertés de la personne et de l’esprit (liberté d’opinion, liberté de croyance, liberté d’enseignement, liberté de communication) ;
- les droits et libertés collectifs (association, réunion, liberté syndicale, droit de grève) ;
- les droits économiques et sociaux (droit de propriété, liberté du commerce et de l’industrie, droit à la protection de la santé, droit aux prestations sociales, droit à l’emploi) ;
- les droits du citoyen (droit de vote, liberté des partis politiques, droit dans les relations avec l’administration) ;
- la laïcité.
Or ce programme veut à la fois tout dire et… pas grand chose !
Il veut dire que l’objet du Grand Oral ce sont : les aspects philosophiques, politiques, juridiques de la démocratie, du libéralisme politique et de l’économie de marché.
Il ne dit pas grand chose dans la mesure où il ne préfigure pas le type d’exercice ou de problématique que le candidat au CRFPA devra « gérer » au Grand Oral. Cela veut dire que l’on peut très bien avoir « bachoté » un Manuel, un Traité de « libertés fondamentales » ou des encyclopédies entières et « se planter » au Grand Oral. Et pour cause :
– l’on peut avoir bien bachoté et ne pas savoir mettre ses informations au service de l’exercice que l’on doit traiter au Grand Oral.
– l’on peut avoir bien bachoté et ne pas être au courant de l’actualité politique, économique et sociale alors que cette actualité est utile pour mettre en évidence « l’actualité du sujet » et qu’elle peut être sollicitée par le jury au cours de la discussion. Il ne faut pas l’oublier : les tribunaux sont des lieux qui témoignent de la vie tout court ; on y parle donc politique, économie, société, mœurs, etc.
Exemple : « L’enfer c’est les autres ». Commenter. – Exemple : « Le colonialisme, atteinte aux droits de l’homme ».
Ces deux sujets ne correspondent à aucun chapitre d’un manuel de Libertés fondamentales. Pourtant, ce sont des sujets d’actualité qui intéressent néanmoins le droit des libertés fondamentales. Le colonialisme renvoie ainsi à deux séries de préoccupations en rapport avec les libertés fondamentales, les unes sur le principe même de la colonisation (I) les autres sur le droit colonial (II). Le principe de la colonisation et les théories racistes (I-A) ; le principe de la colonisation et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (I-B) ; le droit colonial, un droit inégalitaire par essence (II-A) ; le droit colonial un droit attentatoire à la dignité de la personne humaine (II-B).
– l’on peut avoir bien bachoté son « droit des libertés fondamentales » et être très faible en droit constitutionnel, en droit civil, en droit administratif, en droit pénal, en droit social. Or les cas pratiques ainsi d’ailleurs que les dissertations proposés au Grand Oral sont d’authentiques objets de droit civil, de droit administratif, de droit pénal, de droit social mais des objets sur lesquels se greffent des enjeux intéressant la protection des libertés et des droits fondamentaux.
Exemple : « Le juge d’instruction a-t-il trop de pouvoirs ? ». Ce sujet renvoie au droit pénal, à la procédure pénale, à la CESDH, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, au statut des magistrats. Or ce sujet sera d’autant plus « facile » au candidat qu’il aura une bonne culture de base en droit pénal, en procédure pénale.
Autrement dit, le Grand Oral exige des candidats cinq types de ressources intellectuelles :
– Le candidat doit avoir une culture juridique générale, recouvrant notamment les matières fondamentales des trois premières années de droit.
– Le candidat doit avoir une solide maîtrise de la nomenclature des droits et des libertés.
– Le candidat doit démontrer le jour de l’examen sa capacité de mettre en évidence les aspects droit constitutionnel, droit administratif, droit civil, droit pénal, droit international, etc. de son sujet.
– Le candidat doit démontrer qu’il maîtrise les modes d’argumentation (argumentation juridique – argumentation de type « moral », sociologique ou philosophique) et les méthodes d’interprétation des juristes, qu’il s’agisse de méthodes générales (interprétation littérale, interprétation téléologique, interprétation systémique, interprétation fonctionnelle) ou de méthodes propres à certains sous-systèmes de normes (ex. : interprétation stricte de la loi pénale).
– Sur des sujets « très juridiques », le candidat doit pouvoir éclairer le problème dont il est saisi à partir de certains principes d’argumentation propres aux libertés :
a) le principe de la prééminence du droit ou de l’État de droit ;
b) le principe de la hiérarchie des normes ;
c) le principe selon lequel « la liberté est le principe et la restriction l’exception » ;
d) le principe d’effectivité des libertés (il faut garantir aux personnes des droits concrets et non des droits théoriques) ;
e) le principe de proportionnalité entre la restriction d’une liberté et l’objet poursuivi à travers cette restriction.
II. L’objet nébuleux du Grand Oral
La plupart des candidats aux écoles d’avocats n’ont pas véritablement l’expérience d’une conversation avec un jury. Or cet exercice n’a pratiquement aucun rapport avec les exposés auxquels les étudiants avaient été habitués en Travaux dirigés, ni même avec les oraux de fin de semestre. Il importe donc pour le candidat de savoir à quoi sert le Grand Oral et en quoi il consiste.
La vocation du Grand Oral
Cette épreuve doit permettre au jury de savoir si le candidat possède les qualités que tout justiciable est en droit d’attendre d’un bon avocat, c’est-à-dire : le bon sens ; la force de conviction ; la clarté du raisonnement ; le sens critique ; l’ouverture d’esprit ; la capacité d’écoute ; la réactivité face à des situations imprévues ; la faculté de s’adapter à ses interlocuteurs ; une souplesse et une vivacité de la pensée.
La consistance du Grand Oral
Le Grand Oral est composé de deux parties : l’exposé liminaire du candidat d’une part et la discussion avec le jury proprement dite.
Le jury
Le Grand Oral a lieu devant un jury composé de trois personnes dont un magistrat, un professeur de droit (ou un maître de conférences) et un avocat. Cette composition en elle-même est signifiante.
- Le candidat s’adresse à des juristes: dans cette mesure il doit s’attacher à donner au jury le sentiment qu’il a tout ou presque tout pour faire partie de la « communauté des juristes » : la même culture juridique de base, les mêmes modes d’argumentation juridique, les mêmes références intellectuelles, la même rhétorique.
- En même temps, le candidat s’adresse à des juristes qui n’ont pas le même rapport au droit. L’un des membres du jury a théoriquement du droit une approche doctrinale ; les deux autres en ont une approche plus pratique et pragmatique puisqu’ils sont des acteurs de procès opposant généralement des prétentions contraires, avec d’ailleurs une différence entre magistrat et avocat liée au fait que l’un doit « dire le droit » tandis que l’autre cherche à le faire dire dans l’intérêt de son client.
- Toujours est-il que le bon Grand Oral est celui au cours duquel le candidat traite de son sujet et répond au jury en prenant également en considération les « nuances mentales » qui peuvent séparer les trois juristes qu’il a en face de lui. Le candidat doit supposer :
que le Professeur de droit ne sera pas indifférent à sa rigueur analytique et à sa faculté à remonter jusqu’aux principes ;
que le magistrat ne sera pas indifférent à sa familiarité avec le travail, la jurisprudence de ses pairs ;
que l’avocat ne sera pas indifférent à son « pragmatisme »;
qu’en toute hypothèse, les trois membres du jury ne seront pas indifférents à sa force de persuasion et à son humanité ou à son humanisme.
L’exposé liminaire
Cet exposé peut porter, selon les Instituts d’études judiciaires (IEJ), sur un sujet théorique, sur un cas pratique ou sur un commentaire d’un texte (soit un texte de caractère juridique, soit un texte de caractère général et touchant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel).
Cet exposé doit faire ressortir la qualité de la réflexion personnelle du candidat sur le sujet choisi. Et cette qualité est éprouvée aussi bien quant au fond que quant à la forme.
- Sur le fond :
. le candidat doit faire apparaître qu’il a compris le sujet ou qu’il a discerné les idées essentielles relatives au sujet ;
. en même temps, le candidat doit s’attacher à exposer une réflexion personnelle sur le sujet proposé ou sur les idées développées dans le texte proposé, lorsqu’il s’agit d’un commentaire de texte.
- Sur la forme :
. le candidat doit décliner sa pensée avec un souci de logique et de cohérence ;
. le candidat doit s’exprimer avec clarté, avec un sens didactique, notamment par une invocation systématique des références textuelles ou jurisprudentielles qui viennent à l’appui de chacun de ses arguments ;
. l’exposé du candidat doit être « suffisamment attractif pour retenir l’attention des auditeurs » ;
. le candidat doit respecter le temps de parole qui lui est imparti ;
. le candidat doit s’attacher à ne pas lire ses notes mais s’efforcer de partir d’elles.
La discussion proprement dite avec le jury
Le « point de départ » en est l’exposé du candidat. Il ne s’agit pas d’une discussion au sens ordinaire de cette expression, mais plutôt d’une conversation, ce qui suppose notamment de la part du candidat une manière d’être : ni trop décontracté, ni trop « compassé » ; ni trop idéologue, ni exclusivement technique ; etc.
Cette discussion doit être l’occasion pour le candidat d’expliquer, de nuancer, voire de corriger ses positions initiales « avec une suffisante souplesse d’esprit sans, toutefois, renoncer systématiquement à la défense de ses options ». Une règle d’or en la matière est que le candidat « ne doit jamais perdre pied face aux questions qui lui sont posées tout en ayant l’honnêteté intellectuelle de reconnaître son ignorance lorsqu’il est incapable d’apporter une réponse pertinente à une question précise posée par un membre du jury (…) ».
Qu’est-ce donc qu’être français ?
Cette question peut être entendue de deux façons. Dans une approche juridico-légale, il s’agirait de définir le périmètre national français. De ce point de vue, être français consiste dans le fait d’avoir la qualité de national français au sens du droit. Or cette qualité est définie par les dispositions du code civil français en tant qu’elles organisent l’acquisition de la nationalité française. Toutefois, cette question est posée dans le débat public dans un autre sens. Il s’agit plutôt de savoir ce qui substantialise (sociologiquement, philosophiquement, culturellement, etc.) le lien national de cette communauté de personnes que sont les citoyens français. Ce qui est frappant dans ce débat tient du paradoxe : c’est un débat surinvesti par différents acteurs et qui brasse des affects puissants, alors qu’il est rationnellement impossible d’objectiver des « critères » immatériels de la francité.
Ancienneté et contemporanéité de la question
Cette question est à la fois ancienne et contemporaine. Elle est ancienne à de nombreux points de vue : il suffit de penser au fait que la définition légale du national français a connu des vicissitudes historiques ; il suffit de penser au fait que certaines portions du territoire français (et donc les populations concernées) ne sont françaises que depuis peu (Nice n’a été rattachée à la France que dans la deuxième moitié du XIXe siècle) ; il suffit de penser au fait que certaines portions du territoire (et donc les populations concernées) ont accédé à la souveraineté en vertu du droit à l’autodétermination des peuples (Algérie, Guinée, Comores, etc.) ; il suffit de penser au fait que certaines populations toujours françaises formellement contestent néanmoins et depuis longtemps leur appartenance à la francité (les indépendantistes guadeloupéens, les indépendantistes corses, les indépendantistes kanak).
La question de la « substance » de la francité a par ailleurs une dimension contemporaine, qui est vérifiable à travers de nombreux faits : la réunion d’une commission de la nationalité (« Commission Marceau Long ») dans les années 1980 ; les débats suscités par le fait que l’hymne national ait pu être sifflé pendant certaines manifestations sportives ; les débats relatifs à l’obligation ou non pour les sportifs sélectionnés en équipes nationales de chanter l’hymne national lors des manifestations internationales ; les débats nourris par la création en 2007 d’un ministère de « l’immigration, de l’intégration et de l’identité nationale » ; les débats nourris par le lancement en 2009 par ledit ministère d’un « grand débat national sur l’identité nationale » ; les débats sur l’opportunité et la constitutionnalité d’une extension du champ d’application de la déchéance de la nationalité
Cette inscription récente et contemporaine de la question « Qu’est-ce qu’être français » montre que cette question est structurellement liée de nos jours à différentes considérations qui sont elles-mêmes contemporaines : le fait de l’immigration et le fait que les personnes qui substantialisent cette immigration sont pour un grand nombre d’entre elles originaires de pays non-européens et/ou non-chrétiens à la différence des immigrations antérieures ; le fait de la globalisation et de la construction européenne, que certains analysent comme des facteurs de dilution du lien national.
Repoussoirs intellectuels et politiques
Rien n’est plus risqué que de prétendre répondre à une question, « Qu’est-ce qu’être français ? », qui soulève un certain nombre de difficultés intellectuelles : le risque de postuler une essence immuable et immémoriale de la francité ; le risque de mythifier le passé en imaginant que l’histoire de la francité est celle d’un « long fleuve tranquille » alors même que les Français ont pu se déchirer dans des « guerres culturelles » (les guerres de religion et la Saint Barthélémy, la guerre civile révolutionnaire et les insurrections contre-révolutionnaires, les résistances vendéennes à la République, les tensions autour de la séparation des églises et de l’État avant et après 1905) ; le risque d’« essentialiser » les populations d’origine étrangère.
Aussi, un certain nombre de « critères » théoriques de la francité sont d’authentiques repoussoirs politiques et constitutionnels. Il en est ainsi du critère tiré de l’appartenance raciale. Aucun acte de législation en France n’a jamais énoncé qu’être Français consistait dans le fait d’être Blanc. Les incapacités sociales de toutes sortes et les privations de droits qui ont pu frapper les Noirs ou les Juifs avant ou après la Révolution n’ont jamais valu définition nationale, mais statut civil et/ou civique, d’où, par exemple, l’existence de Noirs émancipés ou de « libres de couleur ». Quant au critère tiré de l’appartenance religieuse, il n’est pas plus dirimant. Qu’il y ait eu des guerres religieuses, soit. Mais elles avaient d’autant plus lieu entre des Français que la consistance symbolique, mentale et juridique du « lien national » n’est alors pas la même que celle qui se développe entre le XVIIe et le XVIIIe siècle puis tout au long du XIXe siècle et spécialement sous la Troisième République. Et qu’il ait été dit sous la Restauration que « le catholicisme est la religion des Français » ne voulait pas dire que ceux qui n’étaient pas catholiques étaient déchus de leur nationalité : ils étaient plutôt poursuivis (lorsqu’ils étaient prosélytes) voire persécutés, mais tout en étant Français. Enfin, il suffit de garder à l’esprit que le référent religieux peut difficilement servir comme critère de la définition nationale dans un état laïque. Tout au plus l’état peut-il considérer, soit une pratique administrative validée par les juges, que le fait de professer certaines idées ou opinions, religieuses (ou politiques d’ailleurs), lui interdit d’accorder la nationalité française à un étranger, sans pouvoir parallèlement déchoir de leur nationalité française les nationaux qui professeraient les mêmes opinions.
La « culture française » : oui mais laquelle ?
La « culture française » constitue-t-elle plutôt un indice ou un critère de la francité ? Une première difficulté pour répondre à cette question vient de ce que l’on peut envisager la « culture française » … sous deux angles au moins : telle qu’elle ressort des œuvres de l’esprit, avec ce que celles-ci mobilisent comme représentations et comme sensibilités, ou telle qu’elle ressort d’un supposé « art de vivre ».
Toutefois, quiconque a un esprit réaliste voudra considérer que cette expression (« culture française ») est une nébuleuse historique dans la mesure où la culture française, telle qu’elle est produite par les écrivains, les artistes, les intellectuels, n’est pas figée et se renouvelle perpétuellement. Mieux, elle donne même souvent lieu à de véritables querelles nationales : celle d’Hernani, celle relative à Ingres et à Delacroix, celle des impressionnistes, celle des écrivains et des artistes ayant fait le voyage de Berlin, de Moscou ou de Pékin, celle sur une « certaine tendance du cinéma français », etc.
De la même manière, il est difficile de caractériser « les Français » par un « art de vivre » particulier et à nul autre pareil, sans emprunter (ou risquer d’emprunter) à la controverse ou à la stéréotypie. Ainsi, rien n’est plus discuté de nos jours que la caractérisation de cet « art de vivre » par une économie singulière des relations entre les hommes et les femmes qui aurait fait que si le statut juridique des femmes françaises a durablement été discriminant, l’influence des femmes dans la société française aurait néanmoins toujours été constante (notamment à travers l’histoire des rois de France), avec cette conséquence que le féminisme n’y aurait jamais pris les allures d’une « guerre des sexes ». Quant à la stéréotypie, elle est tentante à qui voudrait soutenir que les Français ont une économie singulière du loisir qui en feraient « les champions du monde des vacances », les théoriciens de ces « vacances à la campagne » dont la peinture française a fait un thème majeur au début du XXe siècle, ou les esthètes de cet espace de sociabilité singulier qu’ils ont par ailleurs créé et que sont les cafés et les bars tabacs. Si l’UNESCO, pour sa part, a sérieusement conçu d’inscrire en 2010 au « patrimoine culturel immatériel de l’humanité » le « repas gastronomique des Français », l’état en dit modestement et sans craindre de convoquer le folklore qu’il « commence par un apéritif avec ensuite au moins quatre plats (entrée, poisson et/ou viande avec légumes, fromage et dessert) avant de se terminer par un digestif ».
Pour tout dire, l’on peut trouver autant de « théories » sur « la » culture française ou sur « l’esprit français » qu’il y a d’auteurs intéressés à commettre ce type d’élaborations politiques et intellectuelles. Et chacune de ces « théories » aura toujours une ou plusieurs faiblesses, comme le célèbre Essai sur la France d’Ernst Robert Curtius, qui n’y fait pas cas de… la langue française, pourtant si communément associée à « l’identité de la France », au « génie français », à la « culture française ».
Ce que parler français veut dire
La langue française est-elle un « critère » ou un indice de la francité ? Elle a indiscutablement représenté quelque chose de singulier ou de distinctif dans les temps où l’Europe parlait français, comme les diplomates à partir des traités d’Utrecht et de Rastadt (1713, 1714), comme les sociétaires des salons de conversation. La bonne société, en somme. Surtout, si la langue française est souvent présentée comme « invention de la modernité politique » française, c’est au prix notamment de certains raccourcis ou non-dits, y compris à propos de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, un texte plutôt « récent » d’ailleurs puisqu’il ne date « que » de 1539. Et, contrairement à une légende tenace, le texte de François Ier n’a pas imposé l’utilisation de la langue française à tous les Français contre les patois ou les parlers locaux : l’ordonnance de Villers-Cotterêts impose à l’administration et aux gens de justice seuls l’usage du français en lieu et place du latin. C’est à partir de la Révolution et tout au long du XIXe siècle, au prix de résistances certaines, que les patois et ce qu’on n’appellera « langues régionales » qu’après la Deuxième Guerre mondiale, sont les repoussoirs de la politique d’unification linguistique promue par l’état central. Une politique qui est alors, avec l’ambition d’une instruction publique (Condorcet, Lakanal, Bonaparte), l’un des versants de l’ambition promue dès 1789 d’un peuple « un et indivisible ». Une ambition de « francisation » des Français qui trouve son point d’orgue sous la Troisième République avec les lois scolaires, le culture de la grammaire, la première loi sur la « nationalité française ».
La langue française n’est pas réductible aux seuls français, puisqu’elle compte des millions de locuteurs à travers le monde. La circonstance qu’ils parlent français fait-elle d’eux « culturellement » des Français, et même seulement des « porteurs » de la culture française ? La question divise. Certains font valoir que la greffe de la langue française ne produit pas plus que des formes d’« hybridation culturelle ». D’autres pensent qu’il n’y a pas de raisons de considérer que le « colonialisme linguistique » ne serait un facteur d’aliénation culturelle que lorsqu’il s’agit de l’anglais, le français pour sa part pouvant s’auréoler du statut de « langue universelle » ou de « la langue de la liberté » dont il est affublé par une intarissable tradition culturelle et politique antérieure et postérieure à Rivarol. Cette thèse a eu son moment marxisant dans les années 1970 et 1980, avec différents intellectuels « tiers-mondistes ». Elle est nouvellement défendue dans le sillage des postcolonial studies, par différentes plumes dont celle de Léonora Miano (L’Impératif transgressif, L’Arche éditeur, 2016).
Qu’en est-il en France même, aujourd’hui ?
L’inquiétude linguistique y est manifeste. Sinon les pouvoirs publics ne finiraient-ils pas de se préoccuper de l’amour que nous sommes supposés ne plus porter à la langue française, jusqu’à développer des dispositifs de toutes sortes dans et en dehors des institutions scolaires, et pour que le législateur soit intervenu pour imposer son usage dans des espaces de communication sociale qui semblaient lui préférer d’autres langues.
L’arabe, le persan, le haoussa à l’école publique ?
Le débat sur le statut de la langue française dans l’assimilation ou l’intégration des immigrés ou des enfants d’immigrés est à la fois connexe et distinct de celui de l’amour réputé déclinant des Français pour leur langue. Les plus rigoristes en matière d’assimilation revendiquent un attachement à la langue française qui leur fait vivre comme une souffrance le fait d’entendre des personnes parler une langue étrangère plutôt que le français ou une « langue de France » dans l’espace public. Cette contrariété est néanmoins suspecte dans la mesure où elle a tendance à se fixer uniquement sur des locuteurs parlant une langue de pays dits d’immigration, et plus exactement une langue de pays ou de sociétés auxquels sont identifiés les réfractaires supposés à l’assimilation. Pour le reste, telle qu’elle ressort des taux de scolarisation dans les écoles publiques ou privées, l’effectivité contemporaine de l’obligation scolaire suggère qu’il n’est pas d’enfants de France qui ne soient formés à la langue française. Qu’ils le soient bien est une autre question.
Il peut néanmoins arriver que des libéraux donnent aux rigoristes de l’assimilation des raisons inutiles d’être contrariés. Tel fut le cas avec la récente proposition de l’Institut Montaigne visant à « développer l’apprentissage de l’arabe à l’école » au titre de… la lutte contre la radicalisation islamiste. Cette idée était proprement illogique car des parents n’envoient pas leurs enfants dans des mosquées radicales (et les adolescents qui s’y rendent n’y vont pas) pour y apprendre l’arabe mais pour… la religion. La proposition de l’Institut Montaigne était d’autant plus illogique que les auteurs de la proposition assuraient par ailleurs que la radicalisation se fait plutôt en ligne que dans les mosquées. Surtout, la proposition de l’Institut Montaigne a excité un débat mal informé ̶ puisque l’arabe est déjà enseigné dans les écoles publiques, un CAPES et une agrégation y étant voués ̶ et inutile.
Si l’état peut être encouragé à faire mieux, c’est dans le respect de deux balises : d’une part, la prééminence constitutionnelle de la « langue nationale » qu’est le français (on a exposé l’ensemble des conséquences de cette prééminence dans La langue française et la loi) ; d’autre part, la liberté des élèves et de leurs parents vis-à-vis de toute autre langue que la « langue nationale », qu’il s’agisse de « langues de France » ou de « langues étrangères ».
La seconde balise peut néanmoins être obscurcie par l’état lui-même ou par certains acteurs sociaux comme vient de le faire l’Institut Montaigne et comme ce fut le cas, dans les années 1980-1990, lorsque le nouvel engagement de l’état en faveur de l’enseignement de l’arabe fut justifié par des idées du style « ça permettrait aux enfants d’immigrés de mieux connaître leurs pays d’origine ». à ce compte, chaque enfant d’immigré devrait pouvoir se voir proposer un cours de la langue d’origine de ses parents. Au risque de querelles « communautaires » ou « mémorielles » sans fin, alors que l’enseignement de l’arabe ̶ langue parlée par des millions de locuteurs dans le monde hors de l’empire colonial français ̶ a d’abord pour lui la « surface » internationale de cette langue et sa centralité dans l’une des manières de penser le monde les plus importantes depuis plusieurs siècles ainsi que dans la période contemporaine. L’état ne devrait pas prétendre proposer une politique dynamique d’enseignement de l’arabe pour des raisons « mémorielles » ou « postcoloniales ». Il est supposé le faire parce qu’il se sent tenu d’offrir aux « enfants de France », que leurs parents soient ou non d’« origine arabe », pour les uns les moyens de pouvoir « gagner leur vie » dans des pays de langue arabe, pour les autres les moyens d’être des références françaises dans la connaissance du « monde arabe ». étant entendu que certains allieront les deux. Libre à ceux qui voudraient suivre ces cours pour des raisons identitaires de le faire à ce titre. Mais sans injonction explicite ou implicite à d’autres, spécialement pas à ceux dont la définition identitaire ne consiste pas en une revendication d’une « double culture », mais en une superposition entre leur culture française et leur mémoire des origines de leurs parents.
Oublier Renan
Ce fut une scène étrange. Lors de la cérémonie de naturalisation du célèbre Lassana Bathily. Aux cadeaux de bienvenue dans la nationalité française offerts au jeune Malien, le ministre de l’Intérieur avait cru devoir ajouter une version livresque de la fameuse conférence d’Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? étrange, en effet, que d’offrir à un naturalisé un livre que l’on imagine plus indiqué pour un… candidat à la naturalisation. D’autant plus étrange que ce cadeau participe d’une croyance très commune en France qui veut que Renan ait « théorisé » le « modèle français ».
En réalité, ce texte de Renan a eu des fonctions et des usages politiques successifs et assez différents entre le moment de son énonciation et sa réappropriation particulière par des acteurs politiques… depuis les années 1980. Une réappropriation qui lui vaut sa réduction à quelques formules … romantiques : la nation est « un rêve d’avenir partagé », « un plébiscite de tous les jours », etc. Voudrait-on être « provocateur », on pourrait se demander si les mots de Renan n’ont pas plus de résonance américaine que française. America ! America ! La ferveur unique au monde des cérémonies de naturalisation. Le fameux chauffeur de taxi africain de Dany Lafferière dans Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, qui est si ressemblant de celui croisé à Charlottesville ou à Boston. Ils sont passés, pour certains, par la France. Lui en veulent un peu. Comme toujours, à tort et à raison. Comme d’ailleurs les Français eux-mêmes, qui veulent à la fois l’égalité d’un côté, les « grands lycées », les « grandes écoles », les « grands corps » de l’autre.
Alors quoi ? La question n’est-elle pas plutôt : de quoi peuvent bien avoir peur ceux qui pensent que la France est menacée de ne plus être « la France » ? Après tout, quelque chose doit bien les départir de ceux qui pensent que la Suède est menacée de ne plus être « la Suède » ou de ceux qui pensent que le Luxembourg est menacé de ne plus être « le Luxembourg ». Cette chose propre à la « mélancolie française » n’est pas, à proprement parler, la francité mais la grandeur. Ou sa mémoire. Celle autour de laquelle communient la plupart des Français intéressés par les Journées du patrimoine. Celle dont les étrangers savent tellement qu’elle est à la fois une mémoire et une nostalgie qu’ils écrivent souvent le mot en français dans leurs œuvres.
La « diversité » de l’équipe de France de football de 1998 et de 2018 a été exaltée. Celle de l’équipe de France de football de 2010 a été honnie. La différence ? Les équipes de 1998 et 2018 ont apporté au besoin atavique des Français de se sentir une « puissance », de se sentir Grands, alors que l’équipe de France de Krisna a été d’une médiocrité honteuse pour la grandeur française. La « diversité » de l’équipe de France de l’euro 2016 est quant à elle passée inaperçue pour cette simple raison que la sélection nationale a été méritoire (une défaite presqu’absurde en finale) sans être grande. C’est dire s’il y a bipolarité des erreurs racialistes ou ethnicistes, aussi bien de la part de ceux qui s’expliquent les défaites ou l’indignité de l’équipe de France par son caractère supposément « Black-Black-Black » que de ceux qui élaborent à satiété autour de l’idée selon laquelle « la société française » n’imputerait jamais qu’aux « racialisés » les difficultés de la sélection nationale. Parlez-leur, aux uns et aux autres, de Marius Trésor, de Jean Tigana ou de José Touré. Ou bien ils savent ou bien ils ne savent pas. Que ces noms furent associés à un grand cycle de grandeur de la sélection nationale, et à travers elle de la France.

