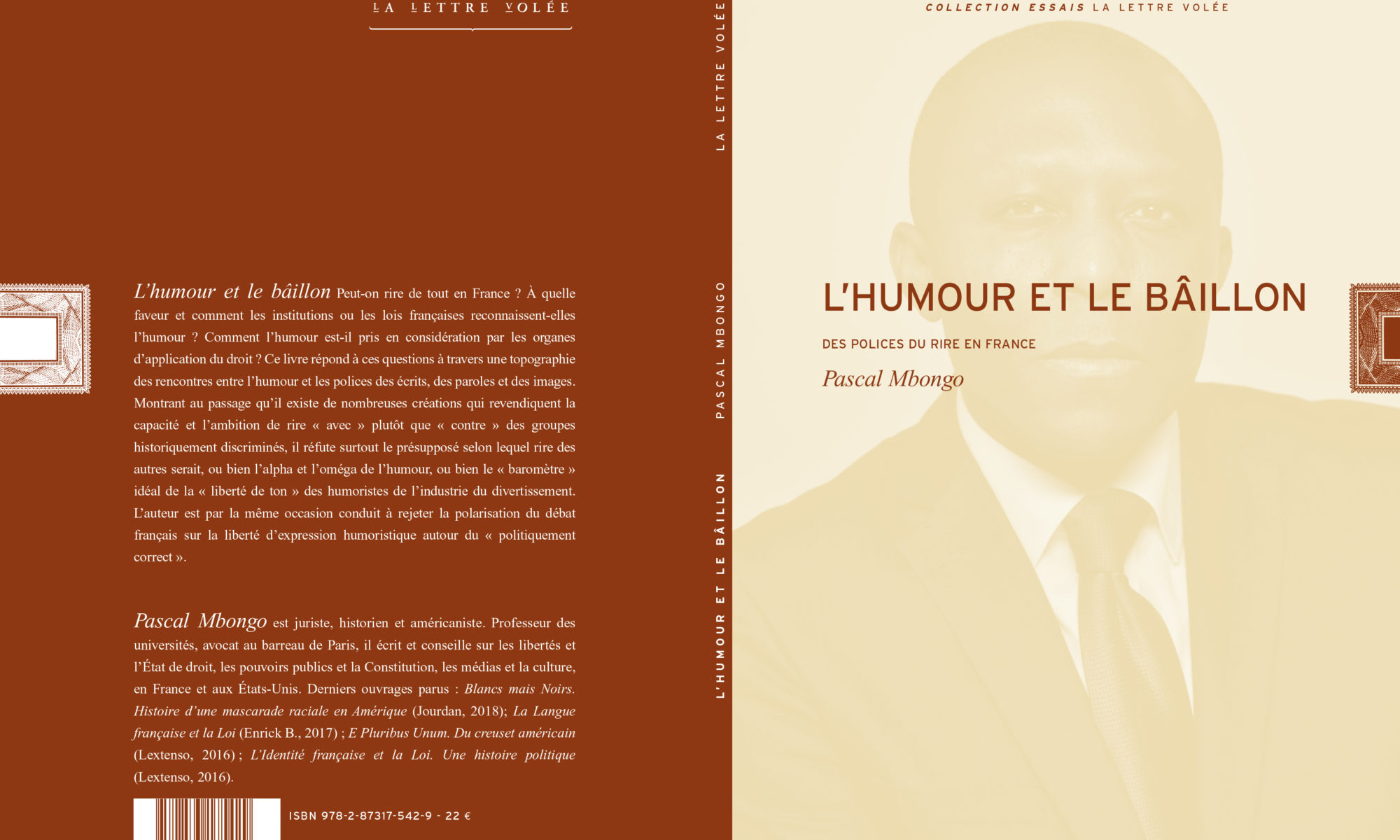Tribunal Correctionnel de Paris (6e ch.) – Audience du 2 juin 1865
Outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. – Dessins non autorisés. – colportage et livres de dessins sans autorisation. – Exercice illégal de la profession de libraire. – Détention de livres sans nom d’imprimeur. – onze prévenus.
Le Tribunal,
Donne défaut contre Poulet-Malassis et contre Blanche, non comparants, quoi que régulièrement cités, et statuant sur les chefs imputés à tous les prévenus :
A l’égard de Poulet-Malassis, ancien libraire-éditeur à Paris, après avoir encouru plusieurs condamnations pour diffamation, publication de livres obscènes et banqueroute simple, s’est retiré à Bruxelles en 1863, et s’y est livré, depuis cette époque, à la réimpression et au commerce de livres obscènes ;
Que de l’instruction, notamment de la correspondance et des pièces saisies aux domiciles de Blanche, de Sauvan et de Bayart, ainsi que des aveux faits par ces deux derniers, il résulte que Poulet-Malassis a eu, depuis l’année 1863, pour correspondants à Paris, Blanche et Sauvan, qui étaient chargés de recevoir les ouvrages qu’il leur envoyait de Belgique, d’en faire le placement et de les distribuer et de les vendre à des particuliers et à des libraires, soit à Paris, soit dans les départements ; que, tantôt ces ouvrages arrivaient à Paris, dissimulés au milieu de marchandises diverses, et tantôt ils étaient confiés à Bayart, chef de de train la compagnie du chemin de fer du Nord, qui les cachait dans sa saccoche ou de toute autre manière, puis les transportait à son domicile, où le plus souvent Blanche les faisait prendre ;
Que c’est ainsi que Blanche, au domicile duquel il a été trouvé, le 2 décembre dernier, 359 volumes, a pu distribuer et vendre un grand nombre de livres obscènes envoyés par Poulet-Malassis en provenance d’autres sources ;
Que Sauvan qui avait été l’employé de Poulet-Malassis en France, et qui depuis son départ avait continué des relations d’affaires avec lui, tout en prenant le commerce des comestibles, a reçu dans le même temps, de la Belgique, une certaine quantité d’ouvrages obscènes, qu’il échangeait avec les produits de son nouveau commerce, ou bien pour les vendre au compte de son ancien patron ou au sien propre ;
Que les ouvrages ainsi distribués et vendus depuis moins de trois ans par Blanche sont 1° etc, etc. (suit la nomenclature des ouvrages dont nous avons publié les titres dans notre premier compte-rendu de la quinzaine dernière) ;
Que les ouvrages distribués et vendus, depuis moins de trois ans, par Sauran sont notamment : Les Aphrodites, l’Ecole des filles, le Parnasse satyrique et les Heures de Paphos ;
Attendu que ces ouvrages ont un caractère d’immoralité et d’obscénité incontestables ;
Mais qu’on doit établir des différences entre eux et les partager en trois catégories : le première composée de cinq ouvrages (le jugement en donne les titres), dans lesquels les auteurs ont évité la grossièreté et l’obscénité dans le langage, pour n’exciter l’imagination et les sens que par des images lascives et licencieuses, par des scènes délirantes et par la peinture des passions honteuses et contre nature ; la seconde catégorie comprenant tous les autres ouvrages qui sont écrits dans une forme aussi offensante que le fonds pour la morale et les bonne mœurs, parmi lesquels, toutefois, il faut distinguer ceux dans lesquels toutes les parties ne sont pas également répréhensibles et ce qui composent la troisième catégorie, où les éléments ne se rencontrent notamment que dans les pages ou dans les articles ci-après désignés, savoir (suit l’indication des pages et des articles) ;
Que c’est ainsi que Blanche et Sauvan, en distribuant et vendant ces ouvrages, se sont rendus coupables du délit d’outrage à la morale publique et aux bonne mœurs, prévu et puni par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819, et qu’ils se sont encore rendus coupables du même délit, en distribuant et vendant des gravures et dessins obscènes, les uns séparés, les autres accompagnant quelques-uns des ouvrages ci-dessus indiqués ;
Que Poulet-Malassis et Bayart se sont dans le même temps, rendu complice de ce délit, le premier, en imprimant et en envoyant, de Belgique à Paris, à Blanche et à Sauvan une partie des dits ouvrages, notamment de ( suit l’indication de neuf ouvrages), sachant que ces ouvrages devaient être vendus, et donnant à ses mandataires des ordres et des instructions pour en opérer le placement en France, à son profit, et Bayart, en transportant lui-même une partie de ses ouvrages de Belgique à Paris, sachant aussi qu’ils étaient des livres obscènes destinés à être vendus, complicité prévue et punie par les articles 59 et 60 du Code pénal ;
Attendu que des faits rapportés ci-dessus, et reconnus constants, il résulte encore,
A la charge de Blanche seul, d’avoir encouru les peines portées par l’article 27 de la loi du 26 mai 1819, en vendant des ouvrages déjà condamnés et dont la condamnation était réputée comme par la publication faite dans les formes prescrites, et à la charge de Blanche et de Sauvan d’avoir contrevenu à l’article 24 du décret du 17 février 1852, en se livrant, sans en avoir obtenu le brevet, à des ventes, achat et échanges de livres, ce qui constitue le commerce de la librairie, d’avoir contrevenu à l’article 19 de la loi du 21 octobre 1814, en détenant et vendant des ouvrages sans nom d’imprimeur, tels que notamment : Les Aphrodites, l’Eole des filles, le Parnasse satyrique, et d’avoir contrevenu à l’article 22 du décret du 17 février 1852, en distribuant et vendant des dessins et gravure non autorisés par l’administration ;
Et qu’enfin, le fait par Bayart, d’avoir colporté de Belgique à Paris, et distribué dans cette ville à plusieurs personnes des ouvrages et gravures sans autorisation de l’administration, constitue, en outre, à sa charge, la contravention prévue et punie par l’article 6 de la loi du 27 juillet 1849 ;
A l’égard de Gay ;
Attendu que Gay, libraire-éditeur, qui a été condamné au moi de mois de mai 1863 pour avoir fait le commerce de livres contraires à la morale et aux bonnes mœurs, a malgré cet avertissement continué ce commerce, et même lui a donné un plus grand développement, en achetant d’abord quelques éditions à Poulet-Malassis, puis en faisant faire lui-même des réimpressions en Belgique, en répandant en France un grand nombre de prospectus pour faire connaître ces ouvrages et en les vendant à toutes les personnes qui en demandaient ;
Que ces faits de publication, de mise en vente et de vente, résultent de l’instruction, et notamment de la correspondance et des pièces trouvées au domicile de Gay et de ses co-prévenus, de la saisie et quatre-vingt-trois volumes, pratiquées le 13 janvier dernier dans le magasin de Gay et dans un sac de nuit lui appartenant, ainsi que des déclarations de Blanche et de Sauvan ;
Que les ouvrages mis en vente et vendus par lui en 1863 et 1864, sont : 1° La Guerre des Dieux, etc., etc. (ici sont les titres de vingt autres ouvrages) ;
Que parmi ces ouvrages, les uns présentant dans toutes leurs parties un caractère d’immoralité et d’obscénité qui en rend la publication dangereuse pour les bonnes mœurs et les autres… (Ce jugement produit ici la distinction faite plus haut à l’égard des ouvrages du prévenu Poulet-Malassis) ;
Qu’en mettant en vente et en vendant ces ouvrages, Gay a commis le délit prévu et puni par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 ;
Qu’il a encore commis le même délit en mettant en vente et en vendant les gravures et dessins représentant des sujets obscènes, les uns en feuilles et les autres accompagnant quelques-uns des ouvrages ci-dessus indiqués, notamment les trois suivants …. etc, etc. ;
Que des mêmes faits rapportés ci-dessus, il résulte encore que Gay a encouru les peines portées par l’art.27 de la loi du 26 mai 1819, en vendant des ouvrages déjà condamnés, etc., etc. (Comme plus haut) ;
Qu’il a contrevenu à l’article 19 de la loi du 21 octobre 1814, en détenant et vendant des ouvrages sans nom d’imprimeur… (Mêmes motifs que ci-dessus)
Et enfin qu’il a contrevenu, pour atténuer ses torts, déclaré, comme dans la précédente poursuite, que les ouvrages qu’il a imprimés et vendus sont intéressants à conserver et à connaître au point de vue de la philosophie, des mœurs et de l’histoire ; qu’il n’a pas été dans sa pensée de fournir un aliment à la corruption et à la débauche, ni même de chercher dans son commerce une nouvelle source de profits ; qu’enfin il s’est protégé par l’autorisation de réimprimer un de ses ouvrages à un nombre déterminé d’exemplaires ;
Mais attendu que, même dans ce cas exceptionnel, Gay ne s’est pas conformé aux conditions expresses qui lui avaient été imposées ; que sa bonne foi ne peut être admise, surtout après une première condamnation, quand on le voit donner à ses prospectus une aussi grande publicité et répondre indistinctement aux demandes qui lui sont faites ; que d’ailleurs, sans avoir à examiner si la science des bibliophiles est sérieusement intéressée dans cette question, il est certain que cet intérêt ne saurait jamais prévaloir sur celui de la morale publique et des bonnes mœurs, auquel il ne peut être porté atteinte sous aucun prétexte ;
A l’égard de Randon,
Attendu que le 16 décembre dernier, il a été saisi dans son domicile des ouvrages obscènes, ainsi que des albums, des photographies et des dessins représentant des sujets obscènes ; que de l’instruction et de ses aveux, il résulte qu’après avoir été employé chez un libraire pendant plusieurs années, jusqu’au mois d’avril 1864, il s’est livré pour son compte au commerce de la librairie, en achetant des livres dans les ventes ou à des commissionnaires, tels que Blanche, et en les revendant soit des libraires, soit plutôt à des particuliers ; qu’il reconnait n’avoir pas un brevet de libraire, avoir été trouvé détenteur des ouvrages suivants qui ne portent pas de nom d’imprimeur (suivent les titres de cinq ouvrages) avoir mis en vente les ouvrages suivants, dont la condamnation judiciaire a été publiée, etc., ( quatre ouvrages sont indiqués), avoir mis en vente et vendu cinq autres ouvrages obscènes, et, en outre, des gravures, images et lithographies, soit en feuilles, soit en albums ;
Attendu que tous ces dessins représentent des sujets obscènes et que tous ces ouvrages offrent, ainsi qu’il a été déjà dit, dans leurs détails, comme dans leur ensemble, par la forme et par le fonds, le même caractère d’offense à la morale et aux bonnes mœurs ;
Que Randon s’est donc rendu coupable de contraventions et délits prévus et punis … (comme plus haut) ;
A l’égard de Hélaine,
Attendu que le 18 décembre dernier, il a été saisi dans son magasin de marchand d’estampes des cartes photographiques dont la vente n’est pas autorisée, et des cartes photographiques représentant des sujets obscènes ;
Qu’à l’égard de ces derniers, la spontanéité de la déclaration d’un des commis de Boivin peut faire naitre un doute sur le point de savoir s’ils appartiennent à ce dernier et s’il savait leur existence dans son magasin ; que ce doute doit lui profiter ;
Mais attendu qu’il est établi judiciairement que Boivin a vendu en 1864, à Randon notamment, un certain nombre de dessins ou gravures et de poupées représentant des emblèmes et des sujets obscènes, et qu’il s’est ainsi rendu coupable du délit et de la contravention punis et prévus par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 décret du 17 février 1852 ;
A l’égard de Margoutaud,
Attendu que le 13 janvier dernier, pendant le déménagement qu’opérait ce marchant relieur, il a été saisi en sa possession un grand nombre des ouvrages indiqués ci-dessus comme outrageant la morale et les bonnes mœurs ; qu’après avoir avoué que depuis quelque temps il s’était livré à la vente des livres obscènes, il est revenu sur cet aveu, en prétendant qu’il s’était toujours borné à exercer son commerce de relieur, et que tous les livres trouvés en sa possession ne lui avaient été remis que pour être brochés et reliés ;
Mais qu’il n’est pas pas possible d’admettre cette dernière version quand on rencontre à la fois tant de livres obscènes et 44 exemplaires d’un même ouvrage, et quand il ne peut indiquer ni les personnes qui les lui auraient envoyés, ni même signés propres à les reconnaitre sans les compromettre et sans écrire leurs noms ; qu’il a été aussi trouvé en sa possession des gravures et lithographies représentant des sujets obscènes (suivent six noms de dessins obscènes), qui évènement n’avaient pas été par lui achetés que pour vendre et en tirer profit ;
Qu’il en résulte donc contre Margoutaud la preuve d’avoir, à Paris, en 1864, exercé le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par la loi ; d’avoir, faisant le commerce, été trouvé détenteur d’ouvrages sans nom d’imprimeur, savoir (suit la désignation de dix ouvrages dont nous avons déjà donné les titres) ; d’avoir, dans le même temps, mis en vente et vendu des ouvrages dont la condamnation a été publiée dans les formes prescrites, savoir (cinq ouvrages sont cités) ; d’avoir, dans le même temps, commis le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs en mettant en vente et en vendant les ouvrages ( 22 déjà nommé) ;
En mettant en vente et vendant des gravures et lithographies représentant des objets obscènes ; les unes en feuilles, les autres accompagnant les livres ci-dessus désignés ;
Et enfin d’avoir mis en vente ou vendu des dessins non autorisés par l’administration, ce qui constitue les délits et contraventions prévus et punis par les art. 24 du décret du 17 février 1852, 19 de la loi du 26 mai 1819, 1er et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852 ;
A l’égard de Chauvet,
Attendu que le 7 janvier dernier, il a été sais au domicile de ce prévenu et dans le bureau qu’il occupe comme employé dans l’administration des Petites-Voitures, des photographies et une grande quantité de dessins coloriés ou non coloriés représentant des sujets obscènes, les uns terminés, les autres en voie d’exécution ; qu’il résulte de ses aveux que ces dessins étaient en partie commandés et destinés à être vendus, et que depuis deux ans il composait ou copiait des dessins de même nature et les vendait à diverses personnes, notamment à Blanche ;
Qu’il est également établi et avoué par le prévenu qu’il a vendu l’ouvrage intitulé … (un ouvrage déjà indiqué) ;
Qu’il résulte de ces faits que Chauvet a commis à Paris, depuis moins de trois ans, le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs en vendant des dessins et aquarelles, ainsi que l’ouvrage intitulé (un ouvrage déjà indiqué) , et une contravention en vendant des dessins non autorisés par l’administration, délit et contravention prévus punis par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852 ;
A l’égard d’Halphen,
Attendu que s’il a échangé avec Hélaine contre des livres quelques dessins obscènes, cet acte isolé ne saurait constituer à sa charge la publicité nécessaire pour justifier le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs et la contravention qui lui sont reprochés ;
Le renvoie de la poursuite sans dépens ;
Et à l’égard de tous les autres prévenus ;
Vu les articles précités,
Vu aussi l’article 365 du Code d’instruction criminelle et l’article 463 au profit de Blanche, de Gay, de Randon, de Hélaine et de Margoutauc,
Condamne Poulet-Malassis à une année d’emprisonnement et à 500 fr. d’amende ; Sauvan, à quatre mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; Gay, à quatre mois d’emprisonnement et à 500 fr. d’amende ; Bayard, à trois mois d’emprisonnement et à 100 francs d’amende ; Margoutaud et Randon, chacun à deux mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; Boivin, Hélaine et Chauvet, chacun à un mois d’emprisonnement et à 100 fr. d’amende ; les condamne chacun à un dixième des dépens ;
Déclare toutes les condamnations ci-dessus recouvrables par la voie de la contrainte par corps, et prononce la solidarité entre Blanche, Sauvan, Poulet-Malassis et Bayart :
Déclare confisqués les livres, dessins et objets qui ont été saisis et qui sont retenus comme éléments des condamnations ci-dessus prononcées ; dit qu’ils seront détruits, ainsi que les exemplaires et reproductions qui pourront être saisis ultérieurement ;
Fixe à un an la durée de la contrainte par corps contre chacun de ceux dont les condamnations pécuniaires s’élèveraient au-dessus de 300 fr.
Amazon – FNAC