Chose lue. Maya Angelou : Et pourtant je m’élève, éditions Seghers, 2022.
Longtemps, Maya Angelou a été méconnue du public français, avant d’être célébrée à sa juste mesure depuis 2008 pour ses romans autobiographiques, dont le célèbre Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage. Activiste et écrivaine, Angelou l’était bien sûr, mais elle se considérait aussi comme une poète. Au début de sa carrière, elle alternait la publication de chaque texte autobiographique avec un recueil.
Et pourtant je m’élève, son troisième opus publié en 1978, demeure l’un de ses plus emblématiques. Composé de 32 poèmes, divisés en trois parties, il révèle une Maya Angelou dans sa pleine maturité poétique, tour à tour sentimentale ou engagée, évoquant aussi bien des motifs intimes (l’amour, la maternité, la famille), que les thèmes ouvertement politiques (les difficultés de la vie urbaine, la maltraitance, la drogue, le racisme du vieux Sud). Ce qui caractérise sa voix est une détermination sans faille à surmonter les épreuves, quelle qu’elles soient, et la confiance, la force, la fierté qu’elle puise dans son identité de femme noire. Si Maya Angelou réjouit le lecteur d’aujourd’hui, c’est parce que son sens de la provocation et de la formule ne se départit jamais d’humour et ne verse jamais ni dans le désespoir, ni le communautarisme ou la haine de l’autre. Elle est cette femme phénoménale dont le poème éponyme brosse le portrait, et nous enjoint de le devenir à notre tour :
Je dis,
C’est le feu dans mes yeux,
Et l’éclat de mes dents,
Le swing de mes hanches,
Et la gaieté dans mes pieds.
Je suis une femme
Phénoménalement
Femme phénoménale
C’est ce que je suis.

Livre traduit par Santiago Artozqui.
Chose lue. Isabelle Mity, Les Actrices du IIIe Reich. Splendeurs et misères des icônes du Hollywood nazi
C’est pourtant entre 1933 et 1945 que les studios allemands comme la UFA produisent le plus de films (comédies, mélodrames, films d’amour, policiers, etc.) et élèvent nombre d’actrices au rang d’icônes (Zarah Leander, Brigitte Horney, Camilla Horn…). Largement inspirée du modèle hollywoodien, cette industrie est une véritable usine à rêves qui présente alors deux avantages majeurs : d’une part, divertir les citoyens allemands et leur faire oublier la guerre en leur offrant un monde de glamour et de paillettes ; d’autre part, délasser les « grands » – tels Goebbels – qui se consolent facilement dans les bras des actrices…
Pour la première fois, cet ouvrage explore et analyse le star system nazi : le statut particulier et ambigu des comédiennes, leurs carrières étonnantes, leurs vies hors du commun, leurs rapports avec les hauts dignitaires, le rôle qui leur a été dévolu à l’écran… En dévoilant cette face cachée de l’univers national-socialiste, Isabelle Mity revisite de manière originale et inattendue l’histoire de l’Allemagne au XXe siècle.

Chose lue. Rubens et Brueghel. Une amitié de travail
Au début du XVIIe siècle, Pierre Paul Rubens et Jan Brueghel l’Ancien étaient les deux peintres les plus célèbres d’Anvers. Ils étaient également des amis proches et de fréquents collaborateurs qui, pendant vingt-cinq ans, de 1598 à 1625 environ, ont exécuté ensemble environ deux douzaines d’œuvres. Les deux artistes avaient beaucoup en commun – ils ont tous deux supervisé des ateliers productifs et ont eu l’honneur et la distinction de servir de peintres de cour aux régents des Pays-Bas du Sud – mais leur œuvre commune a grandement bénéficié de leurs différences. Paysagiste prolifique et peintre de natures mortes, Brueghel était réputé pour ses œuvres remarquablement méticuleuses et ressemblant à des bijoux, ce qui lui a valu le surnom de « Velours Brueghel ». » Rubens était un peintre ambitieux de grands retables et de peintures d’histoire, qui réussissait notamment à capter l’émotion et l’énergie corporelle. L’union de leurs styles distinctifs de coups de pinceau et de modes visuels individuels a produit de belles compositions richement allusives qui sont aussi recherchées aujourd’hui qu’elles l’étaient par les contemporains des artistes.
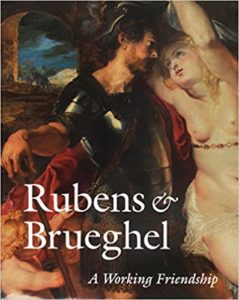
Droit et littérature. L’affaire du catalogue des Livres du boudoir de Marie-Antoinette
Marie-Antoinette aimait les Lettres. C’est du moins ce qu’ont assuré Jules et Edmond de Goncourt dans leur biographie de la Reine. En toute hypothèse, aussi bien la bibliothèque du petit Trianon que celle du boudoir de Marie-Antoinette étaient richement pourvues. Les livres du boudoir avaient fait l’objet d’un catalogue manuscrit et par ordre alphabétique qui avait ensuite été consigné à la bibliothèque impériale et était devenu propriété de l’Etat.
En 1863, l’homme de Lettres et bibliophile Louis Lacour conçut de faire éditer une version imprimée de ce catalogue sous le titre Les Livres du boudoir de Marie-Antoinette. Gay, libraire-éditeur à Paris se chargea de cette édition. Aussitôt publié, l’ouvrage provoqua une controverse politico-morale puisque le catalogue désignait notamment un certain nombre de livres « licencieux », parmi lesquels les 5 volumes de Une année de la vie du chevalier de Faublas ; les 2 volumes des Six semaines de la vie du chevalier de Faublas ; les Mémoires turcs avec l’histoire galante de leur séjour en France ; Histoire de Sophie de Francourt ; Les Confessions du comte de *** de l’Académicien Charles Pinot Duclos.
Alors que certains jugeaient invraisemblable que la Reine ait pu avoir de tels livres, d’autres pensaient pouvoir assurer qu’elle ne les avait pas lus. Beaucoup prêtèrent en tout cas à Louis Lacour l’intention d’avoir voulu faire nouvellement scandale avec cette publication puisque sa livraison en 1858 des Mémoires de Lauzun lui avait valu une inculpation pour outrage aux bonnes mœurs. Il obtint finalement un non-lieu. Mais la publication d’une seconde édition lui valut non seulement une inculpation mais un procès. Il fut acquitté sur le fondement du non-lieu qu’il avait déjà obtenu.
Les Livres du boudoir de Marie-Antoinette ne fut pas poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs mais pour contrefaçon du Catalogue appartenant à l’Etat. L’affaire fut plaidée les 1er, 16 et 22 mai 1863. Les deux prévenus furent relaxés.
Les bibliothèques de boudoir
« De tout temps les femmes du monde ont eu leurs petits appartements, retraites mystérieuses dont la légende a fait le théâtre des désordres élégants et du vice quintessencié. Au moyen âge, ces asiles du plaisir et de l’amour s’appelaient oratoires : un même élan y confondait le mysticisme et la galanterie. Les siècles suivants leur donnèrent le nom de cabinets, expression générale, insignifiante, inventée par l’hypocrisie. La régence créa les boudoirs, ou plutôt les cabinets devenus des boudoirs datent de ce moment. Mais comment l’action si maussade que représente le verbe bouder a-t-elle pu devenir l’origine d’un mot qui offre aux imaginations un sens aussi différent ? à cela il n’est qu’une réponse, tirée de l’histoire des vices de messieurs les roués. Et toutes les fois que les hommes iront chercher des plaisirs nouveaux loin de la société des femmes, ils ne devront pas s’étonner lorsque, revenus à des sentiments moins extranaturels, ils trouveront boudeuses au fond de leurs appartements celles qu’ils auront trop longtemps dédaignées. Quoi qu’il en soit, le mot boudoir fut accepté sans conteste, et il devint de mode de faire du boudoir la chambre la plus coquette et la mieux ornée. Les palais en eurent d’admirables — et de bizarres. Chez le comte d’Artois, chez le duc d’Orléans, étaient de petites retraites enjolivées avec la fantaisie la plus extravagante — pour ne pas dire plus.
Cependant, vers la fin du siècle, le boudoir tendait en général à se moraliser. De Paulmy, dans son Manuel des châteaux (1779), ne signale dans les habitations de son époque que trois pièces ou appartements importants : le salon, qui sert de centre aux jeux et aux plaisirs, le théâtre et le boudoir. Mais le boudoir n’est pas, selon lui, un réduit secret et voluptueux, c’est bien aussi le cabinet d’étude et de travail, cabinet retiré il est vrai, et par cela plus propre aux occupations sérieuses auxquelles il est destiné. Dans son esprit même, les mots boudoir et bibliothèque sont presque devenus synonymes, et ce rapprochement de deux expressions en apparence fort différentes nous montre à quel point l’esprit du boudoir s’était modifié et avait pris de gravité aux approches de la Révolution.
Une dame qui écrit à de Paulmy, ou qui est censée lui écrire, représente ainsi son boudoir idéal :
« La seconde pièce de mon château qui me sera chère sera ma petite bibliothèque, tenant d’un côté à mon salon et de l’autre à ma chambre à coucher ; mais ménagée cependant de façon qu’elle ne sert de communication nécessaire ni à l’un ni à l’autre. C’est cette pièce favorite que je veux meubler. L’on y voit deux corps de tablettes, et, au milieu d’elles, un enfoncement ou espèce de niche occupée par un sopha ou ottomane, garnie de coussins : c’est là que je ferai mes lectures, et même que j’en raisonnerai avec ceux que j’estimerai assez pour leur communiquer mes réflexions. On trouve encore dans ce charmant boudoir deux autres corps de tablettes : l’un coupé par une cheminée et l’autre par une glace, et une table pour écrire, avec beaucoup de tiroirs et de secrets. Toutes ces tablettes sont prêtes à recevoir des livres ; mais quels livres peut-on placer, à la campagne, dans une bibliothèque de cette espèce, si ce ne sont des romans ? Je n’en peux prêter et faire lire que de ce genre aux dames qui viendront chez moi. » La fin de la même lettre nous donne des détails intéressants sur le nombre et le choix des romans qui devaient composer la bibliothèque d’un boudoir. « Je voudrais savoir au juste, ajoute la correspondante, à quoi m’en tenir sur les romans et avoir un choix tout fait d’un certain nombre, qui puisse m’occuper et me divertir tous les matins, et quelquefois les soirs, pendant quatre ou cinq mois de l’année. L’on m’a assuré que vous connaissiez le mérite de ces sortes d’ouvrages, comme celui de beaucoup d’autres ; ainsi, je n’ai qu’à vous dire la quantité qu’il m’en faut, pour que vous me les choisissiez. On m’assure qu’en comptant chaque volume in-8 et in-12 (car je n’en veux pas d’autre format) à huit pouces de hauteur, l’un portant l’autre, et à un pouce et demi d’épaisseur, j’ai dans mon boudoir de quoi contenir six cents volumes ; envoyez-m’en, s’il vous plaît, promptement le catalogue, afin que je les fasse acheter et relier… Je vous demande des romans, tous différents les uns des autres, dont quelques-uns intéressent mon cœur par la beauté des sentiments, les autres attachent mon esprit par l’enchaînement et la singularité des faits, me plaisent par l’élégance et la pureté du style, ou me fassent rire. » L’auteur des Mélanges répond à la dame anonyme : « J’ai fait le choix que vous me demandez de’ six cents volumes qui peuvent obtenir la préférence pour garnir les tablettes de votre boudoir. » Ainsi, pour lui aussi, les livres sont un des ornements indispensables du boudoir, et il s’empresse de les indiquer. « Ces livres se trouvent presque tous aisément chez les libraires de Paris ou se vendent tous les jours aux inventaires… Vous aurez pour cent louis la garniture la plus intéressante d’un boudoir littéraire et romancier. »
Suivant les conseils de de Paulmy et de ses imitateurs (1), toutes les belles dames de France formèrent des bibliothèques dans leurs boudoirs, et, calculant aussi que six cents volumes leur suffiraient, elles fixèrent leur choix à ce chiffre. « Quand vous en liriez cinquante volumes par campagne, ce qui est beaucoup, leur avait dit avec raison le même bibliographe, cette petite bibliothèque aura de quoi vous amuser douze ans. Pendant ce temps, on fera d’autres romans, et j’en retrouverai. Dans douze ans donc, Madame, je vous donnerai un nouveau catalogue. » Mais de Paulmy comptait sans la marche des idées : douze ans après, l’année qui courait s’appelait 1792, il n’y avait plus de boudoirs, et l’on ne lisait plus de romans. »
(1) Entre autres Mercier de Compiègne, auteur de la Bibliothèque des Boudoirs.
Chose lue. Thierry Billard : Paul Deschanel. Le Président incompris, Perrin, 2022.
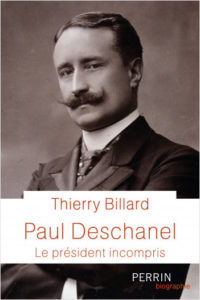
Apologies de la langue française. Paul Deschanel, La langue française, 1922.
LA LANGUE est la patrie spirituelle. Elle survit à la patrie terrestre. Voyez la Bible. N’est-elle pas, depuis deux mille ans, la vraie patrie des Juifs ? La langue d’Homère n’a-t-elle pas tenu lieu de patrie aux Hellènes opprimés ? Oui, la langue est une religion. Là est le royaume de l’esprit, qui ne connaît ni les frontières ni la mort. Et quand le Parthénon ne sera plus que cendre, la voix d’Eschyle et la voix de Démosthène continueront de monter vers la roche sacrée et de remplir l’univers.
Une langue vaut en proportion de ce qu’elle donne à l’humanité. Elle meurt quand elle n’a plus rien d’utile à dire. Elle ne mérite de vivre que par l’ascendant moral qu’elle exerce sur le monde et par les services qu’elle lui rend. La langue française, au commencement du XIX° siècle encore, était, par le nombre, la première des langues européennes ; elle n’est plus que la quatrième. Le français est parlé par 58 millions d’hommes, l’allemand par 80 millions, le russe par 85 millions, l’anglais par 1 1 6 millions. Non que nous ayons perdu du terrain, mais les autres en ont gagné. Seulement, le nombre n’est pas tout, pas plus que l’étendue du territoire : à ce compte, les Chinois seraient le premier peuple de la terre. La langue vaut ce que vaut la nation, et c’est pour cela que vous repoussez tout ce qui affaiblit l’initiative individuelle, la force militaire, l’union civique.
La langue française a été, par deux fois, en des saisons diverses, la langue universelle de l’Europe : la première fois, dans sa fleur de jeunesse et de simplicité, aux XIIe et XIIIe siècles ; la seconde fois, dans la pleine maturité de son génie, aux XVIIe et XVIIIe. Pourquoi ?
Aux XIIe et XIIIe siècles, parce qu’elle apportait à l’Europe une vie nouvelle, tout cet idéal de chevalerie, d’honneur, d’amour, que ni l’Antiquité ni le Moyen Age n’avaient connu ; au XVII°, parce que sa littérature,
parvenue au plus haut point de perfection, était l’expression achevée de la morale, le miroir de l’homme et de la société ; au XVIIIe, parce que sa philosophie préparait l’affranchissement de l’homme et la proclamation de ses droits. Chaque fois, la France ouvrait au monde un idéal nouveau, non seulement français, mais humain.
A l’inverse, du XIVe au XVIe siècles, la résurrection des lettres antiques, l’invention de l’imprimerie, la Renaissance, firent éclore d’autres littératures. La patrie de Dante, de Pétrarque et de Boccace, la patrie de Cervantes et de Lope de Vega, la patrie de Camoëns et celle de Shakespeare apprirent à se passer de nous. Et, depuis le XIXe siècle, l’expansion des langues anglaise, allemande et slaves est venue ravir à notre idiome sa primauté numérique.
Nous ne pouvons plus songer à substituer notre langue à la leur. Mais voici qu’un rôle nouveau s’offre à nous. A mesure que les relations internationales deviennent plus étroites et plus fréquentes, il faut, il faudra de plus en plus, non seulement à l’élite pensante, mais à l’ensemble du monde civilisé, à côté des langues nationales, un idiome commun, une langue complémentaire, qui permette aux peuples d’échanger aisément leurs sentiments et leurs idées. Or, quelle peut être cette langue ?
On a inventé de toutes pièces des idiomes artificiels, volapük, esperanto, universal, que sais-je ! Je ne prétends pas que ces créations factices ne puissent servir aux transactions commerciales, à peu près comme les notations du télégraphe ou de la sténographie ; mais il est bien improbable que jamais une langue artificielle devienne la langue générale, commune, ou même la plus répandue des peuples civilisés, et cela d’abord parce qu’elle n’a point de littérature. Le succès d’une langue est en proportion de l’éclat de sa littérature ; le jour où celle-ci périclite, la langue décline. La. langue d’un peuple est une flore vivante, qui porte en plein ciel les sucs de la terre. Il lui faut la lente maturation des saisons et des ans. Une langue artificielle est comme une fleur imitée; elle ne vit pas, elle n’a ni sève, ni couleur, ni parfum, elle ne peut s’épanouir. Ce ne sont pas seulement des mots, des sons, que les hommes veulent apprendre lorsqu’ils apprennent une langue, c’est tout le monde moral qu’elle exprime. Non : une langue qui n’a pas été vécue ne saurait créer de la vie ; une langue où un peuple n’a pas mis son âme ne prendra jamais les coeurs ; une langue sans poésie ne volera jamais aux lèvres des hommes.
Le monde civilisé devra donc choisir une langue naturelle, et il n’en est que trois : l’anglais, l’allemand et le français. L’allemand, admirable de force, de richesse, de profondeur, mais trop difficile, trop synthétique ; l’anglais, plus facile, mais formé de deux langues juxtaposées. Reste le français. Quels sont ses titres ?
Le français est la langue de la diplomatie ; il est aussi celle des élites en Russie, en Pologne, en Turquie, en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, en Serbie, en Hongrie, en Bohême, en Italie, en Espagne, en Portugal, dans les pays Scandinaves, et chaque jour ses clients deviennent plus nombreux. Il est, par excellence, la langue de la conversation, il a le sourire, la grâce. Il y a des races tristes, même sous le soleil ; la nôtre est gaie. Le ciel de la France est sur nos lèvres. « L’esprit français, c’est la raison en étincelles. »
Notre langue est la plus simple, en ce sens qu’elle emploie moins de mots, qui la plupart ont même origine ; la plus douce, car on peut dire de la France ce que Vauvenargues disait de Racine : « Personne n’éleva plus haut la parole et n’y versa plus de douceur » ; la plus logique et la plus claire, parce qu’on y parle dans l’ordre même où l’on pense : sujet, verbe, régime, se suivent toujours et se commandent ; c’est le mot de Rivarol : « La langue française est la seule qui ait une probité attachée à son génie » ; oui, précision, probité, c’est tout un ; enfin, la plus humaine, parce que c’est l’homme qui est le centre et le principal objet de notre littérature.
Au fond de l’épouvante de Pascal et de l’ironie de Voltaire, c’est le même drame, le même effort de la créature périssable pour saisir l’infini et se survivre à elle-même. Dans la foi comme dans le doute, l’homme se débat contre la fatalité, il essaye d’échapper à sa prison de chair, pour vivre, ne fût-ce qu’un instant, de la vie éternelle. Si l’on veut surprendre le génie de la France dans son essence même, dans ce qu’il a d’indestructible et de permanent à travers ses innombrables métamorphoses, on voit que ce peuple, le plus traditionnel à la fois et le plus révolutionnaire qui soit au monde, a toujours poursuivi le même rêve de justice. Le trait essentiel de l’âme française, c’est l’amour de l’idéal. Oui, c’est le plus pur de notre gloire, c’est l’harmonie et l’originalité de notre magnifique histoire, d’avoir toujours vécu par les idées et pour les idées. La pensée de la France est une pensée d’amour. Tout ce que gagne la culture française est gagné par la justice. La France travaille et pense pour le monde entier, et sa langue, outil d’affranchissement spirituel, est le patrimoine commun de tous les hommes.
Grâces donc soient rendues à nos grands écrivains, à ceux qui, même après tant de pertes illustres et sur des tombes encore fraîches, continuent la glorieuse lignée, qui dans la poésie, le roman, l’histoire, la philosophie, la critique, la presse, ou bien au théâtre, à la tribune, à la barre, gardent la pureté de notre langue et l’empêchent de vieillir ! Et grâces soient rendues aux artisans de raison et de beauté qui, sur toute la terre, répandent la langue immortelle de la. France et son âme divine !
Apologies de la langue française. Jules Simon, Une séance du Dictionnaire, 6 octobre 1901.
L’ACADÉMIE met ordinairement vingt ans à faire une édition de son Dictionnaire. Ce n’est pas beaucoup. La langue, en vingt ans, ne se modifie que très peu. Généralement, on abandonne l’Académie à elle-même pendant qu’elle fait son travail. Il me semble qu’un peu de collaboration venant de dehors lui serait fort utile. Elle vient, dans sa dernière séance, de repousser le mot actuaire, que les économistes lui proposaient. J’ai tremblé un moment pour le mot adduction, qu’on accusait d’être trop technique. La Compagnie approche du mot altruisme. Je désire beaucoup qu’il ne soit pas admis. Les philosophes paraissent le trouver nécessaire. Ne pourrait-on pas, avant la discussion, en causer tout tranquillement en public ?
Altruisme ! Vous vous demandez à quelle langue ce mot appartient. C’est justement la question ; il s’agit de savoir s’il appartiendra, oui ou non, à la langue française.
Il faut d’abord vous dire que les mots ont, comme les hommes, leurs amis et leurs ennemis.
Royer-Collard avait en horreur le mot base, employé dans le sens de fonder :
— Un raisonnement basé sur une erreur…
C’était un puriste. On en avait fait un professeur sur le tard ; mais il avait été un lettré toute sa vie. Un jour que M. Cousin et M. Patin discutaient longuement, à l’Académie, sur le texte d’un vers latin, M. Royer Collard accoucha de deux vers français, les seuls qu’il ait faits de sa vie. Il écoutait depuis une demi-heure les deux belligérants, le menton appuyé sut sa canne, quand il se redressa tout à coup et prononça ces deux vers en faisant tournoyer sa canne entre ses doigts:
Monsieur Cousin, monsieur Patin
Sont deux qui savent le latin…
Ces deux vers ne sont pas de premier ordre ; mais je n’étonnerai aucun humaniste en disant que celui qui les a faits savait évidemment le latin. Ce latiniste de Royer-Collard ne voulut jamais permettre que ce mot base fît partie de la langue française.
Léon Say nous a confié, à la tribune du Sénat, qu’il ne peut pas souffrir le mot éminent. Le mot est français ; mais on en fait un abus insupportable. Si vous voulez agacer profondément M. Léon Say, appelez-le un économiste éminent, un homme d’état éminent.
Buffet en veut avec raison au mot agissement, qui n’est ni français, ni utile, ni agréable.
*
Après ces exemples illustres, je peux bien avouer que j’ai le mot altruisme en aversion. Il n’est pas français ; mais ce sont des Français, évidemment mauvais citoyens, qui l’emploient. Ils font ce qu’ils peuvent pour dénaturer et déshonorer la langue nationale.
Vous me direz que le mot est. bien peu connu, bien peu répandu. J’en conviens. II n’est employé, jusqu’ici, que par les philosophes. S’ils le mettaient seulement dans leurs ouvrages de métaphysique, je m’en consolerais peut-être. Et d’abord, je n’en saurais rien, ni vous non plus. Mais ils le mettent dans leurs articles, qui sont plus lus par les gens du monde, et dans leurs manuels, qui sont appris par cœur par les jeunes candidats à la dignité de bachelier. Qui vous dit qu’un candidat ne se servira jamais du mot d’altruisme après avoir été examiné sur l’altruisme en pleine Sorbonne ? Il ne faut pas s’endormir dans une situation pareille.
On entend, par altruisme, la disposition d’un homme qui veut du bien à ses semblables, et se sent ou se croit capable de préférer leurs intérêts aux siens propres. C’est l’antipode et la contrepartie du mot égoïsme, qui est détestable, et dont nous jouissons depuis longtemps. égoïsme, altruisme : amour de soi, amour des autres. Les inventeurs de l’altruisme ont cru rendre service à la langue par la création d’un mot symétrique. Il n’est pas tout à fait symétrique, car, par altruisme, ils entendent une qualité, et non pas un défaut opposé au défaut de l’égoïsme.
*
D’ailleurs, la symétrie ne me touche guère. Sans être fou des jardins anglais, je les préfère aux jardins français, avec leurs allées au cordeau et leurs ifs taillés en pyramide. Et puis, altruisme, voyez donc quelle harmonie ! Cela déchire l’oreille. Je ne sais pas si la formation est exacte, et si altruisme vient légitimement d’alter. Égoïsme, au moins, n’est pas contestable ; c’est quelque chose.
Mais ce qui condamne irrévocablement l’altruisme et tous ceux qui emploient ce mot barbare, c’est qu’il a été créé et imaginé sans aucune nécessité et aucune utilité. La chose qu’il prétend exprimer existait avant lui ; elle ‘était connue, étudiée, décrite avant lui. C’est le sentiment le plus respectable de la nature humaine. Descartes et Bossuet l’appelaient bienveillance, à la satisfaction universelle. On l’appelait aussi quelquefois la charité, et c’était un très beau mot, qui rappelait l’amour divin et les grâces, tout en s’appliquant tout particulièrement à l’amour des hommes pour leurs semblables. Il avait un avantage important : celui d’être connu et employé depuis l’origine de la langue.
La langue française est comme une société choisie, ayant ses mœurs, ses habitudes, ses relations, dans laquelle on n’est admis qu’après une longue candidature, et en montrant patte blanche. Il faut, pour y pénétrer, être consacré par l’Académie et inséré dans le Dictionnaire. Beaucoup de mots ont mis un siècle à se faire accepter et classer. Ils ont d’abord été dans la bouche des gens de peu : pure les lettrés, en belle humeur, en ont tiré de jolis effets. Je citerai, par exemple, le passage des Misérables où Gavroche, après avoir péché un morceau de pain détrempé dans le bassin du Luxembourg, le donne à son petit frère en disant avec tendresse :
— Colle-toi ça dans le fusil.
C’est charmant ; mais il aurait fallu voir la colère de Victor Hugo si on lui avait proposé d’introduire fusil dans le Dictionnaire avec cette signification.
Le mot passe donc, à titre de singularité, à titre de plaisanterie, dans la langue des gavroches. Une fois là, il fait insensiblement des progrès ; on le dit sérieusement, simplement, couramment, et, un beau jour, quelque membre de la Commission du Dictionnaire, voulant se montrer ami du progrès et dégagé de tout préjugé, propose de le faire recevoir dans la langue de Corneille et de Molière. Le mot, s’il pouvait parler, ne trouverait pas qu’il a payé trop cher une telle gloire par un stage de cent ans.
J’aime à croire que, dans cent ans d’ici, le mot altruisme et les mots de cette catégorie, au lieu de faire des progrès, auront disparu, même du souvenir, et qu’on en parlera comme d’une invasion de barbarisme, qui a sévi dans les dernières années du dix-neuvième siècle. Ce qui justifie mon espérance, c’est que Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Musset, qui ont ouvert de nouvelles voies à la poésie, se sont contentés de la langue du seizième, du dix-septième, du dix-huitième siècles ; c’est que les pensées les plus audacieuses sont exprimées tous les jours par les plus grands écrivains dans le style le plus correct.
Préservez-nous, mon Dieu, de l’altruisme, du réalisme, du positivisme, du collectivisme, du prosaïsme et de tous les mots en isme, à l’exception de deux mots qui sont sacrés : le spiritualisme et le patriotisme !
Chose vue. Romy Schneider. La Cinémathèque française. 16 mars – 31 juillet 2022
Quarante ans après sa disparition, Romy Schneider (23 septembre 1938-29 mai 1982) est toujours aussi aimée et populaire. Actrice européenne, avec une carrière débutée en Allemagne et poursuivie en France, elle est devenue une star grâce à des films qui ont marqué à jamais l’histoire du cinéma.
Pourtant, depuis quelques années, la tragédie de la fin de sa vie prend le pas sur le reste. Il est toujours plus vendeur de présenter une femme comme un paquet de névroses, sujette à la mélancolie et désespérée jusqu’à l’os. Surtout si celle-ci était d’une beauté fracassante et l’une des plus grandes actrices de l’histoire du cinéma.
Avec Romy, on n’a voulu s’attacher qu’à cela : la tragédie d’une vie trop courte qui devait obligatoirement cacher d’autres drames, d’autres douleurs que ses films permettaient d’exorciser, de transcender. Comme si elle devait à tout jamais payer le prix de sa beauté, de ses amours flamboyantes avec Alain Delon, de ses films, de sa jeunesse et de sa liberté. Tenter de retrouver tous les petits cailloux comme des indices qui allaient conduire à l’issue fatale, c’était écrit, cela ne pouvait que se passer ainsi. Les États-Unis avaient bien eu leur Marilyn, on pouvait en rêver tout autant.
Mais tout ceci n’est-il pas un peu réducteur pour une actrice d’exception ? Elle, qui a fait rêver des millions de spectateurs, qui est devenue la muse d’immenses réalisateurs, et qui par son travail, par sa grâce face à la caméra, a inventé un style de jeu qu’aujourd’hui encore on admire et honore.
Alors, si nous tentions plutôt de révéler l’immense actrice qu’elle fut ? Derrière l’image de la jeune ingénue de ses débuts, dévoiler son goût du risque et des ruptures, la façon dont elle a bâti sa carrière pour casser l’image de porcelaine de cette princesse autrichienne grâce à qui elle était devenue une star a à peine 16 ans. La façon dont elle a pris en main sa destinée d’actrice et a su, tout au long de sa carrière, aller là où on ne l’attendait pas, surprendre toujours, se réinventer et s’entourer des plus grands. Alain Cavalier, dont elle tourna le premier film, Claude Sautet, bien sûr, Luchino Visconti, Orson Welles, tous s’accordent à parler de son génie. Dévoiler les secrets de cette virtuosité, son sérieux, qu’elle mettait en tout et dans son travail en premier. Toujours pleine de trac, de doutes, elle ne cessait de se questionner sur sa légitimité, son jeu, sa beauté, son charisme.
Montrer aussi, dans cette exposition, comment la carrière de Romy Schneider a écrit une histoire du cinéma de son époque, celle de grands cinéastes du monde entier, qu’ils soient français, américains, italiens, allemands, autrichiens.
Il y avait chez elle une quête d’absolu qui a sans doute contribué à son génie et à sa grâce.
On peut le découvrir à travers ses lettres et ses notes et quelques-uns de ses témoignages aux journalistes, dont elle se méfiait beaucoup. Ce sont pourtant eux, qui depuis près de quarante ans, commentent, dissèquent et inventent des histoires autour de sa destinée.
Ne serait-il pas mieux de lui redonner la parole à elle, Romy Schneider ? Tenter de la faire revivre à travers ses rôles, bien sûr, mais aussi ses textes, ses interviews radios, télévisés, son journal, grâce aux making-of des tournages où on la découvre vibrante toujours et si gaie, pleinement heureuse de faire son métier.
Avec une vie si romanesque, des ruptures si marquées, des rencontres si déterminantes, c’est à nous, à travers cette exposition, de comprendre de quelle manière elle est devenue cette icône, cette femme moderne qui, quarante ans après sa mort, fait toujours autant battre les cœurs et dont l’image, elle, n’a pas pris une ride. La montrer parfaitement vivante, en pleine lumière, si sensuelle, si belle, et tenter de percer son mystère. En tout cas, tenter de le faire et surtout, sans effraction.
Clémentine Deroudille
Commissaire de l’exposition
Jean-Claude Zylberstein – Souvenirs d’un chasseur de trésors littéraires
Collection dirigée par Jean-Claude Zylberstein
La formule a été imprimée sur plus de 20 millions d’ouvrages. 10/18, Grands détectives, Domaine étranger, Pavillons, Texto… Jean-Claude Zylberstein a créé ou dirigé ces collections devenues incontournables avec toujours la même idée : exhumer des auteurs que nul ne se souciait de traduire ou de rééditer. Jim Harrison, Dashiell Hammett, Robert van Gulik, Somerset Maugham, Evelyn Waugh, Primo Levi, Winston Churchill, John Fante et beaucoup d’autres grands auteurs étrangers sont devenus des classiques grâce au travail de ce lecteur au goût si sûr.
Enfant juif caché pendant la guerre, c’est dans le grenier de ses protecteurs que naît sa passion de la lecture. Il fait ses débuts dans la presse comme critique de jazz pour Jazz magazine et Le Nouvel Observateur. Puis il entre dans l’édition en rassemblant les œuvres complètes de Jean Paulhan et devient directeur de collection grâce à Bernard de Fallois. Esthète à la curiosité insatiable, il exerce ensuite ses talents de dénicheur chez Christian Bourgois, Champ libre, Robert Laffont, La Découverte, Tallandier, Les Belles Lettres… Entre-temps, il est devenu l’un des plus grands avocats en droit d’auteur, défendant Salman Rushdie, Françoise Sagan, Ingrid Betancourt ou Daft Punk, et de nombreux éditeurs.


