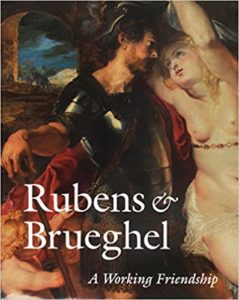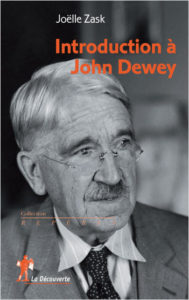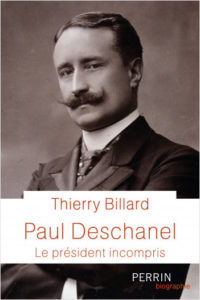Question récurrente. Quels sont les pré-requis idéaux pour vouloir faire du droit ? Au moins trois. 1/ Avoir une curiosité au-dessus de la moyenne pour les choses de la vie, quelles qu’elles soient, puisque tout, absolument tout peut devenir une question juridique et judiciaire 2/ Avoir une excellente maîtrise de la langue 3/ Avoir une certaine disposition à l’herméneutique, aux modes d’argumentation et techniques de l’interprétation. Pour ainsi dire, si on est anti-intellectualiste, il vaut mieux ne pas envisager le droit. Cf. la célèbre phrase de Jean Giraudoux dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu.
Voici deux questions très triviales qu’il peut être intéressant, par exemple, de poser à un lycéen qui veut se lancer dans le droit : « A ton avis, du point de vue du droit, la tomate est-elle un fruit ou un légume ? » « A ton avis, du point de vue du droit, une vis et un boulon sont-ils la même chose ? ». La réponse la plus prometteuse est d’ordre cognitif, du genre « Je ne m’étais jamais posé(e) la question, mais je suppose que si tu me la poses c’est qu’il y a un loup… ». En effet. La réponse montre une disposition à faire attention aux fausses évidences et à concevoir spontanément qu’il a dû y avoir des batailles d’interprétation juridique.
C’est dans Nix v. Hedden (10 mai 1893) que la Cour suprême des États-Unis a eu à trancher la première cette question : les tomates sont-elles des fruits ou des légumes ? Parce que la douane, à New York, avait assimilé les tomates à des légumes, ce qui les soumettait à une taxe d’importation de 10 %. Aussi, un importateur de tomates saisit les tribunaux en faisant valoir que les tomates étaient des fruits et devaient donc relever de la législation sur les fruits (rien n’est plus banal en droit : la même chose peut relever de règles différentes selon les circonstances)
Au procès, l’avocat du demandeur, après avoir lu en preuve les définitions des mots « fruits » et « légumes » du dictionnaire Webster, du dictionnaire Worcester et du dictionnaire impérial, a appelé deux témoins, qui avaient été pendant 30 ans dans le secteur de la vente de fruits et les légumes.
Un coup d’œil furtif aux archives de cette décision fait voir la discussion savante, notamment de botanique, qui eut lieu devant les juges sur le registre « mais qu’en est-il alors des pois, des concombres, des aubergines, etc. ». En fait, la Cour conclut à la nécessité de distinguer ente le statut scientifique de la tomate (qui voudrait qu’il s’agisse d’un fruit) et son statut dans la vie quotidienne (qui veut qu’il s’agisse d’un légume) : puisque, a fait valoir la Cour, dans la vie quotidienne, « les légumes sont habituellement servis au dîner, avec ou après la soupe, avec du poisson ou des viandes… et non en guise de dessert comme le sont en général les fruits ».

« La seule question en l’espèce, jugea la Cour suprême, est de savoir si les tomates, considérées comme denrées, doivent être classées comme «légumes » ou comme « fruits », au sens de la loi tarifaire de 1883.
Les seuls témoins appelés au procès ont déclaré que ni les « légumes » ni les « fruits » n’avaient de sens particulier dans le commerce différent de celui donné dans les dictionnaires, et qu’ils avaient le même sens dans le commerce aujourd’hui que celui qu’ils avaient en mars 1883.
Les passages cités des dictionnaires définissent le mot « fruit » comme la graine des plantes, ou la partie des plantes qui contient la graine, et en particulier les produits juteux et pulpeux de certaines plantes, recouvrant et contenant la graine. Ces définitions n’ont aucune tendance à montrer que les tomates sont des « fruits », par opposition aux « légumes », dans le langage courant ou au sens de la loi tarifaire.
En l’absence de preuve que les mots « fruits » et « légumes » aient acquis une signification particulière dans les échanges ou le commerce, ils doivent recevoir leur sens ordinaire. De ce sens, le tribunal est tenu de prendre connaissance judiciaire, comme il le fait en ce qui concerne tous les mots dans notre propre langue ; et sur une telle question, les dictionnaires sont admis, non comme preuves, mais seulement comme aides à la mémoire et à la compréhension de la cour.
Botaniquement parlant, les tomates sont le fruit d’une vigne, tout comme les concombres, les courges, les haricots et les pois. Mais dans le langage commun des gens, qu’ils soient vendeurs ou consommateurs de vivres, ce sont tous des légumes qui poussent dans les jardins potagers, et qui, qu’ils soient consommés cuits ou crus, sont, comme les pommes de terre, les carottes, les panais, les navets, les betteraves, les choux-fleurs, choux, céleris et laitues, habituellement servis au dîner dans, avec ou après la soupe, le poisson ou les viandes qui constituent la partie principale du repas, et non, comme les fruits en général, comme dessert.
La tentative de classer les tomates comme fruits n’est pas sans rappeler une tentative récente de classer les haricots comme graines, dont M. le juge Bradley, parlant au nom de cette cour, a déclaré : « Nous ne voyons pas pourquoi ils devraient être classés comme graines, pas plus que les noix ne devraient être ainsi classées. Les deux sont des graines, dans le langage de la botanique ou de l’histoire naturelle, mais pas dans le commerce ni dans le langage courant. D’un autre côté, en parlant généralement de provisions, les haricots peuvent très bien être inclus sous le terme « légumes ». Comme aliment sur nos tables, qu’elles soient cuites ou bouillies, ou formant la base d’un potage, elles sont utilisées comme légume, aussi bien mûres que vertes. C’est l’utilisation principale qui en est faite. Au-delà des connaissances communes que nous avons à ce sujet, très peu de preuves sont nécessaires ou peuvent être produites ». »
Y a-t-il une différence entre une vis et un boulon ? Cour fédérale, Rocknel Fastener, Inc. v. United States, 2001