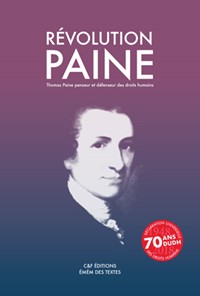L’histoire intellectuelle et politique du « droit au travail » est riche de grands débats principiels (sur ces débats, voir Libertés et droits fondamentaux, p. 838 et s.). Le premier débat porte sur le principe même du travail, entre ceux qui, sur la très longue durée de la pensée politique, y sont hostiles pour toutes sortes de raison et ceux qui promeuvent une justification libérale ou « humaniste » du travail. On le sait, Marx était plutôt précisément dans la deuxième catégorie intellectuelle puisque son opprobre n’était pas dirigé contre le travail lui-même mais contre l’exploitation de la force de travail des ouvriers dans le système de production capitaliste. Ce débat est loin d’être épuisé puisque c’est de lui dont sourdent, dans la période contemporaine, les controverses politiques et juridiques sur la diminution du temps de travail, sur la souffrance au travail, sur le syndrome d’épuisement professionnel, etc.
Le deuxième débat, qui est subséquent du premier, porte sur l’opportunité de faire du travail l’objet d’un droit. Ce deuxième débat qui, rationnellement, ne peut avoir lieu qu’entre partisans d’une justification libérale ou « humaniste » du travail comprend lui-même deux dimensions : 1° le travail est-il un « bien » d’une nature telle qu’il faille en faire un droit ? 2° le droit étant théoriquement reconnaissable à son opposabilité à l’État (et plus généralement aux pouvoirs publics), un droit au travail « effectif » (pour parler le langage de la fin du XXe siècle) n’induit-il pas la disparition du droit de propriété et la socialisation significative voire complète des moyens de production (le « socialisme »).
C’est donc ce deuxième débat qui aura opposé le libéral Tocqueville et le socialiste Ledru-Rollin ‒ tous deux porteurs d’une justification libérale ou « humaniste » du travail ‒ lors de la célèbre séance de l’Assemblée constituante du 12 septembre 1848 relative à la discussion d’un amendement de M. Mathieu (élu de la Drôme) au paragraphe 8 du préambule de la constitution (Moniteur, 15 septembre 1848). Dans le débat afférent, entre autres orateurs favorables à l’amendement et donc au droit au travail, il y avait Peltier, Ledru-Rollin, Crémieux, Victor Considerant, Billault. Les orateurs hostiles à cet amendement furent notamment Tocqueville, Duvergier de Hauranne, Thiers, Dufaure, etc. Ledru-Rollin répondit donc immédiatement à l’intervention de Tocqueville. L’amendement favorable à l’introduction du « droit au travail » dans la Constitution de 1946 fut rejeté par 396 voix contre 187. Ce débat n’est pas non plus épuisé, comme le montrent par exemple des initiatives législatives contemporaines tendant à l’interdiction des « licenciements boursiers » (voir Libertés et droits fondamentaux, précité).
Dans cette joute historique entre Tocqueville et Ledru-Rollin, les circonstances et l’époque sont remarquablement présentes (cette précision a son importance au regard d’une certaine littérature contemporaine sur les libertés et les droits fondamentaux remarquable par son a-historicisme = les libertés y apparaissent comme des générations spontanées, comme des évidences sans histoire). Le débat de 1848 est un débat sur les luttes sociales liées à la révolution industrielle. D’où ces occurrences dans les discours des orateurs à la Constituante au chartisme anglais ou à la question de savoir si l’État a vocation à être « entrepreneur » (le saint-simonisme n’est pas méconnu des orateurs à la constituante). D’où les références à la révolte des Canuts à Lyon (voirLibertés et droits fondamentaux, précité) : les ouvriers de l’industrie de la soie installée au quartier de la Croix-Rousse, en novembre 1831, initièrent une grève « dure » en réaction à l’opposition des patrons à une réglementation des salaires.
L’importance politique de la révolte des Canuts a d’ailleurs été perçue par le Gouvernement, d’où sa répression policière sans mesure (une répression qui, entre autres facteurs, aura durablement empêché aux syndicats ouvriers, jusqu’au début du XXe siècle, de concevoir l’idée même d’un syndicalisme … policier : voir sur cette question nos développements dans le Traité de droit de la police et de la sécurité, Lextenso, 2014). Le caractère référentiel de la révolte des Canuts fut saisi par de nombreux témoins de l’époque :
« Il ne faut rien dissimuler ; car à quoi bon les feintes et les réticences ? La sédition de Lyon a révélé un grave secret, celui de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède pas…. » (Saint-Marc Girardin, 1831).
« (…) La chose est mille fois plus grave à nos yeux…, ça veut dire qu’il s’agite, dans les profondeurs de notre vieil état social, des questions beaucoup plus graves que celles mêmes qui peuvent être décidées par un changement de dynastie ou de gouvernement. Et, en effet, eu égard à l’état actuel de la législation qui régit les rapports entre le maître et l’ouvrier, un désordre immense vient de se produire dans la seconde ville du royaume. Un maréchal, un prince, une armée sont partis ; on marche sur Lyon. Le gouvernement … va commencer une guerre des classes ; qu’il ne s’y trompe pas, c’est pis qu’une guerre politique. (…) » (Armand Carrel, Le National, 27 novembre 1831).
Alexis de Tocqueville, Assemblée constituante – 12 septembre 1848 (Moniteur, 15 septembre 1848).
Vous n’attendez pas de moi, si je ne me trompe, que je réponde à la dernière partie du discours que vous venez d’entendre. Elle contient l’énonciation d’un système complet et compliqué auquel je n’ai pas mission d’opposer un autre système. Mon but, dans ce moment, est uniquement de discuter l’amendement en faveur duquel, ou plutôt à propos duquel l’orateur précédent vient de parler. Quel est cet amendement ? quelle est sa portée ? quelle est sa tendance, suivant moi fatale ? C’est cela que j’ai à examiner. Un mot d’abord sur le travail de la Commission. La Commission, comme vous l’a dit le précédent orateur, a eu, en effet, deux rédactions, mais au fond elle n’a eu et ne continue à avoir qu’une seule pensée. Elle avait d’abord eu une première formule. Les paroles qui ont été prononcées à cette tribune et ailleurs, et mieux que les paroles, les faits lui ont démontré que cette formule était une expression incomplète et dangereuse de sa pensée elle y a renoncé, non pas à la pensée, mais à la forme.
Cette formule est reprise. C’est en face d’elle que nous nous trouvons en ce moment placés.
On met les deux rédactions en présence ; soit. Comparons l’une à l’autre à la lumière nouvelle des faits :
Par sa dernière rédaction, la Commission se borne à imposer à la société le devoir de venir en aide, soit par le travail, soit par le secours proprement dit et dans les mesures de ses ressources, à toutes les misères en disant cela, la commission a voulu, sans doute, imposer à l’État un devoir plus étendu, plus sacré que celui qu’il s’était imposé jusqu’à présent mais elle n’a pas voulu faire une chose absolument nouvelle elle a voulu accroître, consacrer, régulariser la charité publique, elle n’a pas voulu faire autre chose que la charité publique. L’amendement, au contraire, fait autre chose, et bien plus l’amendement, avec le sens que les paroles qui ont été prononcées et surtout les faits récents lui donnent, l’amendement qui accorde à chaque homme en particulier le droit général, absolu, irrésistible, au travail, cet amendement mène nécessairement à l’une de ces conséquences ou l’État entreprendra de donner à tous les travailleurs qui se présenteront à lui l’emploi qui leur manque, et alors il est entraîné peu à peu à se faire industriel ; et comme il est l’entrepreneur d’industrie qu’on rencontre partout, le seul qui ne puisse refuser le travail, et celui qui d’ordinaire impose la moindre tâche, il est invinciblement conduit à se faire le principal, et bientôt, en quelque sorte, l’unique entrepreneur de l’industrie. Une fois arrivé là, l’impôt n’est plus le moyen de faire fonctionner la machine du gouvernement, mais le grand moyen d’alimenter l’industrie. Accumulant ainsi dans ses mains tous les capitaux des particuliers, l’État devient enfin le propriétaire unique de toutes choses. Or, cela c’est le communisme. (Sensation.)
Si, au contraire, l’État veut échapper à la nécessité fatale dont je viens de parler, s’il veut, non plus par lui-même et par ses propres ressources, donner du travail à tous les ouvriers qui se présentent, mais veiller à ce qu’ils en trouvent toujours chez les particuliers, il est entraîné fatalement à tenter cette réglementation de l’industrie qu’adoptait, si je ne me trompe, dans son système, l’honorable préopinant. Il est obligé de faire en sorte qu’il n’y ait pas de chômage cela le mène forcément à distribuer les travailleurs de manière à ce qu’ils ne se fassent pas concurrence, à régler les salaires, tantôt à modérer la production, tantôt à l’accélérer, en un mot, à le faire le grand et unique organisateur du travail. (Mouvement.)
Ainsi, bien qu’au premier abord la rédaction de la-Commission et celle de l’amendement semblent se toucher, ces deux rédactions mènent à des résultats très-contraires ce sont comme deux routes qui, partant d’abord du même point, finissent par être séparées par un espace immense l’une aboutit à une extension de la charité publique au bout de l’autre, qu’aperçoit-on ? Le socialisme. (Marques d’assentiment.)
Ne nous le dissimulons pas, on ne gagne rien à ajourner des discussions dont le principe existe au fond même de la société, et qui, tôt ou tard, apparaissent d’une manière ou d’une autre, tantôt par des paroles et tantôt par des actes, à la surface. Ce dont il s’agit aujourd’hui, ce qui se trouve à l’insu peut-être de son auteur, mais ce que je vois du moins pour mon compte, avec la clarté du jour qui m’éclaire, au fond de l’amendement de l’honorable M. Mathieu, c’est le socialisme. (Sensation prolongée. Murmures à gauche.)
Oui, messieurs, il faut que tôt ou tard cette question du socialisme, que tout le monde redoute et que personne, jusqu’à présent, n’ose traiter, arrive enfin à cette tribune ; il faut que cette Assemblée la tranche, il faut que nous déchargions le pays du poids que cette pensée du socialisme fait peser, pour ainsi dire, sur sa poitrine ; il faut que, à propos de cet amendement, et c’est principalement pour cela, je le confesse, que je suis monté à cette tribune, la question du socialisme soit tranchée ; il faut qu’on sache, que l’Assemblée nationale sache, que la France tout entière sache si la révolution de Février est ou non une révolution socialiste. (Très-bien !)
On le dit, on le répète combien de fois, derrière les barricades de juin, n’ai-je point entendu sortir ce cri Vive la république démocratique et SOCIALE ? Qu’entend-on par ces mots ? il s’agit de le savoir ; il s’agit surtout que l’Assemblée nationale le dise. (Agitation à gauche.)
L’Assemblée peut croire que mon intention n’est pas d’examiner devant elle les différents systèmes qui, tous, peuvent être compris sous ce même mot, le socialisme. Je veux seulement tâcher de reconnaître, en peu de mots, quels sont les traits caractéristiques qui se retrouvent dans tous ces systèmes et voir si c’est cette chose qui porte cette physionomie et ces traits que la révolution de Février a voulue.
Si je ne me trompe, messieurs, le premier trait caractéristique de tous les systèmes qui portent le nom de socialisme, est un appel énergique, continu, immodéré, aux passions matérielles de l’homme. (Marques d’approbation.)
C’est ainsi que les uns ont dit « qu’il s’agissait de réhabiliter la chair »que les autres ont dit « qu’il fallait que le travail, même le plus dur, ne fût pas seulement utile, mais agréable ; » que d’autres ont dit qu’il fallait« que les hommes fussent rétribués, non pas en proportion de leur mérite, mais en proportion de leurs besoins ; » et enfin, que le dernier des socialistes dont je veuille parler est venu vous dire ici que le but du système socialiste et, suivant lui, le but de la révolution de Février, avait été de procurer à tout le monde une consommation illimitée.
J’ai donc raison de dire, messieurs, que le trait caractéristique et général de toutes les écoles socialistes est un appel énergique et continu aux passions matérielles de l’homme. Il y en a un second, c’est une attaque tantôt directe, tantôt indirecte, mais toujours continue, aux principes mêmes de la propriété individuelle. Depuis le premier socialiste qui disait, il y a cinquante ans, que la propriété était l’origine de tous les maux de ce monde, jusqu’à ce socialiste que nous avons entendu à cette tribune et qui, moins charitable que le premier, passant de la propriété au propriétaire, nous disait que la propriété était un vol, tous les socialistes, tous, j’ose le dire, attaquent d’une manière ou directe ou indirecte la propriété individuelle. (C’est vrai ! c’est vrai !) Je ne prétends pas dire que tous l’attaquent de cette manière franche, et, permettez-moi de le dire, un peu brutale, qu’a adoptée un de nos collègues ; mais je dis que tous, par des moyens plus ou moins détournés, s’ils ne la détruisent pas, la transforment, la diminuent, la gênent, la limitent, et en font autre chose que la propriété individuelle que nous connaissons et qu’on connaît depuis le commencement du monde. (Marques très vives d’assentiment.)
Voici le troisième et dernier trait, celui qui caractérise surtout à mes yeux les socialistes de toutes les couleurs, de toutes les écoles, c’est une défiance profonde de la liberté, de la raison humaine c’est un profond mépris pour l’individu pris en lui-même, à l’état d’homme ce qui les caractérise tous, c’est une tentative continue, variée, incessante, pour mutiler, pour écourter, pour gêner la liberté humaine de toutes les manières c’est l’idée que l’État ne doit pas seulement être le directeur de la société, mais doit être, pour ainsi dire, le maître de chaque homme que dis-je son maître, son précepteur, son pédagogue (Très-bien !) ; que, de peur de le laisser faillir, il doit se placer sans cesse à côté de lui, au-dessus de lui, autour de lui, pour le guider, le garantir, le maintenir, le retenir en un mot, c’est la confiscation, comme je le disais tout à l’heure, dans un degré plus ou moins grand, de la liberté humaine(Nouvelles marques d’assentiment) à ce point que, si, en définitive, j’avais à trouver une formule générale pour exprimer ce que m’apparaît le socialisme dans son ensemble, je dirais que c’est une nouvelle formule de la servitude. (Très-vive approbation.)
Vous voyez, messieurs, que je ne suis pas entré dans le détail des systèmes ; j’ai peint le socialisme par ses traits principaux, ils suffisent pour le faire reconnaître partout où vous les verrez, soyez sûrs que le socialisme est là, et partout où vous verrez le socialisme, soyez sûrs que ces traits se retrouvent.
Eh bien ! messieurs, qu’est-ce que tout cela ? Est-ce, comme on l’a prétendu tant de fois, la continuation, le complément légitime, le perfectionnement de la révolution française ? est-ce, comme on l’a dit tant de fois, le complément ; le développement naturel de la démocratie ? Non, messieurs, ce n’est ni l’un ni l’autre ; rappelez-vous, messieurs, la révolution française ; remontez à. cette origine terrible et glorieuse de notre histoire moderne. Est-ce donc en parlant, comme le prétendait hier un orateur, aux sentiments matériels, aux besoins matériels de l’homme, que la révolution française a fait les grandes choses qui l’ont illustrée dans le monde ? Croyez-vous donc que c’est en parlant de salaire, de bien-être, de consommation illimitée, de satisfaction sans bornes des besoins physiques.
Le citoyen Mathieu (de la Drôme). Je n’ai rien dit de semblable.
Le citoyen de Tocqueville. Croyez-vous que ce soit en parlant de telles choses qu’elle a pu éveiller, qu’elle a animé, qu’elle a mis sur pied, poussé aux frontières, jeté au milieu des hasards de la guerre, mis en face de la mort une génération tout entière ? Non, messieurs, non ; c’est en parlant de choses plus hautes et plus belles, c’est en parlant de l’amour de la patrie, de l’honneur de la patrie c’est en parlant de vertu, de générosité, de désintéressement, de gloire, qu’elle a fait ces grandes choses ; car, après tout, messieurs, soyez-en certains, il n’y a qu’un secret pour faire faire de grandes choses aux hommes c’est de faire appel aux grands sentiments. (Très-bien ! très-bien !)
Et la propriété, messieurs, la propriété ! Sans doute la révolution française a fait une guerre énergique, cruelle, à un certain nombre de propriétaires mais, quant au principe même de la propriété individuelle, elle l’a toujours respecté, honoré ; elle l’a placé dans ses constitutions au premier rang. Aucun peuple ne l’a plus magnifiquement traité ; elle l’a gravé sur le frontispice même de ses lois. La révolution française a fait plus non-seulement elle a consacré la propriété individuelle, mais elle l’a répandue elle y a fait participer un plus grand nombre de citoyens.(Exclamations diverses. C’est ce que nous demandons !)
Et c’est grâce à cela, messieurs, qu’aujourd’hui nous n’avons pas à craindre les conséquences funestes des doctrines que les socialistes viennent répandre dans le pays, et jusque dans cette enceinte c’est parce que la révolution française a peuplé ce pays de France de dix millions de propriétaires, qu’on peut, sans danger, laisser vos doctrines se produire à la tribune elles peuvent sans doute désoler la société, mais, grâce à la révolution française, elles ne prévaudront pas contre elle et ne la détruiront pas. (Très-bien !)
Et enfin, messieurs, quant à la liberté, il y a une chose qui me frappe, c’est que l’ancien régime, qui sans doute, sur beaucoup de points, il faut le reconnaître, était d’une autre opinion que les socialistes, avait cependant, en matière politique, des idées moins éloignées d’eux qu’on ne pourrait le croire. Il était bien plus près d’eux, à tout prendre, que nous. L’ancien régime, en effet, professait cette opinion, que la sagesse seule est dans l’État, que les sujets sont des êtres infirmes et faibles qu’il faut toujours tenir par la main, de peur qu’ils ne tombent ou ne se blessent ; qu’il est bon de gêner, de contrarier, de comprimer sans cesse les libertés individuelles qu’il est nécessaire de réglementer l’industrie, d’assurer la bonté des produits, d’empêcher la libre concurrence. L’ancien régime pensait, sur ce point, précisément comme les socialistes d’aujourd’hui. Et qu’est-ce qui a pensé autrement, je vous prie ? La révolution française.
Messieurs, qu’est-ce qui a brisé toutes ces entraves qui de tous côtés arrêtaient le libre mouvement des personnes, des biens, des idées ? Qu’est-ce qui a restitué à l’homme sa grandeur individuelle, qui est sa vraie grandeur, qui ? La révolution française elle-même. (Approbation et rumeurs.) C’est la révolution française qui a aboli toutes ces entraves, qui a brisé toutes ces chaînes que vous voudriez sous un autre nom rétablir, et ce ne sont pas seulement les membres de cette assemblée immortelle, l’Assemblée constituante, de cette assemblée qui a fondé la liberté, non-seulement en France, mais dans le monde ; ce ne sont pas seulement les membres de cette illustre assemblée, qui ont repoussé ces doctrines de l’ancien régime, ce sont encore les hommes éminents de toutes les assemblées qui l’ont suivie c’est le représentant même de la dictature sanglante de la Convention. Je lisais encore l’autre jour ses paroles les voici :
« Fuyez, disait Robespierre, fuyez la manie ancienne. » Vous voyez qu’elle n’est pas nouvelle. (Sourires.) « Fuyez la manie ancienne de vouloir trop gouverner laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire librement tout ce qui ne nuit pas à autrui ; laissez aux communes le droit de régler elles-mêmes leurs propres affaires ; en un mot, rendez à la liberté des individus tout ce qui lui a été illégitimement ôté, ce qui n’appartient pas nécessairement à l’autorité publique. » (Sensation.)
Eh quoi ! messieurs, tout ce grand mouvement de la révolution française n’aurait abouti qu’à cette société que nous peignent avec délices les socialistes, à cette société réglementée, réglée, compassée, où l’État se charge de tout, où l’individu n’est rien, où la société agglomère en elle-même, résume en elle-même toute la force, toute la vie, où le but assigné à l’homme est uniquement le bien-être, cette société où l’air manque ! où la lumière ne pénètre presque plus. Quoi ! ce serait pour cette société d’abeilles ou de castors, pour cette société plutôt d’animaux savants que d’hommes libres et civilisés, que la révolution française aurait été faite C’est pour cela que tant d’hommes illustres seraient morts sur les champs de bataille ou sur l’échafaud, que tant de sang glorieux aurait inondé la terre c’est pour cela que tant de passions auraient été excitées, que tant de génies, tant de vertus auraient paru dans le monde !
Non, non, j’en jure par ces hommes qui ont succombé pour cette grande cause ; non, ce n’est pas pour cela qu’ils sont morts ; c’est pour quelque chose de plus grand, de plus sacré, de plus digne d’eux et de l’humanité. (Très-bien !) S’il n’y avait eu que cela à faire, la révolution était inutile, l’ancien régime perfectionné y aurait suffi. (Mouvement prolongé.)
Je disais tout à l’heure que le socialisme, prétendait être le développement légitime de la démocratie je ne chercherai pas, moi, comme ont essayé de le faire plusieurs de nos collègues, quelle est l’étymologie vraie de ce mot démocratie. Je ne parcourrai pas, comme on le faisait hier, le jardin des racines grecques, pour savoir d’où vient ce mot. (On rit.) Je chercherai la démocratie où je l’ai vue, vivante, active, triomphante dans le seul pays du monde où elle existe, où elle a pu fonder jusqu’à présent, dans le monde moderne, quelque chose de grand et de durable en Amérique. (Chuchotements.)
Là, vous verrez un peuple où toutes les conditions sont plus égales qu’elles ne le sont même parmi nous ; où l’état social, les mœurs, les lois, tout est démocratique où tout émane du peuple et y rentre, et où cependant chaque individu jouit d’une indépendance plus entière, d’une liberté plus grande que dans aucun autre temps ou dans aucune autre contrée de la terre, un pays essentiellement démocratique, je le répète, la seule démocratie qui existe aujourd’hui dans le monde, les seules républiques vraiment démocratiques que l’on connaisse dans l’histoire. Et dans ces républiques, vous cherchez vainement le socialisme. Non seulement les théories des socialistes ne s’y sont pas emparées de l’esprit public, mais elles ont joué un si petit rôle dans les discussions et dans les affaires de cette grande nation, qu’elles n’ont pas même eu le droit de dire qu’on les y craignait.
L’Amérique est aujourd’hui le pays du monde où la démocratie s’exerce le plus souverainement, et c’est aussi celui où les doctrines socialistes que vous prétendez si bien d’accord avec la démocratie ont le moins de cours, le pays de tout l’univers où les hommes qui soutiennent ces doctrines auraient certainement le moins d’avantage à se présenter. Pour mon compte, je ne verrais pas, je l’avoue, un très grand inconvénient à ce qu’ils allassent en Amérique ; mais je ne leur conseille pas, dans leur intérêt, de le faire. (Rires bruyants.)
Un membre. On vend leurs biens dans ce moment-ci
Le citoyen de Tocqueville. Non, messieurs, la démocratie et le socialisme ne sont pas solidaires l’un de l’autre. Ce sont choses non-seulement différentes mais contraires. Serait-ce par hasard que la démocratie consisterait à créer un gouvernement plus tracassier, plus détaillé, plus restrictif que tous les autres, avec cette seule différence qu’on le ferait élire par le peuple et qu’il agirait au nom du peuple ? Mais alors, qu’auriez-vous fait ? sinon donner à la tyrannie un air légitime qu’elle n’avait pas, et de lui assurer ainsi la force et la toute-puissance qui lui manquaient. La démocratie étend la sphère de l’indépendance individuelle, le socialisme la resserre. La démocratie donne toute sa valeur possible à chaque homme, le socialisme fait de chaque homme un agent, un instrument, un chiffre. La démocratie et le socialisme ne se tiennent que par un mot, l’égalité mais remarquez la différence : la démocratie veut l’égalité dans la liberté, et le socialisme veut l’égalité dans la gène et dans la servitude. (Très-bien !très bien !)
Il ne faut donc pas que la révolution de Février soit sociale s’il ne le faut pas, il importe d’avoir le courage de le dire si elle ne doit pas l’être, il faut avoir l’énergie de venir le proclamer hautement, comme je le fais moi-même ici. Quand on ne veut pas la fin, il ne faut pas vouloir les moyens ; si on ne veut pas le but, il ne faut pas entrer dans la voie qui y mène. On vous propose aujourd’hui d’y entrer. Il ne faut pas suivre cette politique qu’indiquait jadis Babœuf, ce grand-père de tous les socialistes modernes. (Rires d’approbation.)
Il ne faut pas tomber dans le piège qu’il indiquait lui-même, ou plutôt qu’indiquait en son nom son historien, son ami, son élève, Buonarotti. Écoutez ce que disait Buonarotti ; cela mérite d’être écouté, même après cinquante ans.
Un membre. Il n’y a pas ici de baboviste (*).
Le citoyen de Tocqueville. « L’abolition de la propriété individuelle et l’établissement de la grande communauté nationale était le dernier but de ses travaux (de Babœuf). Mais il se serait bien gardé d’en faire l’objet d’un ordre le lendemain du triomphe il pensait qu’il fallait se conduire de manière à déterminer le peuple entier à proscrire la propriété individuelle par besoin et par intérêt. »
Voici les principales recettes dont il comptait se servir. (C’est son panégyriste qui parle.) « Établir, par les lois, un ordre public dans lequel les propriétaires, tout en gardant provisoirement leurs biens, ne trouveraient plus ni abondance, ni plaisir, ni considération où forcés de dépenser la plus grande partie de leurs revenus en frais de culture et en impôts, accablés sous le poids de l’impôt progressif, éloignés des affaires, privés de toute influence, ne formant plus dans l’État qu’une classe suspecte d’étrangers, ils seraient forcés d’émigrer en abandonnant leurs biens, ou ré- .duits à sceller de leur propre adhésion l’établissement de la communauté universelle. » (On rit.)
Un représentant. Nous y voilà !
Le citoyen de Tocqueville. Voilà, messieurs, le programme de Babœuf ; je désire de tout mon cœur que ce ne soit pas celui de la république de Février ; non, la république de Février doit être démocratique, mais elle ne doit pas être socialiste.
Une voix à gauche. Si ! (Non ! non ! Interruption.)
Le citoyen de Tocqueville. Et si elle n’est pas socialiste, que sera-t-elle donc ?
Un membre à gauche. Royaliste !
Le citoyen de Tocqueville, se tournant de ce côté. Elle le deviendrait peut-être si on vous laissait faire (Vive approbation), mais elle ne le deviendra pas. Si la révolution de Février n’est pas socialiste, que sera-t-elle donc ? Est-elle, comme beaucoup de gens le disent et le croient, un pur accident ? Ne doit-elle être qu’un pur changement de personnes ou de lois ? Je ne le crois pas.
Lorsque, au mois de janvier dernier, je disais, au sein de la chambre des députés, en présence de la majorité d’alors, qui murmurait sur ces bancs, par d’autres motifs, mais de la même manière qu’on murmurait sur ceux-ci tout à l’heure. (Très-bien ! très-bien !)
(L’orateur désigne la gauche.)
Je lui disais Prenez-y garde, le vent des révolutions s’est élevé ne le sentez-vous pas ? Les révolutions s’approchent ; ne les voyez-vous pas ? Nous sommes sur un volcan. Je disais cela ; le Moniteur en fait foi. Et pourquoi le disais-je ?… (Interruption à gauche.)
Avais-je la faiblesse d’esprit de croire que les révolutions s’approchaient, parce que tel ou tel homme était au pouvoir, parce que tel ou tel incident de la vie politique agitait un instant le pays ? Non, messieurs. Ce qui me faisait croire que les révolutions approchaient, ce qui, en effet, a produit la révolution, était ceci je m’apercevais que, par une dérogation profonde aux principes les plus sacrés que la Révolution française avait répandus dans le monde, le pouvoir, l’influence, les honneurs, la vie, pour ainsi dire, avaient été resserrés dans des limites tellement étroites d’une seule classe, qu’il n’y avait pas un pays dans le monde qui présentât un seul exemple semblable même dans l’aristocratique Angleterre, dans cette Angleterre que nous avions alors si souvent le tort de prendre pour exemple et pour modèle ; dans l’aristocratique Angleterre, le peuple prenait une part, sinon complètement directe, au moins considérable, quoique indirecte aux affaires ; s’il ne votait pas lui-même (et il votait souvent), il faisait du moins entendre sa voix il faisait connaître sa volonté à ceux qui gouvernaient ; ils étaient entendus de lui et lui d’eux.
Ici, rien de pareil. Je le répète, tous les droits, tout le pouvoir, toute l’influence, tous les honneurs, la vie politique tout entière, étaient renfermés dans le sein d’une classe extrêmement étroite et au-dessous, rien !
Eh bien ! voilà ce qui me faisait croire que la révolution était à nos portes. Je voyais que, dans le sein de cette petite classe privilégiée, il arrivait ce qui arrive toujours à la longue dans les petites aristocraties exclusives, il arrivait que la vie publique s’éteignait, que la corruption gagnait tous les jours, que l’intrigue prenait la place des vertus publiques, que tout s’amoindrissait, se détériorait.
Voilà pour le haut.
Et dans le bas que se passait-il ? Plus bas que ce qu’on appelait alors le pays légal, le peuple proprement dit, le peuple qui était moins maltraité qu’on ne le dit (car il faut être juste surtout envers les puissances déchues), mais auquel on pensait trop peu le peuple vivant, pour ainsi dire, en dehors de tout le mouvement officiel, se faisait une vie qui lui était propre se détachant de plus en plus par l’esprit et par le cœur de ceux qui étaient censés le conduire, il livrait son esprit et son cœur à ceux qui naturellement étaient en rapport avec lui, et beaucoup d’entre ceux-là étaient ces vains utopistes dont nous nous occupions tout à l’heure, ou des démagogues dangereux.
C’est parce que je voyais ces deux classes, l’une petite, l’autre nombreuse, se séparant peu à peu l’une de l’autre ; remplies, l’une de jalousie, de défiance et de colère, l’autre d’insouciance, et quelquefois d’égoïsme et d’insensibilité, parce que je voyais ces deux classes marchant isolément et en sens contraires, que je disais, et que j’avais le droit de dire Le vent des révolutions se lève, et bientôt la révolution va venir. (Très-bien !)
Est-ce pour accomplir quelque chose d’analogue à cela que la révolution de Février a été faite ? Non, messieurs, je ne le crois pas ; autant qu’aucun de vous, je crois le contraire, je veux le contraire, je le veux non-seulement dans l’intérêt de la liberté, mais encore dans l’intérêt de la sécurité publique.
Je n’ai pas travaillé, moi, je n’ai pas le droit de le dire, je n’ai pas travaillé à la révolution de Février, je l’avoue mais cette révolution faite, je veux qu’elle soit une révolution sérieuse, parce que je veux qu’elle soit la dernière. Je sais qu’il n’y a que les révolutions sérieuses qui durent ; une révolution qui ne produit rien, qui est frappée de stérilité dès sa naissance, qui ne fait rien sortir de ses flancs, ne peut servir qu’à une seule chose, à faire naître plusieurs révolutions qui la suivent.(Approbation.)
Je veux donc que la révolution de Février ait un sens, un sens clair, précis, perceptible, qui éclate au dehors, que tous puissent voir.
Et quel est ce sens ? je l’indique en deux mots : La révolution de Février doit être la continuation véritable, l’exécution réelle et sincère de ce que la révolution française a voulu elle doit être la mise en œuvre de ce qui n’avait été que pensé par nos pères. (Vif assentiment.)
Le citoyen Ledru-Rollin. Je demande la parole.
Le citoyen de Tocqueville. Voilà ce que la révolution de Février doit être, ni plus, ni moins. La révolution française avait voulu qu’il n’y eût plus de classes, non pas dans la société, elle n’avait jamais eu l’idée de diviser les citoyens, comme vous le faites, en propriétaires et en prolétaires. Vous ne retrouverez ces mots chargés de haines et de guerres dans aucun des grands documents de la révolution française. La révolution a voulu que, politiquement, il n’y eût pas de classes ; la restauration, la royauté de Juillet ont voulu le contraire. Nous devons vouloir ce qu’ont voulu nos pères.
La Révolution avait voulu que les charges publiques fussent égales, réellement égales pour tous les citoyens elle y a échoué. Les charges publiques sont restées, dans certaines parties, inégales nous devons faire qu’elles soient égales ; sur ce point encore, nous devons vouloir ce qu’ont voulu nos pères et exécuter ce qu’ils n’ont pas pu. (Très-bien !)
La révolution française, je vous l’ai déjà dit, n’a pas eu la prétention ridicule de créer un pouvoir social qui fit directement par lui-même la fortune, le bien-être, l’aisance de chaque citoyen, qui substituât la sagesse très-contestable des gouvernements à la sagesse pratique et intéressée des gouvernés ; elle a cru que c’était assez remplir sa tâche, que de donner à chaque citoyen des lumières et de la liberté. (Très-bien !)
Elle a eu cette ferme, cette noble, cette orgueilleuse croyance que vous semblez ne pas avoir, qu’il suffit à l’homme courageux et honnête d’avoir ces deux choses, des lumières et de la liberté, pour n’avoir rien de plus à demander à ceux qui le gouvernent.
La Révolution a voulu cela ; elle n’a eu ni le temps, ni les moyens de le faire. Nous devons le vouloir et le faire.
Enfin, la révolution française a eu le désir, et c’est ce désir qui l’a rendue non seulement sacrée, mais sainte aux yeux des peuples, elle a eu le désir d’introduire la charité dans la politique elle a conçu des devoirs de l’État envers les pauvres, envers les citoyens qui souffrent, une idée plus étendue, plus générale, plus haute qu’on ne l’avait eue avant elle. C’est cette idée que nous devons reprendre, non pas, je le répète, en mettant la prévoyance et la sagesse de l’État à la place de la prévoyance et de la sagesse individuelles, mais en venant réellement, efficacement, par les moyens dont l’État dispose, au secours de tous ceux qui souffrent, au secours de tous ceux qui, après avoir épuisé toutes leurs ressources, seraient réduits à la misère si l’État ne leur tendait pas la main.
Voilà ce que la révolution française a voulu faire ; voilà ce que nous devons faire nous-mêmes. Y a-t-il là du socialisme ?
À gauche. Oui oui ! Il n’y a que cela.
Le citoyen de Tocqueville. Non ! non ! Non, il n’y a pas de socialisme, il y a de la charité chrétienne appliquée à la politique ; il n’y a rien là.(Interruption.)
Le citoyen président. Vous ne vous entendez pas ; c’est clair comme le jour ; vous n’avez pas la même opinion ; vous monterez à la tribune ; mais n’interrompez pas.
Le citoyen de Tocqueville. Il n’y a rien là qui donne aux travailleurs un droit sur l’État ; il n’y a rien là qui force l’État à se mettre à la place de la prévoyance individuelle, à la place de l’économie, de l’honnêteté individuelle ; il n’y a rien là qui autorise l’État à s’entremettre au milieu des industries, à leur imposer des règlements, à tyranniser l’individu pour le mieux gouverner, ou, comme on le prétend insolemment, pour le sauver de lui-même ; il n’y a là que du christianisme appliqué à la politique.
Oui, la révolution de Février doit être chrétienne et démocratique mais elle ne doit pas être socialiste. Ces mots résument toute ma pensée, et je termine en les prononçant. (Très-bien ! très-bien !)
Ledru-Rollin, Assemblée constituante, 12 septembre 1848 (Moniteur, 15 septembre 1848).
Messieurs, — L’orateur qui descend de cette tribune a invoqué les grands principes de notre glorieuse révolution française. Il a prétendu qu’il voulait, pour la République actuelle, tout ce que contenait de noble, d’élevé, de fraternel, le grand mouvement que nos pères, en 1789 et en 1793, ont imprimé au monde. C’est ce que je veux aussi. À cette époque, comme il l’a dit, la guerre extérieure, les troubles intestins, n’ont pas permis de pousser les principes jusqu’aux conséquences, et de les faire entrer dans la réalité des faits ; tel doit être aujourd’hui notre but.
Après avoir posé la thèse, il a ajouté que la déclaration du droit au travail eut une invention socialiste. Le socialisme, s’est-il écrié, c’est ce qu’il y a de pire au monde, car c’est la communauté ; en d’autres termes, c’est l’Etat se substituant à la liberté individuelle et devenant le plus affreux de tous les tyrans. (Très bien !) Je n’en veux pas plus que lui (très bien !), et j’ajoute que, quand il prétend que c’est au nom du socialisme seulement qu’on peut demander dans la constitution l’introduction du droit au travail, il commet la plus capitale de toutes les erreurs.
Voix à gauche. C’est vrai !
Le citoyen Ledru-Rollin. Le droit au travail ! mais, comme vous l’avez dit, il était la pensée favorite, le mobile constant des hommes d’Etat de la Convention. Le droit au travail ils l’ont inscrit dans le rapport d’un de leurs membres les plus éminents, dans le rapport de Robespierre. En doutez-vous ? En voici les termes :
« Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ».
Dans cet article, que trouvez-vous ? Deux choses : le droit au travail…
(Exclamations diverses.) Plusieurs voix à droite : C’est là ce que nous voulons.
Le citoyen Ledru-Rollin. Dans cet article, que trouvez-vous ? Deux choses parfaitement distinctes : le droit au travail pour les valides, et le droit à l’assistance pour les infirmes, pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Or, ce double droit n’est pas consacré dans le projet actuel de votre constitution modifiée. Vous déclarez que vous ne donnez pas le droit au travail, vous dites simplement que vous donnez le droit à l’assistance, et ce sont deux choses entièrement différentes.
Quand un homme travaille, que vous le considérez dans vos domaines, vous vous sentez le cœur content ; il travaille pour vous, il travaille pour lui, il s’annoblit ; vous sentez que, malgré le salaire que vous lui donnez et malgré son infériorité dans l’échelle de l’éducation, vous sentez qu’il est homme comme vous. Mais quant à celui qui tend la main pour recevoir l’aumône… Oh ! j’en suis convaincu, vous la lui donnez, mais vous ne pensez pas, au fond de l’âme, qu’il est votre égal. (Si ! — Agitation.)
Non, vous ne pouvez pas le penser. Oh oui ! sans doute chrétiennement, philosophiquement, vous reconnaissez qu’il est votre frère, mais comme homme, comme citoyen, pouvez-vous dire que, quand il s’en va au coin d’une rue, furtivement, pour échapper à la loi qui le frappe, quand il attend le soir, quand il baisse la tête, quand il cache ses yeux, quand il ne veut-pas que, ses traits soient reconnus pour fuir la peine, comment, c’est là un membre du peuple souverain.(Oui ! Oui !) Oh non ! ce ne peut pas être. (Mouvement prolongé.)
Le citoyen Étienne Arago. C’est religieux, mais ce n’est pas politique !(Réclamations.)
Le citoyen Ledru-Rollin. Les réclamations que vous faites honorent votre cœur, mais permettez-moi de vous répéter que ce ne peut pas être un membre du peuple souverain, je vais vous le prouver.
Cet homme qui mendie parce qu’il ne peut pas trouver de travail. (Bruit. — Agitation.)
Cet homme qui mendie, un garde peut l’arrêter ; on le conduit devant la justice, et là, bien qu’il soit innocent, qu’il constate qu’il a vainement cherché à occuper ses bras, il est condamné à la prison et conduit au dépôt de mendicité.
Est-ce là un membre du peuple souverain ?… (Bruit. — Interruption.)
Si la chambre est à ce point irritable, qu’elle ne veuille pas écouler la discussion… (Parlez ! parlez !) Permettez, je n’entends pas qu’on me dise : Parlez ! Parlez ! quand je suis dans la question, dans les entrailles même de la question, et qu’on m’interrompe à chaque instant. Je demande qu’on m’écoute, ou, si on ne veut pas m’écouter, qu’il soit bien constant pour le peuple que telle est votre résolution, et je me retire… (Agitation.)
Voix diverses. Non ! non. — Parlez !… — Il ne faut pas dire l’Assemblée, quand il n’y a que quelques interrupteurs.
Le citoyen président. Je rappellerai nominativement à l’ordre les personnes qui interrompront.
Le citoyen Ledru-Rollin. Je dis que, dans cette situation humiliée, quoi que vous en disiez, quand un homme ne peut manger que sous peine de condamnation, cet homme peut être encore votre frère, mais il n’est pas votre égal, à vous qui pouvez manger sans être abaissés dans votre juste fierté et sans être condamnés. Non ! il n’est pas un membre, encore un coup, du peuple souverain, et la preuve, c’est que la distinction a été posée dans la constitution dont je parle ; elle a dit ceci :
« L’Etat devra du travail à ceux qui seront valides ; elle devra l’assistance à ceux qui seront infirmes ou qui ne pourront travailler. »
La convention sentait donc parfaitement qu’il y avait une distinction profonde, et que, si le travail honorait, l’assistance, pour l’homme qui était valide, ne l’honorait pas, et voici pourquoi la convention proclamait le droit au travail.
Maintenant je reviens à la thèse, et je dis : Vous avez invoqué les principes de la grande révolution, je les invoque. Vous avez déclaré que demander dans la constitution l’introduction du droit au travail, c’était se laisser entraîner à je ne sais quelle utopie socialiste ; je vous ai répondu : Non ; en demandant l’introduction de ce droit, nous avons la prétention d’être les continuateurs des grands principes de la révolution.(Bravos à gauche.) Oui, notre prétention est de n’être relégué à aucune extrémité, d’être dans le vrai, dans le cœur même de la révolution. Quand nous demandons l’introduction du droit au travail, nous ne faisons que réglementer les déclarations qui avaient été faites par nos pères et qui ont été emportées par le vent des réactions. (À gauche : Très bien !)
Maintenant, citoyens, qu’il est bien entendu que les socialistes, quels qu’ils soient, qui cherchent le remède au mal de la société, peuvent se tromper, mais que les socialistes ne demandent pas seuls l’introduction du droit au travail ; qu’en combattant pour la consécration de ce droit on n’est purement et simplement qu’un révolutionnaire démocrate, permettez-moi de définir ce que vous comprenez par socialistes.
Je ne comprends pas, je dois le dire, cette espèce d’insulte qu’on jette à la face en disant : Vous êtes socialistes. Qu’entendez-vous par là ? Entendez-vous dire : La révolution est faite, le principe seul étant proclamé ; mais il y aura interception entre le foyer et la circonférence, la lumière n’ira pas jusqu’au bout, le principe ne sera pas poussé aux conséquences ; le principe, seul, sera proclamé ; mais dans les institutions sociales on ne fera rien de démocratique. Si, enfin, par socialiste vous entendez tout démocrate qui veut la République avec ses conséquences sociales, vous confondez les mots ; avoir une telle résolution, c’est, être homme politique sincère ; voilà tout. (Très bien ! très bien !)
Nous ne demandons qu’une seule chose, qu’on pousse jusqu’aux dernières limites le principe de liberté, d’égalité et de fraternité. Quant à ceux qui peuvent demander plus ou par d’autres moyens, peu importe ! La question n’est pas là ; ce que je tenais à constater, c’est que nous ne sommes pas un parti extrême ; que nous sommes les continuateurs vrais, sérieux, fidèles, de la grande révolution. (À gauche. Très bien ! très bien !)
Maintenant, citoyens, j’aborde la question en elle-même. Cette question, je l’apprécie de deux façons : par mon cœur et par ma raison ; par mon cœur, quand je rencontre tous les jours dans la rue des gens en lambeaux, des familles de bohémiens, c’est l’expression, et quand, au milieu de nos campagnes, je vois des processions d’hommes hâves, de femmes fiévreuses qui viennent tendre la main ; quand, à les voir, mon cœur se contracte, quand ma journée en est longtemps troublée, je m’écrie : la société est impie ! l’homme tient de la nature le droit de vivre ; que la société le lui reconnaisse dans le droit au travail, ou malheur à elle ! (Longue agitation.)
Ces impressions que m’inspire l’indigence, j’en suis sûr, sont les vôtres. Sur quoi différons-nous ? Sur une seule chose. Nous prétendons, nous, que le remède est possible ; vous prétendez, vous, que la misère est le résultat de je ne sais quoi de fatal, et que l’humanité est enchaînée au mal. (Non ! non !) Oui, vous le prétendez, car souvent cela a été dit.
On a dit : Que voulez-vous, ce n’est pas en ce monde qu’il faut trouver des adoucissements à ces sortes de maux. Et le catholicisme, qui place dans le sacrifice, dans la douleur, la vertu même, et qui dit : Ce n’est pas dans ce monde qu’est la récompense, c’est autre part, le catholicisme croyait donc qu’il y avait impossibilité sur cette terre d’apporter un remède à des maux aussi poignants. (Mouvement en sens divers.)
À la suite de ce christianisme mal interprété, une école égoïste s’est produite qui a professé ceci : Il faut souffrir, s’incliner et attendre autre chose. Eh bien, je déclare que cette doctrine ne peut pas être la mienne. (Ce n’est pas la doctrine chrétienne !)
L’homme, incontestablement, est intelligence et matière à la fois. Or, j’entendais dire tout à l’heure ; Mais, les doctrines que vous voulez réhabiliter, en essayant d’apaiser la faim et la misère, ce sont les doctrines de la matière, ce sont les doctrines sensualistes. Vous prétendez qu’il est possible d’apporter des adoucissements aux douleurs du prolétariat, vous prétendez qu’il est possible, quand même, de cicatriser toutes ces plaies profondes ; mais ce n’est pas avec Cela qu’on fait les grandes choses ; c’est avec des idées et non des intérêts que des masses sont entraînées à la suite d’un drapeau, et qu’on conquiert le monde à la liberté.
Ce n’est donc rien de spiritualiste et d’idéal que de pratiquer la fraternité à l’égard de son semblable ; ce sentiment n’est donc plus celui qui fait vibrer dans le cœur humain les cordes incontestablement les plus nobles, les plus pures, les plus sympathiques. Quand ; en : effet, vous voyez souffrir quelqu’un des ; vôtres : quand vous voyez, comme je l’ai vu le 24 juin, à l’époque où j’étais membre du pouvoir exécutif, un homme venant me dire : « Je ne veux pas me battre, cependant ma femme m’y pousse depuis trois jours, Car j’ai sept enfants qui depuis trois jours meurent de faim. » Vous croyez que cet homme parlait à mes sensations matérielles ; quand, en le voyant, les larmes me, venaient aux yeux ; quand il s’adressait à ce qu’il y avait en moi de plus idéal, de plus élevé. Citoyens, lorsqu’on donne satisfaction aux besoins matériels de l’homme, on donne aussi satisfaction à son âme, car l’homme se compose d’intelligence et de matière, Vous dites que vous voulez, avant tout, satisfaire à l’intelligence. Eh bien ! voilà un homme qui pendant douze heures est courbé sur son métier, ou qui sous l’ardeur du soleil est obligé de chercher dans le sein de la terre la nourriture de ses enfants : où est la place pour son intelligence ? Comment voulez-vous que cet homme se dise qu’il y a quelque chose de supérieur à lui ? comment voulez-vous que cette génération qui marche pour ainsi dire dans la poussière de sa devancière, dans une ornière étroitement tracée, ait le temps de, rêver au ciel dont les splendeurs brillent vainement au-dessus de sa tête ? (Long mouvement.) Je dis que, pour que l’intelligence soit maîtresse, libre, qu’elle brise la captivité des sens, il faut aussi que les sens soient rassasiés.
Ainsi donc je ne distingue pas comme vous entre l’idéalité et la matérialité. L’homme est à la fois ; matière et intelligence ; eh bien, je veux que, dans la constitution, il y ait la satisfaction pour l’intelligence et pour la matière par l’éducation et par le droit au travail. (Approbation à gauche.) Voyons maintenant ce que nous dit la raison :
« Tous ces maux nous y sympathisons ; tous ces maux, nous voudrions y remédier ; mais le travail est limité. Prenez bien garde que vous voulez faire de l’Etat le directeur général, et, pour ainsi dire, le fabricant commun. »
Cela n’est pas exact, cela n’est pas ce que nous demandons, ce n’est pas ce que demandait la Convention.
En effet, la Convention disait : Il faut multiplier la propriété. Et cette doctrine était basée sur la nature même des choses ; elle disait : la France est avant tout un pays agricole ; c’est là qu’est sa principale force ; c’est là qu’a été la pensée de tous ses grands hommes d’Etat. L’industrie est secondaire ; l’industrie, pour la France, ne doit être, permettez-moi de vous le dire, que ce que serait la marine à voire force militaire, un auxiliaire, mais non pas le pivot fondamental. La Convention voulait donc que l’agriculteur fût sans cesse protégé par l’Etat, que l’agriculteur fût exonéré. Voilà ce que demandait la Convention, voilà ce que nous demandons. Et, à cet égard, il est une réflexion qui vous frappera tous.
Lorsque Turgot, ce grand homme d’Etat, cet homme de cœur, venait demander qu’on rendît le travail libre, qu’on brisât tous ses liens, le premier avocat général Séguier, s’opposant dans la séance du lit de justice à cette demande de Turgot, disait : mais songez-y, en rompant les jurandes, vous allez appeler à l’instant même tous les ouvriers des campagnes dans les grandes villes ; les grands centres vont décupler, les campagnes manqueront de bras. Voilà ce que disait l’avocat général Séguier.
Vous comprenez bien que je ne demande pas qu’on rétablisse les jurandes ; mais ce que je demande, c’est qu’on renvoie à l’agriculture, par la protection, par l’anoblissement de cet art, la grande quantité d’ouvriers qui pullulent et se corrompent dans nos villes (Très bien ! très bien !), nous sommes d’accord !
Voulez-vous un autre fait saillant. Il est un homme obscur qui depuis vingt ans travaille consciencieusement, n’ayant qu’une seule idée, à faire une statistique exacte de la richesse de la France répartie dans les différents départements. Vous comprenez qu’il est impossible, dans la rapidité de l’improvisation, de vous démontrer par quelles bases il est arrivé à ces résultats, je dois dire simplement ceci : Je les ai profondément étudiés, toutes ces bases sont authentiques ; elles sont toutes prises dans des documents do gouvernement. (Ce ne sont pas les meilleurs !)
Eh bien, il prouve que dans tous les départements qui autrefois étaient simplement agricoles, et qui, emportés par le courant des idées depuis, trente ans, ont voulu surtout se faire manufacturiers, industriels, dans ces départements la propriété foncière y est grevée jusqu’à cent quatre-vingt-douze pour cent de sa valeur. (Mouvement prolongé.)
La situation s’est tellement transformée, on a tant sacrifié à l’industrie, à la cupidité ou au désir exagéré de faire fortune, que le sol de la France se trouve dans cette situation de succomber sous la charge, sous l’usure, et de ne plus être la première force, la force la plus vitale du pays ; eh bien ! nous venons vous demander que vous fassiez pour la France ce que vous venez de commencer pour l’Algérie, et ce dont je vous remercie en passant ; que vous instituiez des banques de crédit, que l’usure cesse enfin, que la terre soit ramenée à sa véritable destination ; que la culture soit affranchie, et alors quand vous pourrez ainsi faire, quand vous pourrez défricher, cultiver vos landes, vos communaux, les domaines de l’Etat, quand vous pourrez occuper autant de bras, pendant tant d’années encore, ne dites pas que le travail est limité ; car alors le travail, comme la consommation, seront plus que doublés.
Si le travail n’est pas limité, il est donc certain que dans la constitution vous devez inscrire le droit au travail, car il y a à la fois équité et prudence.
Maintenant, que répond-on ? on me dit : il faut laisser la liberté de l’industrie s’organiser elle-même ; et qui donc veut y apporter une limite, est-ce moi ? Est-ce que, par hasard, j’ai la prétention que l’Etat se fasse manufacturier ou producteur ? je serais fou. Ma prétention la voici : c’est que l’Etat soit un directeur intelligent, entendez-le bien, c’est que l’Etat, par exemple, fasse pour cette grande masse de prolétaires, ce qu’il fait pour ses travaux publics, c’est qu’il sache où les adresser, sur quel terrain les asseoir, c’est qu’il sache ouvrir une banque là où le crédit est nécessaire ; en un mot, que, lui qui connaît la statistique par excellence, lui qui connaît ses ressources, ses forces, indique le lieu où il faut les employer, qu’il les associe ou leur facilite l’association, qu’il confie à leur moralité l’instrument de travail.
Est-ce que vous ne faites pas cela pour vos grands travaux publics, est-ce que vous ne le faites pas pour l’armée, pour tous les grands instruments que vous avez dans les mains. Il est donc certain que je ne veux faire de l’Etat ni un producteur, ni un manufacturier, je veux en faire un protecteur intelligent. (Vive approbation à gauche.)
Remarquez que tous les arguments qu’on nous oppose ici sur les impossibilités, on nous les a opposés pendant 18 ans ; pendant 18 ans du règne dernier, toutes les fois que nous réclamions une amélioration, on nous répondait : c’est impossible ! Quand, en 1775, on demandait de briser la chaîne des jurandes et des maîtrises, on répondait : c’est impossible ! Quand on demandait que l’impôt fût également réparti, le clergé et la noblesse ont répondu : c’est impossible ! Je ne me contente pas de ce mot. Ce mot peut être d’un homme, il n’est pas d’une grande nation qui a d’immenses ressources. (Approbation prolongée.)
Non, il n’est pas possible qu’on nous repousse sans cesse parce qu’il peut y avoir du nouveau dans les choses que nous demandons, car nous venons de voir une grande chose, et bien nouvelle cependant ; le 23 février, la plupart de ceux qui m’écoutent pensaient que le suffrage universel était un monstre qui ne pourrait pas se dompter (c’est vrai !) ; que c’était une chose qu’on ne pouvait point organiser ; que c’était une utopie, et cependant, en deux mois vous l’avez vu organisé, vous l’avez vu fonctionner.
Je vous le dis donc, ne vous payez pas de mots ; réfléchissez bien, citoyens, à notre grave et redoutable situation. Le peuple, encore un coup, en Février, n’a pas fait une révolution par pur intérêt, non ! on a eu raison de le dire, quand il a fait entendre ce mot sublime :
Je donne trois mois de crédit à l’Etat ; évidemment il ne pensait pas à ses entrailles qui criaient. Quand le peuple, pendant deux mois, venait pour ainsi dire chanter d’amour autour de son hôtel de ville, l’idée seule le soutenait : le peuple. en ce moment, ne pensait pas à ses besoins ; mais, si le peuple n’y pensait pas, notre devoir, à nous, c’est d’y penser.
On objecte encore que cette déclaration du droit au travail pourra gêner momentanément certaines industries ; on nous répond par des détails tellement minutieux que je ne devrais même pas en entretenir la tribune, s’ils n’avaient sans cesse rebattu nos oreilles.
On a dit : comment donner à un orfèvre, à un bijoutier, le droit d’ouvrir, de ses mains délicates, les entrailles de la terre ; mais c’est folie !
Réfléchissez à ceci ; quand vous parlez ainsi, vous, vous parlez pour un jour. Il est certain que si ces industries avaient besoin d’être employées, je ne demande pas qu’on leur ouvre des chantiers, ou de rudes labeurs les attendent ; ils y seraient impuissants. Pour ceux-là transitoirement l’assistance ; pour ceux-là, faites encore pendant quelque temps ce que vous faites aujourd’hui, mais remarquez bien que cela ne combat pas contre le principe que, je soutiens, car ceux-là, ne sont pas la masse, et la masse deviendrait volontiers concessionnaire de terres partagées pour les rendre fécondes. Quand je demande le droit au travail, que veux-je ? que vous l’inscriviez dans une constitution qui, apparemment, sera durable. Le peuple ne se soulève pas tous les jours pour faire des chartes. Or, quand vous inscrirez le droit au travail, vous ne serez pas forcés de l’avoir organisé dès le lendemain…(Réclamations diverses.)
Un membre. C’est évident !
Le citoyen Ledru-Rollin. Messieurs, je ne serai plus long, je ne veux point abuser de la patience de l’assemblée ; mais permettez-moi de vous dire que je ne comprends même pas qu’on se récrie sur des choses aussi naturelles et aussi simples. Ainsi, par exemple, vous allez décréter le droit à l’instruction ; mais quel est donc le fou qui pense qu’en vingt-quatre heures vous allez le réaliser ? Vous allez inscrire le droit à l’assistance ; mais quel est l’insensé qui s’imagine qu’en vingt-quatre heures vous aurez créé le personnel et les établissements ?
Comprenez-moi donc, je vous en conjure quand je demande que le droit au travail soit inscrit dans la constitution, c’est parce que les constitutions sont faites pour l’avenir, parce qu’elles doivent être durables, parce qu’elles sont des jalons dans la marche de l’humanité.
J’ajoute, en prenant en considération la faiblesse de l’infirmité humaine, que je ne demande pas que cette organisation soit créée en quelques jours ; je comprends qu’il y a, qu’il doit y avoir des transitions, des tempéraments ; mais de ce que je comprends qu’il y a des transitions nécessaires, est-ce une raison pour que ce droit au travail soit rejeté ? Posez votre but, pour que toutes vos lois y convergent incessamment.(Approbation.)
Je me résume :
On a dit le droit au travail, c’est Je socialisme. Je réponds : Non, le droit au travail, c’est la République appliquée. (Très bien ! très bien !)
Vous prétendez qu’il ne faut pas donner trop à de pareilles pensées, parce que, alors, les révolutions peuvent être entraînées hors de leur orbite. Je vous ré- ponds, moi, que c’est en ne donnant pas aux révolutions leurs conséquences que les gouvernements s’abîment et disparaissent. (Vif assentiment à gauche.) Pendant combien de temps avez-vous dit, avons-nous dit à la révolution de Juillet : « Voici le principe, eh bien ! marchez aux faits. » La révolution a résisté, et c’est pour cela que le trône de Juillet a été brisé. (Mouvement.)
Soyons plus prudent pour ce qui touche le droit au travail ; inscrivez-le de nouveau, parce qu’il est équitable, parce qu’il est politique de le faire. Inscrivez-le de nouveau, pour que dans les fastes de l’humanité nous n’ayons pas l’air de reculer à cinquante-cinq ans de distance, pour que nous ne soyons pas moins avancés que la révolution de nos pères. Inscrivez-le, parce que le peuple doit obtenir ce qu’il demande de juste, et que, dès 1834, il inscrivait à Lyon sur ses bannières : « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ! » En 1831, Casimir Périer avait promis aussi des institutions qui ressemblaient non pas à l’organisation du travail, mais qui ressemblaient à la protection du travail. Il n’a rien réalisé, mais l’idée jetée à Lyon, la formule flottant sur les bannières des insurgés, a fait son chemin, et, depuis ce temps, le peuple de Paris a répété, comme le peuple de Lyon : « Vivre en, travaillant ou mourir en combattant ! »
Ce cri, sinistre et redoutable au milieu du combat, gage de sécurité s’il est inscrit dans votre constitution, car ce peuple français est assez dévoué, quand cette satisfaction lui aura été donnée, pour attendre ; car il est trop pratique aussi pour ne pas comprendre que l’organisation n’est possible que successivement ; mais, encore un coup, inscrivez le principe, car si vous fermez la porte à toute espérance, j’appréhende pour la République de lamentables déchirements. (Mouvement prolongé.)
(*) On ne disait pas encore « babouviste ».