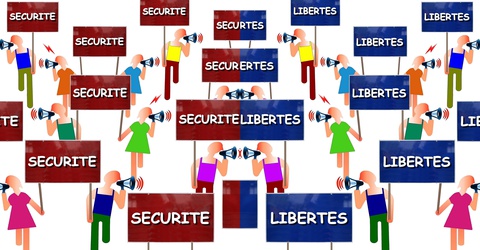Une idée très courante veut que le colloque de Villepinte des 24 et 25 octobre 1997 ‒ Des villes sûres pour des citoyens libres[1] ‒ ait constitué une rupture idéologique de la gauche en matière de sécurité ». L’idée d’un bloc des droites pensant uniformément la même chose en matière de sécurité est réductrice. C’est ainsi, par exemple, que les mots qui furent prononcés par le premier ministre Raymond Barre le 12 octobre 1979 en réception des propositions du Comité national de la prévention de la délinquance, étaient-ils dirigés contre une partie de sa propre majorité :
« Il faut tordre le cou à certaines idées reçues, comme celle qui voit dans la violence un mal nouveau dans nos sociétés, alors que la violence a toujours été présente dans les rapports entre les individus… Il faut que les Français soient informés honnêtement et sans complaisance des réalités de la violence dans le pays. Il serait illusoire de vouloir tenter de les rassurer par quelques déclarations lénifiantes qui perdraient vite leur crédibilité devant certaines réalités de la délinquance et de la criminalité. Mais il serait encore plus dangereux de chercher à les alarmer en exploitant artificiellement, au nom d’inavouables desseins, le sentiment d’insécurité qu’ils peuvent éprouver. Sur la violence comme sur les autres sujets, il faut savoir dire la vérité aux Français. »
L’idée d’un bloc des gauches pensant uniformément la même chose en matière de sécurité avant le colloque de Villepinte n’est pas moins réductrice si l’on pense aux « ajournements successifs » de l’abrogation par la gauche de la loi dite « Sécurité et Liberté » du 2 février 1981[2], à l’opposition résolue de Gaston Defferre en 1982, à l’abrogation des contrôles d’identité de police administrative[3], ainsi qu’à sa proposition, datée elle aussi de 1982, d’une modification législative qui permette aux policiers de pouvoir faire usage de leurs armes à feu dans les mêmes conditions que les gendarmes[4]. Au demeurant, même en admettant que les interventions du premier ministre Lionel Jospin et du ministre de l’Intérieur Jean-Pierre Chevènement au colloque de Villepinte n’étaient pas travaillées par le « paradigme du sentiment d’insécurité »[5], et que Lionel Jospin avait alors fait valoir que « la sécurité est une valeur de gauche », il n’est pas moins vrai que le Premier ministre avait alors parlé du « droit à la sûreté » plutôt que du « droit à la sécurité ». Or la littérature disponible sur le colloque de Villepinte ne permet pas de savoir si ce choix lexical avait été fait en connaissance de cause, autrement dit sachant que le « droit à la sûreté » est une catégorie constitutionnelle et conventionnelle[6] qui désigne l’interdiction des détentions arbitraires et que le « droit à la sécurité » était pour sa part une autre catégorie du droit français[7].
A regarder formellement les choses, le moment fondateur du débat français sur la sécurité est la loi du 2 février 1981 dite « Loi sécurité et liberté »[8] :
« Notre société souffre de la violence, dont les manifestations choquent et inquiètent les français (…). Certes, les statistiques font apparaître que l’accroissement réel de la violence est plus marqué dans le domaine de la petite et moyenne délinquance, que dans celui de la criminalité de sang. Le sentiment d’insécurité qui s’est répandu n’en traduit pas moins une réaction profonde de nos concitoyens ; ils refusent une situation qui, objectivement, s’est aggravée au cours de la présente décennie et qui, subjectivement, n’est pas tolérable dans un Etat de droit. »
L’articulation faite par cet exposé des motifs entre « sécurité » et « sentiment d’insécurité » est au fond le ressort le plus durable du débat des 40 dernières années.
S’agissant du sentiment d’insécurité, son statut politique a changé entre les années 1970 et aujourd’hui. Tout au long des années 1980, cette notion a continué de se prêter à une approche critique qui, peu ou prou, l’assimilait à une construction rhétorique et idéologique de « la droite » contre les libertés, mais une construction sans consistance sociale véritable. C’est cette critique que l’ancien ministre de l’Intérieur Pierre Joxe formulait dans ces termes en 1989 :
« Etre en sécurité, c’est être à l’abri et le savoir ou le croire. C’est être rassuré. C’est donc très subjectif : qui peut se dire ou se croire à l’abri de la mort ? La sécurité, c’est ce que les enfants attendent de leurs parents. Dans les pays riches, l’opinion publique l’attend de l’Etat : défense nationale, sécurité sociale, sécurité de l’emploi… Dans les pays pauvres, tout le monde le sait, la sécurité est réservée aux riches. Autant dire que la plus grande partie de l’humanité vit dans la plus grande insécurité. Les pays policés, c’est-à-dire les démocraties, connaissent la plus faible insécurité.[9] »
C’est cette appréhension de la notion de sentiment d’insécurité dont le colloque précité de Villepinte est réputé avoir été la critique dans le champ politique[10].
Loin d’avoir disparu, la contestation de la notion de sentiment d’insécurité s’est simplement décentrée pour ne plus être mobilisée que sur des points particuliers des politiques juridiques ou matérielles de sécurité. Tel semble être le cas lorsque les réponses juridiques des pouvoirs publics (autrement dit de nouveaux textes législatifs ou réglementaires) à des phénomènes tels que les bandes organisées, les violences dites urbaines ou collectives, le terrorisme, sont analysées comme une « instrumentalisation de la peur » des citoyens. Ce discours critique se donne à voir spontanément comme un discours moral. En réalité, il soulève de vraies questions. Des questions d’anthropologie politique, sur le fait de savoir si la peur n’est pas une émotion « inhérente » au lien politique. Des questions de philosophie politique : sur le fait, par exemple, de savoir s’il y a corruption ou accomplissement de la démocratie lorsque les citoyens, mus par une « peur sécuritaire », sanctionnent électoralement un Gouvernement ; sur le fait de savoir s’il n’est pas vain d’abstraire la « peur sécuritaire » de la compréhension de l’économie générale des sensibilités qui fonde la « société assurantielle »[11]. Peut-être faudrait-il interroger également cette autre figure classique du débat sur la sécurité qu’est la critique régulièrement faite aux pouvoirs publics de produire des « textes de circonstance » et/ou des « textes électoralistes ». Même s’il est vrai qu’elle est mobilisable et mobilisée sur d’autres enjeux, et qu’elle n’est peut-être qu’une facilité rhétorique pour celui qui la forme de contester la substance même d’un texte, cette critique a contre elle de ne pas analyser la législation sous le prisme ‒ imposé par le fait démocratique ‒ des interactions entre gouvernants et gouvernés.
Il reste à envisager[12] pour elle-même l’occurrence contemporaine à la sécurité. On s’arrêtera moins au fait qu’elle participe d’un « réseau de significations »[13], qu’au fait que sa centralité dans le discours juridique des pouvoirs publics procède d’un changement de « paradigme »[14], du moins pour qui sait que le droit public français fait traditionnellement de la « sécurité » une dépendance de l’ordre public alors que dans le lexique contemporain, c’est l’ordre public qui devient une dépendance, une « composante », de la sécurité. Cette inversion a au moins deux ressorts intellectuels. En premier lieu, elle tire la conséquence que ce que, dans la tradition française, « quand on emploie ce mot [ordre public], on pense d’abord à l’ordre dans la rue » (M. Hauriou). Or un certain nombre d’enjeux subsumés sous la notion de « sécurité » n’ont pas nécessairement la rue pour territoire. D’autre part, et surtout, cette inversion tire la conséquence de cette idée que l’économie contemporaine des menaces et des risques[15] n’est pas tout à fait figurable dans la notion d’ordre public.
La prospérité des dispositifs sécuritaires[16] a pour interface la question : Les libertés sacrifiées au nom de la sécurité ?[17] Plusieurs éléments caractérisent ce questionnement dans la littérature contemporaine. Il y a d’abord le fait que ce questionnement se déploie dans des discours aux statuts très différents, depuis des approches militantes jusqu’à des approches revendiquant un caractère authentiquement analytique, voire une certaine « neutralité axiologique ». D’autre part, cette interrogation est systématiquement assortie d’une référence critique à l’exception qui pose problème car non seulement cette référence est travaillée par une vision fixiste et naturaliste du droit, mais en plus elle légitime implicitement et a contrario des législations « ordinaires » ou une « normalité juridique » qui ne sont peut-être pas moins contestables. Sans compter que « [sa] visée critique [est] tantôt dissoute à force d’imprécision, tantôt radicalisée à outrance dans la dénonciation d’un état d’exception généralisé, prélude à la dictature »[18].
Ces considérations semblent devoir être prises en compte lorsque, par exemple, on se demande pourquoi l’efficacité des discours critiques des dispositifs sécuritaires est marginale. Autrement dit pourquoi ces discours n’ont finalement qu’une faible résonance juridique et judiciaire, les alternances politiques par exemple (aussi bien en France qu’à l’étranger) étant moins suivies du « démantèlement » des dispositifs existants que de leur « correction » (lorsque celle-ci a lieu). Les réponses à cette question de la stabilité des dispositifs juridiques de sécurité sont souvent structuralistes : la stabilité des dispositifs de sécurité comme « effet de structure » de ces dispositifs eux-mêmes ou comme conséquence des « logiques » gouvernant les institutions policières. Mais ces réponses n’aident guère les juristes (législateurs, juges, juristes-universitaires) à répondre à la grande question qui les intéresse spécialement : Que faire (au-delà d’une simple énonciation de « principes directeurs »[19]) ? Du moins si l’on considère que tel risque, telle menace ou telle urgence rapporté(e) par ceux qui en ont l’expertise existe bien et n’est pas seulement un « appareil idéologique ».
L’expertise des risques et des menaces (qu’il s’agisse de terrorisme ou d’enjeux environnementaux) pose en effet aux sociétés démocratiques et aux Etats de droit un problème dont les juristes mêmes ne sauraient faire abstraction dans leur conception ou dans leurs évaluations des dispositifs publics de sécurité. Dans certains cas, cette expertise qui décidera de dispositifs publics de sécurité, lorsqu’elle n’est pas contestée par d’autres expertises, a quasi-constitutivement une part aléatoire qui, selon les cas, relève de « l’incertitude » ou de « l’incertaineté »[20]. Les risques environnementaux ou technologiques en sont un exemple. Dans d’autres cas, l’expertise qui détermine les dispositifs publics de sécurité est en tout ou partie ignorée des citoyens, pour n’être connue que des décideurs eux-mêmes. Le terrorisme en est un exemple : le capital informationnel des pouvoirs publics en la matière est très largement « classifié »[21]. Or cette expertise à la disposition des pouvoirs publics mais inconnue de l’opinion, voire des institutions de contrôle[22], peut être biaisée. Autrement dit, les institutions de sécurité, ou bien peuvent se tromper sur les menaces et les risques ou bien peuvent les surévaluer, ce qui justifie d’autant leur propre utilité ou celle des dispositifs de sécurité qu’ils promeuvent[23]. La Commission européenne pour la démocratie par le droit [Commission de Venise] a bien montré que ces méprises peuvent tenir au fait que les informations des institutions de sécurité sont, pour une part, des « données solides » et, pour une autre part, des renseignements spéculatifs :
« Les données « solides », informations purement factuelles, ne suffisent pas pour une agence de sécurité ou pour toute organisation de police axée sur la sécurité. Il leur faut également réunir des renseignements spéculatifs afin de déterminer quelles sont les personnes qui menacent, risquent ou sont susceptibles de menacer la sécurité nationale. Ces informations sont obtenues de diverses manières. Une bonne part des renseignements de sécurité intérieure en provenance de sources non ouvertes provient d’informateurs. À l’instar des informations factuelles, ces renseignements « doux » peuvent, et doivent si l’agence fait correctement son travail, être collationnés pour donner naissance au profil de personnalité d’un individu ou à une analyse d’activité suspecte. (…) Fondamentalement toutefois, les agents de sécurité émettent un jugement de valeur sur la base des informations disponibles pour déterminer si un individu donné présente une menace pour la sécurité, et dans l’affirmative, ce qu’il prépare. Il s’agit en fait d’une évaluation du risque, ce qui implique nécessairement une forte dose de subjectivité l’évidence, il faut longtemps à un organe de surveillance extérieur pour pénétrer le monde mystérieux du renseignement, comprendre ce qu’est une évaluation « fiable » des informations et pourquoi il en est ainsi. À moins d’être en situation de mener une « seconde évaluation » raisonnablement bien informée, un organe de surveillance n’est pas un véritable garde-fou.[24] »
En l’état, les Sunset clause(s) sont la principale institution juridique libérale qui soit constitutivement liée à ce nœud gordien de l’incertitude, de l’incertaineté et de l’asymétrie informationnelle entre les gouvernants et les gouvernés. Elles sont néanmoins un objet plutôt sous-évalué de la littérature juridique française en général et de la littérature relative à la sécurité en particulier. Peut-être parce qu’elles participent moins de la culture juridique française (ou d’autres cultures juridiques en Europe) que de la culture juridique de sociétés politiques moins intéressées à faire des « systèmes » ou à envisager le droit comme un « art ». Autrement dit des pays qui envisagent la législation comme un bricolage, au sens que la théorie institutionnelle donne à l’expression « bricolage ».
——————————
[1] Les actes en ont été publiés par la Documentation française.
[2] Cette abrogation n’intervint qu’en 1983 et fut seulement partielle.
[3] P. Mbongo, La Gauche au pouvoir et les libertés publiques. 1981-1995, L’Harmattan, 1999, p. 240-245.
[4] Ibid., p. 244. Il est vrai que, depuis, cette proposition a régulièrement été faite à travers des propositions de loi déposées par des parlementaires de droite. C’est une autre manière d’envisager cette même question qu’a suivi Nicolas Sarkozy en proposant ‒ pendant la campagne présidentielle de 2012 et après une mise en examen pour homicide volontaire d’un policier ‒ la création d’une « présomption de légitime défense » en faveur des gendarmes et des policiers.
[5] On y revient plus loin.
[6] Article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
[7] L’article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité disposait déjà : « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens ». Cet énoncé a traversé les alternances politiques jusqu’à se retrouver, sous une forme plus longue, au fronton du Code de la sécurité intérieure (article L111-1).
[8] Et de ce que le projet de loi « renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes » a été déposée au Parlement en … 1979, il faut inférer que le débat sur la sécurité remonte en France aux années 1970 et non dans les années 1980 ni dans les années 1990 comme on peut me lire ici ou là.
[9] Entretien à la revue Autrement, février 1989, cité par Heilmann E., Parlons sécurité en 30 questions, La documentation française, 2012, p. 9.
[10] Une domestication universitaire et libérale de cette notion avait entre-temps été proposée par Sébastian Roché dans Le sentiment d’insécurité (PUF, 1993) et dans Insécurité et libertés (éd. du Seuil, 1994).
[11] F. Ewald, L’État providence, Grasset, 1986 ‒ F. Ewald, “Two Infinities of Risk”, in Brian Massumi (dir.), The politics of Everyday Fear, University of Minnesota Press, 1993, pp. 221-228.
[12] Certaines autres figures de référence du débat sur la sécurité doivent simplement être mentionnées. C’est le cas de la sollicitation (par les acteurs politiques et par les médias) de l’insécurité (ou du « sentiment d’insécurité ») comme grille explicative de certains résultats électoraux. C’est également le cas de la mise en cause des « médias » dans l’alimentation du « sentiment d’insécurité ». En fait de « médias », il ne s’agit jamais que de la télévision. On peut ne pas être convaincu de la manière dont les professionnels de la télévision se défendent de ces accusations, soit cette idée (ou cette mythologie professionnelle, l’expression n’a ici aucune portée critique, puisque toutes les professions ont leurs mythologies) selon laquelle « ils ne font que montrer » « une » ou « la » réalité. On peut ne pas être convaincu non plus par la manière dont certains acteurs politiques et journalistes peuvent mécaniquement inférer une « influence », par définition néfaste, des « médias » à partir de la simple constatation de l’augmentation à la télévision de « sujets » liés à la sécurité. Cette vision mécaniste perpétue dans le champ politique et médiatique un paradigme ‒ celui qui rapporte l’influence médiatique à l’action d’une « seringue hypodermique » ‒ qui n’a plus cours dans les études relatives à la « réception » des médias par les individus. On se permettra de renvoyer ici à nos textes « Les standards, creuset d’une théorie juridique de la réception médiatique » et « Qu’est-ce qu’une « information » au sens du « droit à l’information » ? », in La régulation des médias et ses standards juridiques, P. Mbongo (dir.), Mare et Martin, 2011.
[13] E. Heilmann, op. cit., p. 8.
[14] La doctrine juridique universitaire française n’a peut-être pas encore pris la mesure de cet aggiornamento. Des travaux pionniers existent néanmoins, ceux d’Olivier Gohin, l’ouvrage de Marc-Antoine Granger (Constitution et sécurité intérieure. Essai de modélisation, LGDJ, 2011) ou celui de Jérôme Millet (Autorités de police et sécurité locale, Mare et Martin, 2012). Dans une certaine mesure, ce retard du « droit public de la sécurité » à trouver une inscription universitaire doit à une division du champ juridique français qui fait que la focale des pénalistes est composée du droit pénal et de la procédure pénale ‒ sans égards par exemple pour l’important droit administratif de la police et de la gendarmerie ‒ lorsque la focale des spécialistes de droit administratif est principalement constituée du droit de la police administrative, dont la catégorie cardinale, l’ordre public, est réputée comprendre déjà la notion de sécurité. Il reste que, de la même manière que le rapprochement de la criminologie et des études policières a été fécond dans les sciences sociales de la sécurité (Voir dans ce sens l’important Traité de sécurité intérieure co-dirigé par Maurice Cusson, Benoît Dupont et Frédéric Lemieux, Ed. Hurtubise, 2007 – Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008), une plus grande figuration du droit public de la sécurité, en vis-à-vis du droit répressif, apporterait sans doute aux sciences juridiques de la sécurité.
[15] La réflexion sur la société du risque est très anciennement articulée autour des travaux d’Ulrich Bech et notamment de son ouvrage La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité (Flammarion, 2008 – Edition anglaise : 1992). Voir également P. Peretti-Watel., La société du risque, La découverte, 2010.
[16] Michel Foucault a une acception générique de la notion de dispositif et y intègre aussi bien les institutions que les discours, les textes de lois, les décisions administratives ou judiciaires, les données scientifiques, etc.
[17] D. Bigo, in Au nom du 11 septembre. Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme (sous la direction de D. Bigo, L. Bonelli et T. Deltombe), La Découverte, 2008, p. 5.
[18] S. Hayat et L. Tanguy, « Exceptions », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 20, 2011, p. 6.
[19] Voir par exemple en annexe au présent volume les conclusions de la Commission européenne pour la démocratie par le droit [Commission de Venise], Rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité, Venise, 1er-2 juin 2007. Le caractère général de ces conclusions de la Commission de Venise n’enlève rien au fait que son rapport est l’un des textes les plus avisés sur les agences de sécurité chargées de conjurer des menaces telles que le terrorisme.
[20] Voir à ce propos, dans le contexte d’une critique philosophique du « principe de précaution », J. P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Seuil, 2002 : « Toute prévision d’un état des choses qui dépend d’un savoir futur est impossible, pour la simple raison qu’anticiper ce savoir serait le rendre présent et le délogerait de sa place dans l’avenir. » (p. 133) ‒ « Les cas ne sont pas rares où la communauté scientifique est certaine à tort de l’inexistence d’un danger alors que celui-ci est objectivement incertain. » (p. 137).
[21] Il est souvent dit que la « définition formelle » (France) des secrets étatiques est moins libérale qu’une « définition matérielle » (Etats-Unis) qui consiste en une énumération des informations protégées. Or cette conclusion fait peu de cas de ce que dans les « définitions matérielles », les informations protégées sont elles-mêmes définies par des standards aussi vagues et généraux que « informations relatives à la sécurité nationale ». Sans compter que, dans le cas des Etats-Unis, le Freedom of Information Act (FOIA) ne s’applique pas, par exemple, à la Maison-Blanche, qu’il peut être nuancé par des textes propres à telle ou telle administration sensible, et que le FBI, la NSA ou la CIA ont même la faculté reconnue par les tribunaux de se retrancher derrière une Glomar response (elle consiste à ne pas confirmer ni infirmer la détention d’une information par l’une de ces administrations). Voir à ce propos :
Pascal Mbongo, E Pluribus Unum, Du creuset américain, Lextenso, 2017.
[22] Certains détails opérationnels de certaines agences publiques de sécurité peuvent ne pas être communiqués aux institutions de contrôle (c’est nécessairement le cas pour les opérations à venir ou en cours) et ces institutions elles-mêmes peuvent juger préférable de ne pas porter à la connaissance du public les détails dont elles ont connaissance (Commission européenne pour la démocratie par le droit [Commission de Venise], Rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité, Venise, 1er-2 juin 2007).
[23] Commission européenne pour la démocratie par le droit [Commission de Venise], Rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité, Venise, 1er-2 juin 2007.
[24] Commission européenne pour la démocratie par le droit [Commission de Venise], Rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité, Venise, 1er-2 juin 2007.
Source : Sécurité, libertés et légistique. Autour du Code de la sécurité intérieureté intérieure, 2012.