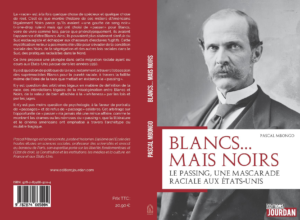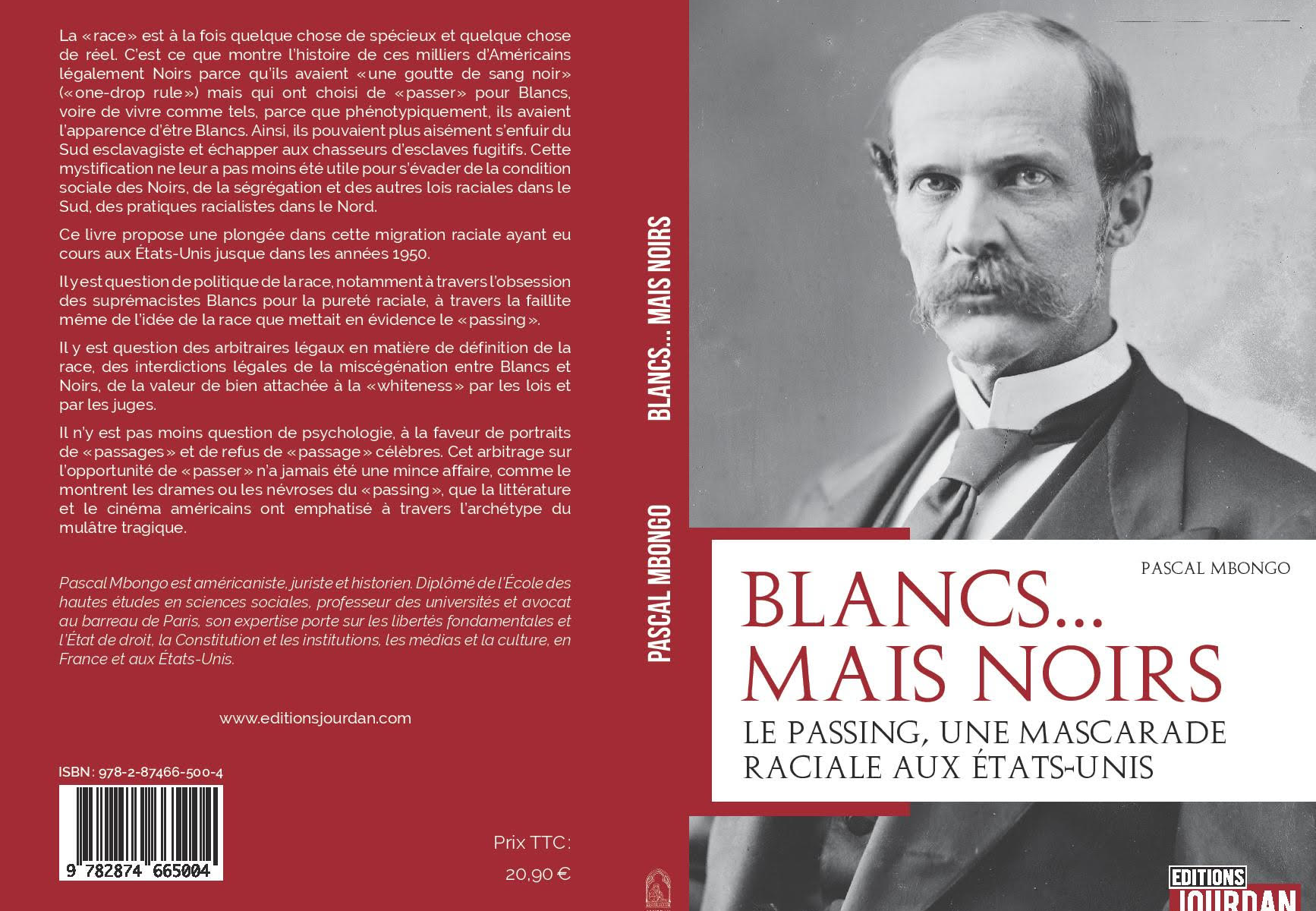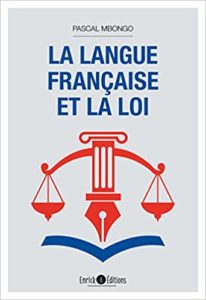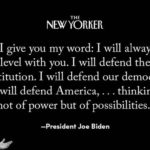Le journal Libération a consacré le 2 novembre 2018 un article roboratif sur la controverse qui agite certains milieux culturels parisiens en cette fin d’année. Faut-il « réguler » [« réglementer », en français conventionnel] les applaudissements lors des concerts classiques, compte tenu de ce que certains spectateurs semblent vouloir applaudir entre les mouvements d’une pièce plutôt qu’à la fin complète de l’œuvre. Les sociologues de la culture voudront noter combien les partisans de la tradition et des usages auront voulu éviter dans cette controverse de reconnaître la part de distinction tapie derrière leur respect de la convention.
Cette controverse fait penser à celle relative aux sifflets lors de concerts classiques, à cette précision près que la « querelle des sifflets » s’est souvent réglée au tribunal de police à la faveur de poursuites pénales dirigées contre des siffleurs ayant contrevenu aux règlements de police visant toutes sortes de trouble lors de représentations ou de spectacles. Le 8 juin 1904, trois siffleurs d’un Concerto de Beethoven joué à Paris trois mois plus tôt, Trotrot, Leprince et Blétry, comparaissent de ce chef devant le tribunal de simple police de Paris. Leur avocat, Maître Jacques Bonzon, prononça devant le juge Becker une plaidoirie aussi subtile en droit que savante en matière de concerts classiques. Le 6 juillet 1904, ses clients sont relaxés, le juge Becker définissant les sifflets comme étant un exercice du « droit légitime de critiquer l’œuvre représentée ».
LE JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE BECKER LE 6 JUILLET 1904 « ACQUITTANT » TROTROT, LEPRINCE ET BLETRY.
— Attendu que la prévention est fondée sur l’article 88 de l’ordonnance du préfet de police du 1er septembre 1898, qui est ainsi conçu : « Il est défendu de troubler la représentation ou d’empêcher le spectacle de quelque manière que ce soit » ;
Que cette disposition assure l’audition silencieuse de l’œuvre et réserve l’exercice de la critique après la fin de l’acte joué ou du morceau exécuté ;
Que, le 20 mars au Concert Colonne on jouait un Concerto de Beethoven, que ce Concerto était divisé en quatre parties, qu’il y avait un repos de deux minutes qui facilitait aux artistes leur réaccord, et au public la manifestation de ses sentiments ; que, la première partie du Concerto finie, de nombreux applaudissements éclatèrent, auxquels répondirent quelques sifflets, poussés notamment par les trois prévenus ; que les applaudissements reprirent, auxquels répliquaient les sifflets ; que des menaces furent même proférées contre les siffleurs qui durent être protégés par le commissaire de police de service ;
Que si les prévenus avaient applaudi au lieu de siffler, on ne leur aurait rien reproché, parce que la louange, même la plus bruyante, est loin de déplaire, tandis que siffler, même légèrement, c’est-à-dire critiquer, semble intolérable ;
Attendu que, si le public peut approuver, il a le droit d’exprimer son mécontentement; qu’en manifestant leur improbation sous une forme minuscule, pendant la suspension, entre les deux parties du Concerto, les prévenus n’ont fait qu’user du droit légitime de critiquer l’œuvre représentée, alors que l’audition était terminée au moins en une de ses parties.
PLAIDOIRIE DE Me JACQUES BONZON A L’AUDIENCE DU 8 JUIN 1904 DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE PARIS.
Avec deux lettres de MM. Camille Saint-Saëns et Vincent d’Indy.
MONSIEUR LÉ PRÉSIDENT, La question que soulève la poursuite de mes clients, MM. Trotrot, Leprince et Blétry, la classique question du sifflet est si connue qu’elle ne m’obligera pas à de longs développements, et l’acquittement que je sollicite en leur faveur sera aisé à obtenir en droit autant qu’en fait, avec les précédents comme avec les faits mêmes de la prévention.
Ces faits, vous les connaissez par le rapport de police, et l’audition des témoins n’a pu que les rendre plus clairs. Vous avez entendu M. Dhers, le commissaire de police, et M. Colonne, l’illustre chef d’orchestre, vous expliquer comment mes clients, le 20 mars dernier, avaient eu l’étrange audace de siffler un morceau d’orchestre que venait d’exécuter M. Padrewski. Ils ne le nient point eux-mêmes; s’ils ne vont pas jusqu’à s’en faire gloire ; ils revendiquent en tout cas leur droit absolu au sifflet. C’est une manifestation qu’ils ont voulu faire, une manifestation d’art et non point un enfantillage. A vous qui, même pour l’application des peines légères de la simple police, avez besoin de connaître les mobiles des actes reprochés à ceux que vous jugez, j’ai le devoir d’expliquer tout d’abord les sentiments qui ont mû mes clients et les ont amenés à employer ce mode de protestation qu’on peut trouver désagréable, irritant, discourtois même, que la loi autorise en tout cas, et qui n’est en somme que la contre-partie des applaudissements, souvent plus bruyants encore, mais toujours doux aux oreilles des artistes.
En quoi l’art peut-il se trouver mêlé à ce petit débat? Tout simplement parce que mes clients mélomanes, et même, pour l’un d’eux, musiciens (car M. Trotrot est élève de la Schola Cantorum), passionnés de musique et prétendant comprendre et goûter ce qu’on joue dans nos grands concerts, en ont reconnu le traversée qui risque d’y abaisser l’art sacré dont ils se sont établis les dévots. La virtuosité leur semble déborder toujours davantage dans les œuvres qu’exécutent nos orchestres. L’an dernier, et je m’appuierai tout à l’heure sur ce précédent pour la défense de ma cause, c’était chez Chevillard qu’ils allaient siffler. Aujourd’hui, par une équitable distribution de leur propagande, c’est chez Colonne. Partout ils entendent n’applaudir que les œuvres fortes, raisonnées, pensées. Partout ils haïssent la virtuosité, l’acrobatie de l’instrumentiste qui fait pâmer la foule devant l’agilité de ses doigts, tandis que la pensée disparaît sous le tour de force.
Certes, il est bien difficile de proscrire la virtuosité. Il faudrait d’abord la définir.
C’est affaire de sensibilité, non de raison. Où commence, où finit, comment se détermine la virtuosité ?
Cependant elle peut s’établir, sinon en soi, au moins par des exemples, par les œuvres mêmes qu’elle inspire, par certains genres musicaux plutôt que d’autres.
Mes clients d’estimer aussitôt que parmi tous ces genres, le plus exécrable, le plus notoirement corrompu par la virtuosité, c’est le concerto. Les concertos leur semblent dignes de mépris. Quelques-uns peuvent forcer leur estime ; la plupart, au moins ceux des compositeurs modernes, ne sont qu’un exercice de virtuosité.
L’approbation et le blâme appartenant au public dont on réclame les suffrages, ils ont donc revendiqué le droit de siffler en tout lieu les concertos qui leur déplairaient.
Le concerto leur paraît déplaisant et ils en donnent les raisons. Sans doute, profane que je suis, resté sur les marches du temple dont M. Colonne est grand-prêtre, revêtirai-je ces théories d’un style insuffisant, d’une langue obscure et pauvre; pourtant je voudrais m’y essayer en quelques mots.
Lorsque le concerto paraît, au XVIIIe siècle, et que Bach, puis Haendel lui donnent l’ampleur de leur génie, il exprime en quelque façon toute la lutte de l’âme. Ce n’est pas encore la symphonie, mais ce n’est déjà plus la sonate. L’âme a des frémissements multiples, dont l’un domine bientôt et guide le chœur des passions, amour, foi, pitié, tendresse ou haine. Chaque instrument de l’orchestre va faire vibrer chacune de ces cordes de l’âme, et la passion maîtresse aura pour la rendre l’instrument principal ; son chant sera le solo du concerto. Seulement les autres instruments ne se tairont point devant lui ; ils l’accompagneront de telle sorte, que le concerto devra s’achever dans l’harmonie magnifique, dans la fusion de tous les sentiments, dans l’eurythmie d’un chœur assez puissant pour éprouver tour à tour les mouvements divers, puis les fondre en un élan suprême.
Mais cette conception primordiale du concerto ne tarde pas à faiblir. Mozart apparaît, que l’Italie a enchanté de sa virtuosité exquise et trompeuse. Et le concerto se désorganise. Le sentiment principal, celui que chante l’instrumentiste accompagné par l’orchestre, devient le sentiment unique. L’orchestre n’a plus pour mission de l’entourer, s’unir à lui, et par ses chants variés réaliser enfin l’harmonie complète. Il n’est plus qu’un accompagnement destiné à mettre en relief la grâce du solo, l’habileté du soliste. Désormais il joue le rôle agaçant du’ chœur antique, évoluant autour du héros avec des jérémiades et des courbettes. Le désaccord éclate dans le concerto. La cadence abandonne au soliste la direction de l’œuvre, elle lui permet les fantaisies les plus pernicieuses, elle développe peut-être sa personnalité, en tout cas elle supprime celle de l’orchestre. Paganini filera sur une seule corde des cadences éblouissantes. La pensée aura replié ses ailes et déserté cette mécanique vide.
Voilà donc la thèse de mes clients. Prévoyant, encore une fois, l’insuffisance de ma démonstration, j’ai demandé aux artistes les plus notoires de m’indiquer si cette théorie était fausse, s’il était inadmissible qu’on pût désapprouver les concertos, ou si, au contraire, toute question de forme et de procédé réservée dans la lutte contre le concerto, cette lutte ne contenait pas quelque bon sens, quelque sentiment d’art qui pût du moins la préserver du ridicule.
Les réponses que j’ai reçues sont nombreuses, et par là même diverses. Émanant de maitres dont plusieurs sont illustres, et font chacun école, vous ne vous étonnerez point qu’elles soient même contradictoires. Cependant l’immense majorité donne théoriquement raison aux concertos. Serait-ce que nos correspondants en auraient commis ? De toute manière, la plus élémentaire loyauté, la plus simple gratitude pour la peine qu’ils prirent à me renseigner doit être de ne point travestir leur pensée. La place me fait défaut pour citer toutes ces réponses. M NT. Saint-Saëns, d’Indy, Fauré, Bruneau, Bourgault-Ducoudray, Gililmant, Widor, Vidal, Risler, de la Tombelle, Lazzari ont bien voulu m’apporter leur jugement au sujet du concerto. Tous n’ont pas à son endroit un égal enthousiasme. Un même le méprise franchement. Bref, de toute cette consultation, qui sera livrée en entier au public musical, je ne veux retenir ici que les deux thèses les plus nettes, les affirmations les plus significatives. Leurs auteurs ne sont autres d’ailleurs que nos deux plus grands maîtres de l’art contemporain : l’un, créateur incontesté et qui maintenant plane souverainement : l’autre, que la noblesse et la pureté de la pensée élèvent chaque jour dans l’admiration de la foule et le respect de ses disciples: MM. Camille Saint-Saëns et Vincent d’Indy.
Saint-Saëns est partisan convaincu et raisonné du concerto.
« CHER MONSIEUR, Vous désirez connaître mon opinion à propos de la question des concertos. Je pourrais me borner à approuver la lettre de mon illustre confrère Gabriel Fauré. Quand des maîtres tels que Beethoven, Mozart, Schumann, ont mis dans des concertos le plus pur de leur génie, il est absurde de venir traiter de haut un genre illustré de telle sorte, par de tels noms.
Mais je vais plus loin, c’est la virtuosité elle-même que je prétendrai défendre. Elle est la source du pittoresque en musique, elle donne à l’artiste des ailes, à l’aide desquelles il échappe au terre à terre et à la platitude. La difficulté vaincue est elle-même une beauté. Théophile Gautier, dans Emaux et Camées, a traité cette question en vers immortels.
Ceux-là seuls font fi des difficultés qui sont incapables de les vaincre. La virtuosité triomphe dans tous les arts, dans la littérature et surtout dans la poésie ; en musique, nous lui devons tous les merveilleux effets de l’instrumentation moderne, devenus possibles seulement depuis qu’elle a pénétré dans les orchestres.
Pour ce qui est du concerto, ce genre prétendu inférieur a cette supériorité qu’il permet à un exécutant de manifester sa personnalité, chose inappréciable quand cette personnalité est intéressante. Le solo de concerto est un rôle, qui doit être conçu et rendu comme un personnage dramatique.
Agréez, je vous prie, mes compliments empressés.
Camille SAINT-SAENS. »
Devant un pareil témoignage, j’avoue que j’ai tremblé. Mais peut-on dire, surtout en matière de musique, qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son. Celle de M. d’Indy est venue me réjouir de son timbre clair et entraînant. Et son opinion n’est pas moins affirmative, sauf à l’être en sens contraire de l’illustre Saint-Saëns, qui s’offre le raffinement de la virtuosité alors qu’il pourrait se contenter du génie.
À mon sens, il est indéniable que le concerto, en tant que forme musicale mise au service de la virtuosité, est un genre inférieur, un descendant très dégénéré actuellement de cette belle forme du Concert créée par les Italiens et admirablement employée par nos compositeurs français du XVIIIe siècle, et portée à son plus haut degré de puissance par Bach.
Depuis Bach, le Concert, manifestation le plus souvent collective, a tendu de plus en plus à se faire le serviteur d’un virtuose. Le XIXe siècle a été funeste en cette transformation et nous en subissons encore actuellement les conséquences.
Ceci est une question de principe et n’implique en aucune façon mon approbation à des manifestations extérieures trop bruyantes ; mais en présence de l’importance infiniment exagérée prise en ces temps derniers par le virtuose, on doit, sinon les approuver, au moins les excuser.
Deux affirmations diamétralement opposées, allez-vous dire ? La musique aurait-elle donc, elle aussi, son Hippocrate qui dit oui, tandis que son Galien dit non ?
Vous estimerez peut-être qu’en un si haut débat nous sommes incompétents et notoirement profanes. Aussi bien me garderai-je de le trancher, ni même de vous prier, Monsieur le Président, si convaincu que je sois de votre compétence, de le résoudre vous-même. Laissons ce soin aux critiques, aux chefs d’orchestre, aux mélomanes audacieux que nous avons fait défiler à votre barre. Constatons, quant à nous, que la question soulevée par mes clients était intéressante, qu’elle n’était point, comme ou l’a voulu affirmer à cause de leur âge encore tendre, une puérile plaisanterie, et que là où Vincent d’Indy et Camille Saint-Saëns dissertent, suivis d’une imposante théorie de compositeurs et d’exécutants, MM. Trotrot, Leprince et Blétry peuvent revendiquer quelque droit à voir juger sérieusement ce qui de leur part fut sérieux.
Serait-ce alors le procédé même qu’ils ont employé pour affirmer leur conception d’art qui deviendrait répréhensible, le moyen et non plus le mobile ? Nous retrouvons la classique question du sifflet au théâtre. Elle sera vite tranchée en notre faveur.
Je vous évite la sempiternelle citation du vers un peu trop défraîchi de Boileau.
Peu m’importe même que le sifflet soit un droit qui s’achète, ou qui s’obtienne naturellement, par là même qu’on est auditeur d’un spectacle public. Il me suffit de savoir qu’il est mieux qu’une tradition : une forme éternelle de la désapprobation du public. Désapprobation au moins chez les Français, car nos voisins, en Angleterre, pratiquent tout juste l’inverse; et M. Paderewski, choqué par nos sifflets, n’a qu’à traverser le détroit pour entendre les Anglais, enthousiasmés par son talent, le siffler avec frénésie, lui exprimant ainsi leurs transports. Mais nos ancêtres ont toujours sifflé qui leur déplaisait, ou ce qui leur déplaisait, — artiste inférieur (on aperçoit aussitôt qu’il n’a donc pu être question pour nous de siffler M. Paderewski lui-même) ou inférieure composition, fût-elle, j’ose à peine l’avouer, de Beethoven. Avant même que la musique s’empare des théâtres, l’art dramatique et comique subit les sifflets. Rome les entend sur ses scènes. Et l’on conte même que le pouvoir suprême couvre de sa protection cette forme de l’opinion publique. L’acteur Pylade ayant osé se rebeller contre le public qui le traitait aussi vilainement fut exilé, ni plus ni moins, par ordre de l’empereur Auguste.
Que n’avait-il la douce philosophie d’un auteur pourtant encensé, que ne se consolait-il à la manière d’Horace : Populus me sibilat at mihi plaudo ipse domi. Le public me siffle ; mais rentré chez moi je m’applaudis moi-même. Et si nous franchissons les temps où l’art languit, si nous regardons seulement la France dotée désormais d’une tragédie et d’une comédie neuves et fortes, nous retrouvons aussitôt le parterre acharné à siffler. Racine nous le prouve en une de ses épigrammes.
Quant à Pradon, si j’ai bonne mémoire,
Pommes sur lui volèrent largement.
Mais quand sifflets prirent commencement
C’est (j’y jouais, j’en suis témoin fidèle)
C’est à l’Aspar du sieur de Fontenelle.
Et la musique elle-même, dès son éclat naissant, ne restera pas indemne des désapprobations bruyantes, contre-partie forcée des applaudissements, revers naturel de la gloire. La rivalité des musiciens crée entre leurs partisans de véritables corps à corps. Rares sont les paisibles auditeurs qui tâchent de pratiquer la sagesse du poète antique. Cependant la réponse est célèbre, qui peut faire pendant au vers d’Horace. Deux mélomanes du XVIIIe siècle se jettent des regards furibonds en interpellant le spectateur qui les sépare. « Moi, Monsieur, clame le premier, je suis Picciniste. — Et moi, rugit l’autre, je suis Gluckiste. — Moi, fait le bonhomme, je suis ébéniste. »
Le sifflet se perpétue dans nos mœurs de gens dociles à toutes les fantaisies du Pouvoir, pourvu qu’on les raille. N’est-ce point, au reste, plus inoffensif encore que les chansons par lesquelles Beaumarchais prétend que tout finit en France, mais par lesquelles parfois finit aussi un gouvernement et même un régime ? Combien de ministres préféreraient le sifflet franc à la traîtresse interpellation !
Aussi la jurisprudence la plus haute, la plus considérable, la plus vénérable, celle de la Cour de Cassation en personne, consacre-t-elle de manière expresse le droit au sifflet. Vous connaissez les arrêts de 1840 et de 188). Vous savez que des siffleurs avaient été poursuivis déjà en simple police pour trouble apporté à la représentation — ce qui est précisément notre crime. Ils avaient été acquittés comme ayant usé d’un droit absolu. Le Ministère Public s’était pourvu contre ces décisions. La Cour de Cassation les déclara au contraire juridiques autant qu’équitables.
En 1845, deux étudiants prirent de l’ennui à une pièce signée pourtant d’un nom déjà célèbre. Mimi-Pinson, tirée de la nouvelle de Musset pour le théâtre des Variétés, leur parut chose puérile, ou peut-être attentatoire à la considération et au bon renom des écoles. Ils sifflèrent et resifflèrent. On les appréhenda, puis les traîna devant votre prédécesseur. Ce dernier, s’il en faut croire l’ouvrage très nourri de M. Astruc sur le Droit Privé du Théâtre, se contenta de les renvoyer absous. « Attendu que le droit d’exprimer son opinion sur les pièces de théâtre est consacré par l’usage ; que les prévenus en ont usé légitimement. »
Enfin c’est ma propre jurisprudence que je puis invoquer. Car mon client M. Trotrot n’est point aux débuts ici de son apostolat. Une action similaire lui a déjà révélé la majesté de la justice, comme aussi la constante équité de ses arrêts. Aujourd’hui Colonne, hier Chevillard. Le concerto nous paraît mauvais en tous lieux ; Bach, Haendel et Schumann seuls le surent réaliser. En tous lieux nous sifflons donc le concerto. M. Chevillard en prit ombrage et nous interdit l’accès de son concert, l’entrée, puis-je dire, du paradis. Nous le poursuivîmes. Nous plaidâmes devant le Tribunal de Paix du 9e arrondissement. Immédiatement l’accusation semblable se dressa : nos sifflets troublaient la représentation. Une enquête fut ordonnée par M. le juge Boyron ; elle fut complète, consciencieuse, mouvementée. Les employés du concert Chevillard nous accusèrent d’avoir empêché par nos sifflets la représentation de continuer ou de reprendre. Mais la vérité, à force d’être en marche, parfois aboutit. Notre innocence fut reconnue et, par jugement du 25 mars 1901, le Tribunal de Paix nous accordait 10 francs de dommages-intérêts, outre le remboursement du billet de location pris par nous pour le concert dont on nous avait refusé l’accès. Ce jugement faisait bien mieux et bien plus, il reconnaissait par là même notre droit au sifflet, droit que déjà avait fait ressortir la discussion soulevée sur ce sujet au Conseil municipal, le 28 novembre 1902, par M. Adrien Mithouard.
Car la jurisprudence se peut ramener à un fait très simple. A-t-on, ou n’a-t-on pas troublé la représentation? A lui seul, retenons-le bien, le sifflet n’est pas, ne peut jamais être un trouble. Le texte visé par la prévention, l’article 88 de l’ordonnance du Préfet de Police, en date du1er septembre 1898, qui défend, à peine d’application de l’article 471,§ 1 S du Code Pénal, c’est-à-dire de 5 francs d’amende, de troubler les représentations publiques, cette disposition de police ne peut s’appliquer au sifflet ordinaire. Celui-ci est licite à l’égal de l’applaudissement. Pourtant la claque n’est-elle pas aussi gênante souvent, par ses niaises prétentions à l’infaillibilité, ses ruades d’enthousiasme intempestif ou ses admirations de valet ?
Le sifflet n’est point un trouble au sens répréhensible du droit criminel.
Il peut le devenir, je l’accorde. Qu’il se prolonge, que sa persistance empêche la représentation de continuer ou de reprendre, et l’abus du droit apparaît. Mais comment avons-nous sifflé ? Dernière et facile question.
Le rapport de M. Dhers, le commissaire de police qui nous a dressé contravention, est très net. « Des sifflets, dit-il en substance, ont éclaté après le concerto de Beethoven, provoquant un redoublement d’applaudissements. » Donc, nos sifflets ne se sont pas produits durant l’exécution du morceau joué par M. Paderewski. Ils n’ont même pas eu lieu les premiers. S’ils ont provoqué un redoublement d’applaudissements, c’est apparemment que ceux-ci avaient commencé; et les témoignages que vous venez d’entendre le font sans peine comprendre.
Un concert est annoncé chez M. Colonne avec le concours toujours recherché de M. Paderewski. La salle est comble. L’Amérique, connue pour sa compétence en art, a envoyé ses mondaines les plus ferventes, la Pologne, dont M. Paderewski constitue l’ultime gloire, est accourue frémissante. Le concerto de Beethoven vient à l’instant de s’arrêter après le premier mouvement, l’entr’acte régulier et normal s’ouvre à peine, que la furie des applaudissements trépigne Mes clients trouvent cette allégresse blâmable. La foule pense à l’exécutant ; eux songent au morceau exécuté. On acclame Paderewski ; ils gémissent sur le concerto. Et leur courroux juvénile s’exhale en sons plaintifs ou stridents, suivant la force de leur souffle ou l’acuité de leur sifflet à roulettes.
Une pareille profanation plonge la salle presque entière, l’Amérique et la Pologne, dans une stupeur que soudain la fureur remplace. On se précipite sur les siffleurs, on les injurie, on les conspue, on les bouscule. Et voilà qu’une intervention se manifeste, dont le comique paraîtrait intense si la Pologne et l’Amérique pouvaient rire en ce moment. M. Colonne harangue les manifestants. Il l’a reconnu tout à l’heure avec cette bonne grâce, cette largeur et cette tolérance qui apaisent l’âme de tous les grands et vrais artistes. Qui harangue-t-il ? Les siffleurs, et pour les maudire? Point. C’est aux applaudisseurs, si je puis risquer ce néologisme, que son discours s’adresse. « Ce sont les amis de l’ordre, proclame-t-il, qui troublent la représentation. Quant aux porteurs de sifflets, libre à eux d’en user si cet instrument discordant leur agrée. »
Hélas ! même la pure musique, même les exhortations d’un pur musicien n’apaisent point les mœurs brutales de la foule. Il faut que M. Dhers arrive dans sa dignité redoutable, ceint de son écharpe et, emblème plus énergique, flanqué de gardes municipaux. Mes clients ne sont sauvés du Charybde de la foule hurlante que pour s’abîmer dans la Scylla policière.
Les paroles de M. Colonne ne suffisent-elles point, après le propre rapport de M. Dhers, à nous innocenter? Nos sifflets ont répondu à des applaudissements, et durant un entr’acte, Ils n’ont donc fait qu’affirmer notre droit de blâmer comme nos voisins avaient celui d’approuver. En fait, tout le débat se réduit à ceci : nous avons trouvé un concerto mauvais, et les auditeurs de M. Colonne l’ont jugé sublime; les auditrices surtout, car notre histoire, que je n’ai pas faite assez brève, est en outre ancienne. Orphée déjà fut mis en pièces par les Ménades, qui constituaient sans doute en musique une école rivale, un Conservatoire intransigeant. Je vous demande de ne pas achever l’œuvre des admiratrices de M. Paderewski, fût-ce en mettant mes clients en pièce à raison de 5 francs d’amende. Ils ont triomphé dans toutes leurs luttes pour l’art pur et contre le concerto corrupteur. Ils ont trouvé justice devant le Tribunal de Paix du 9e arrondissement. Ils ont pour eux la jurisprudence de la Cour Suprême ; ils ont l’approbation de la foule et du parterre ; ils recevront l’absolution d’un juge parisien et spirituel.