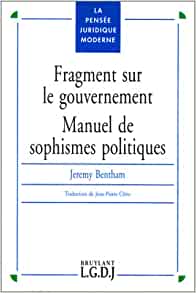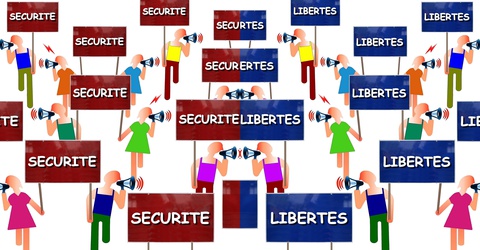Outre une étude sur les fictions dans l’oeuvre de Jeremy Bentham(2), l’on dispose depuis 1995 d’une nouvelle édition du grand oeuvre du philosophe Élie Halévy (3) et d’une traduction du Fragment sur le gouvernement de Bentham (4). À quoi il faut ajouter la publication en 1995 d’un numéro très remarqué de la Revue du mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales(5) qui, sous le titre Qu’est-ce que l’utilitarisme ? Une énigme dans l’histoire des idées, se proposait « non seulement [de] rendre compte du débat qui se noue aujourd’hui en France, après un siècle d’oubli, sur la signification de l’utilitarisme, mais aussi d’y prendre position et, dans une certaine mesure, de trancher »(6). De même peut-on relever la publication plus récente d’un certain nombre de traductions et de recherches sur Bentham ou ses héritiers(7) en attendant la parution de deux références importantes que sont : Introduction to the Principles of Morals and Legislation de Bentham et The Methods of Ethics d’Henry Sidgwick.
La relative indifférence dont l’utilitarisme a quelque peu souffert en France était pour le moins singulière, rapportée au fait qu’il s’agit de la doctrine qui, «statistiquement [est] la plus discutée dans le monde anglo-saxon de toutes les théories morales » (8). Cette centralité de l’utilitarisme est elle-même liée à la présence quasi universelle des thèses utilitaristes dans les différents champs de la connaissance sociale. En effet, l’utilitarisme ne se décline pas seulement dans l’économie politique classique (9) et néo-classique (10), notamment lorsque celle-ci justifie le libre-échange ou exalte la main invisible et la division du travail. Il se décline par ailleurs de très nombreuses manières dans la réflexion juridique, et en particulier à travers la mise en cause de «l’envahissement » du jeu social par des règles de « droit public » promues sous le couvert de notions telles que le « service public », les « nationalisations », la « sécurité sociale » (11). Pour être fécondes en débats juridiques potentiels, certaines autres déclinaisons de l’utilitarisme sont cependant moins connues. Ainsi, en matière sociologique par exemple, les théories relatives aux choix rationnels de l’électeur y ont largement puisé. De même, les travaux du prix Nobel d’économie (1992) Gary Stanley Becker et de l’École de Chicago tendant à mettre en évidence la dimension utilitaire de nombre de comportements humains (le choix du conjoint, la décision de divorce, le choix du mode d’éducation des enfants, la rationalité des choix criminels, etc.) ne sont pas étrangers à l’utilitarisme (12). De manière plus remarquable encore, la relecture de Darwin par le sociobiologiste anglais Richard Dawkins et sa «théorie du gène égoïste » (13) avec les conséquences que cette théorie peut avoir en matière biologique ou médicale ne se comprennent guère indépendamment du ressort utilitariste des analyses de Dawkins. Autrement dit, l’on ne soupçonne pas le nombre de valeurs (le bonheur, l’altruisme, la solidarité, etc.) ou de débats juridico-politiques contemporains (l’avortement, l’euthanasie, la prostitution, les stupéfiants, la sécurité, le port d’armes, les polices privées, la prétention de l’État à protéger l’individu contre le mauvais usage de sa liberté, etc.) pour lesquels il existe un ou plusieurs points de vue utilitaristes (14). Encore ne saurait-il y avoir de compréhension des débats autour de la théorie de la justice de John Rawls sans retour à l’utilitarisme, puisque, en effet, Rawls ne désigne rien moins que l’utilitarisme comme le repoussoir de sa propre réflexion (15) .
Si donc la centralité de l’utilitarisme dans les morales dites conséquentialistes est une raison de s’intéresser à ce courant de pensée et de suivre le débat qu’il suscite en France, force est cependant de constater que cette entreprise est rendue quelque peu ardue par la multiplicité et la complexité des questions pertinentes autour de l’utilitarisme (16). Entre autres questions pertinentes sur le moment benthamien, il est loisible de s’attacher principalement à celles se rapportant, d’une part, à la définition même de l’utilitarisme et à sa généalogie, d’autre part, à la philosophie morale utilitariste telle qu’elle se décline chez Bentham. Ainsi, en supposant qu’une réflexion sur le lien politique dans l’utilitarisme benthamien engage à y rechercher, d’une part, le fondement de l’autorité, de l’allégeance, en un mot du pouvoir, et d’autre part, la vocation et les limites de ce pouvoir, alors l’originalité de Bentham n’est-elle pas dans son rejet de différentes définitions de ce lien en vogue au XVIIIe siècle. Ce en quoi Bentham semble se distinguer, c’est par le fait qu’en retenant le principe d’utilité comme étant le fondement de l’obéissance et la limite du pouvoir et du droit, il arrive à surmonter la dissonance apparente entre l’atomisme social caractéristique de sa doctrine et l’idée même d’un lien politique.
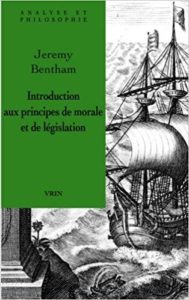
I. Questions de définition et de généalogie
Dans son Vocabulaire technique et critique de la philosophie, André Lalande donnait à considérer la notion d’utilitarisme comme désignant principalement « toute doctrine qui fait de l’utile (…) le principe de toutes les valeurs, dans l’ordre de la connaissance comme dans celui de l’action » (17) .
« Spécialement », écrivait-il encore, l’utilitarisme est « la doctrine morale et politique de Bentham et de John Stuart Mill, telle qu’elle est exposée notamment dans son « Utilirianism » (1863) (18) : « The creed which accepts as the foundation of morals utility, or the greatest happiness principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the revers of happiness. By happiness is intended pleasure and the absence of pain ; by unhappiness, pain and the privation of pleasure » (19) » (20) .
La définition d’André Lalande présente l’inconvénient de ne retenir de l’utilitarisme que ce que l’on a appelé sa proposition normative (21) – qui veut que puissent « être qualifiées de justes et vertueuses les actions qui contribuent à accroître le bonheur de tous ou du « plus grand nombre » » (22) – et non sa proposition positive qui postule pour sa part que « les hommes tendent à rechercher le plaisir et à éviter la douleur et qu’ils calculent leurs actions en vue d’arriver à cette fin » (23). Cette ambivalence de l’utilitarisme se vérifie d’ailleurs à la lecture de Bentham lorsque celui-ci écrit que « le bonheur public doit être l’objet du législateur : l’utilité générale doit être le principe du raisonnement en législation. Connaître le bien de la communauté dont les intérêts sont en question, voilà ce qui constitue la science ; trouver les moyens de la réaliser, voilà ce qui constitue l’art » (24) .
La définition de l’utilitarisme proposée par André Lalande laisse par ailleurs apparaître les difficultés qui s’attachent à l’établissement d’une généalogie de l’utilitarisme puisqu’il est pour le moins singulier de constater que Lalande y établit une continuité entre Bentham et John Stuart Mill, alors que cette continuité est loin d’être communément admise (25). Aussi est-ce avec une certaine circonspection qu’il faut recevoir aussi bien la filiation entre Hume, Helvétius et Bentham d’une part (que Bentham a cependant lui-même revendiquée, s’agissant en tout cas d’Helvétius) et, d’autre part, cette affirmation de John Stuart Mill selon laquelle il y aurait quelque « ignorance de l’histoire de la philosophie, si l’on oubliait qu’à travers tous les âges de la philosophie, une des écoles a été utilitaire, bien avant Épicure », mais qu’il était « certain que le grand penseur anglais, qui a fait de la doctrine de l’utilité la grande force réformatrice de la législation et de la jurisprudence [il s’agit de Bentham], a pris dans Helvétius l’idée de l’utilité générale comme base de la morale » (26) .
II. L’arithmétique morale de Bentham
C’est moins dans la première publication de l’intéressé – le Fragment sur le gouvernement paru en 1776 (27) – que dans son Introduction aux principes de morale et de législation (écrite en 1780 mais parue seulement en 1789 (28 ) que le projet de Bentham est exposé en des termes quasi définitifs. « La nature », écrit-il, « a placé l’humanité sous le gouvernement de deux maîtres souverains, la peine et le plaisir. C’est à eux seuls de montrer ce que nous devons faire, aussi bien que ce que nous ferons. La distinction du juste et de l’injuste, d’une part, et, d’autre part, l’enchaînement des causes et des effets, sont attachés à leur trône. Le principe d’utilité constate cette sujétion, et la prend pour fondement du système dont l’objet est d’élever l’édifice de la félicité par la main de la raison et de la loi. Par le principe de l’utilité, on entend le principe qui approuve ou désapprouve une action quelconque, selon la tendance qu’elle paraît avoir à augmenter ou diminuer le bonheur de la partie intéressée ; ou, ce qui revient au même, à favoriser ou à contrarier ce bonheur. Je dis : d’une action quelconque, et par suite, non seulement de tous les actes d’un particulier, mais de toute mesure gouvernementale » (29) .
Cette déclinaison par Bentham de sa doctrine appelle quelques observations. En premier lieu, s’il est vrai que Bentham parle dans ses premiers textes du principe de l’utilité, l’on trouve plus tardivement chez lui une référence au principe du plus grand nombre et au principe de la plus grande félicité (30).
Il ne semble cependant pas qu’il faille voir dans cette substitution de termes autre chose qu’une commodité didactique, une sorte de « nouveau baptême » (31), une manière pour Bentham de « mieux [mettre] en relief les idées de plaisir et de douleur » (32) de la doctrine utilitaire, celle-ci ne continuant pas moins d’être dominée par le calcul de l’utilité mesurée en termes de plaisir et douleur (33). D’autre part, et comme l’a fait remarquer Élie Halévy, dans la perspective de Bentham, la morale et la législation ne sont guère différenciées, la seconde étant à ses yeux « une branche particulière » (34) de la première. « La morale et la législation », écrit Élie Halévy, « ont même principe, même méthode (…). Ou bien donc l’homme dont je me propose de diriger les actions, ce sera moi-même ; alors la morale sera l’art du gouvernement de soi, ou la morale privée. Ou bien les hommes dont je dirigerai les actions seront des hommes autres que moi-même. S’ils ne sont pas adultes, l’art de les gouverner s’appelle l’éducation, elle-même privée ou publique. S’ils sont adultes, l’art de diriger leurs actions en vue de produire le plus grand bonheur au plus grand nombre relève soit de la législation, si les actes du gouvernement sont de nature permanente, soit de l’administration, s’ils sont de nature temporaire, s’ils sont commandés par les circonstances » (35) .
Or aux yeux de Bentham, il n’y a précisément pas de contradiction dans le fait pour l’utilitarisme de se vouloir une doctrine morale et la prétention rationaliste dont il voulait faire le soubassement de sa réflexion. Cette prétention rationaliste se vérifie de deux manières. Elle demande d’abord à Bentham d’établir l’unité de son principe ; il le fait négativement par l’exclusion de tout « ce qui n’est pas lui », et ce rejet vise aussi bien le principe de l’ascétisme que le principe arbitraire (« principe de sympathie ou d’antipathie »). Le principe d’ascétisme, écrit-il, « comme le principe de l’utilité, apprécie les actions humaines, selon la tendance qu’elles paraissent avoir à augmenter ou diminuer le bonheur de la partie intéressée ; mais qui, à l’inverse du même principe, approuve les actions dans la mesure où elles tendent à diminuer son bonheur, les désapprouve dans la mesure où elles tendent à l’augmenter » (36). Cependant, « quelque mérite qu’un homme ait pu croire qu’il y avait à se rendre malheureux, il ne semble pas qu’il soit jamais venu à l’esprit de personne qu’il peut y avoir mérite, encore moins obligation, à rendre les hommes malheureux ; cependant, il apparaîtrait que si une certaine quantité de malheur était une chose si désirable, peu importerait qu’elle fût imposée par un homme à soi-même, ou par un homme à un autre homme » (37). Autrement dit, c’est parce que le principe d’ascétisme ne paraît pas à Bentham « susceptible d’universalisation » (38) qu’il se refuse à le considérer comme le fondement éventuel d’une « science du gouvernement ». Quant au principe arbitraire, il désigne chez Bentham (39), « tous les principes, à l’exclusion du principe ascétique que les philosophes ont successivement proposé pour fonder la morale » (40) , soit : la raison, qui n’est pour Bentham, que « l’obligation de viser au plus grand bonheur du plus grand nombre » (41) ; le droit, dans lequel Bentham voit ce qui est conforme à l’utilité ; ou les lois naturelles, qui ne sont encore à ses yeux que des « prescriptions ou « dictées » de l’utilité.
Positivement, la prétention rationaliste de Bentham se réalise dans sa recherche des « procédés d’une arithmétique morale, par laquelle on puisse arriver à des résultats uniformes » (42) . « Les fins que le législateur a eu en vue », commente Élie Halévy, « ce sont le plaisir et l’absence de peine : il faut donc qu’il en connaisse la valeur. Les instruments qu’il doit employer à produire ces fins, ce sont encore les plaisirs et les peines ; les quatre sanctions que Bentham énumère, politique, morale, religieuse et physique, se ramènent toutes à la dernière, consistent toutes dans l’espérance de certains plaisirs, dans la crainte de certaines peines, dont il importe, à ce point de vue encore, qu’il connaisse la valeur. Donc la science de la législation suppose, pour condition première, qu’une comparaison quantitative des plaisirs soit possible» (43 ).
Entre autres questions que soulève la fameuse arithmétique morale de Bentham, il y a précisément celle de savoir si de ce que le benthamisme est une morale du bonheur, il faut y voir un hédonisme. Dans le sens d’une réponse négative, Georges Burdeau faisait valoir que pour Bentham, « ce bonheur que l’homme poursuit en suivant son intérêt, il l’achète avec du travail, avec de la peine. Par là, la traditionnelle valeur puritaine de l’effort se trouve réintégrée au sein d’une doc trine qui, de prime abord, semblait l’exclure. Le bonheur », poursuivait Burdeau, « c’est l’héritage de Voltaire et d’Helvétius, mais le bonheur par la sueur, l’abstinence et le zèle, c’est _ quoique vidé de toute signification religieuse – l’héritage évangélique » (44). Or aux yeux de Bentham, rien n’était plus étranger à son principe que l’ascétisme des stoïciens ou celui des jansénistes qui reposaient tous deux sur une conception erronée de l’utilité. « On a reconnu de bonne heure », écrit-il, « que l’attrait des plaisirs pouvait être séducteur dans certaines circonstances, c’est-à-dire porter à des actes pernicieux, à des actes dont le bien n’était pas équivalent au mal. Défendre ces plaisirs en considération de ces mauvais effets, c’est l’objet de la saine morale et des bonnes lois ; mais les ascétiques ont fait une méprise, ils se sont attaqués au plaisir lui-même, ils l’ont condamné en général, ils en ont fait l’objet d’une prohibition universelle, le signe d’une nature réprouvée, et ce n’est que par égard pour la faiblesse humaine qu’ils ont eu l’indulgence d’accorder des exemptions particulières » (45 ).
III. Les repoussoirs de Bentham
Que ce soit dans le premier chapitre du Fragment sur le gouvernement (46) que Bentham ait donné la charge contre le contractualisme est somme toute logique. Son texte n’est en fait rien moins qu’une réfutation des Commentaries on the Laws of England de son ancien maître d’Oxford, Blackstone, commentaires qui s’ouvrent précisément par une explication contractualiste du pouvoir. « En conversant avec les juristes », ironise Bentham, « je les ai trouvés entichés des vertus de leur contrat originel qu’ils considèrent comme un expédient d’une efficacité souveraine pour concilier la nécessité de résister occasionnellement avec le devoir général de soumission. On m’administra cette potion de leur cru pour calmer mes scrupules. Mais mon estomac inaccoutumé se révolta contre leur sédatif. Je les priais de me montrer la page d’histoire où l’on relatait l’événement solennel de cet important contrat. Ils se récusèrent à ce défi et en furent réduits, quand ils y furent contraints, à ce que notre auteur [il s’agit de Blackstone] a fait : à avouer que tout cela n’était que fiction. (…) » (47) .
Ce rejet du contractualisme est exprimé avec la même autorité dans l’introduction aux principes de morale et de législation : « Ce qu’il y a de commun dans ces trois systèmes si directement opposés », écrit Bentham, « c’est de commencer toute la théorie politique par une fiction ; car ces trois contrats sont également fictifs. Ils n’existent que dans l’imagination de leurs auteurs. Non seulement on n’en trouve aucune trace dans l’histoire mais elle fournit partout les preuves du contraire. Celui de Hobbes est un mensonge manifeste. Le despotisme a été partout le résultat de la violence et des fausses idées religieuses. S’il existe un peuple qui ait remis par un acte public l’autorité suprême à un chef, il n’est pas vrai que ce peuple ait exprimé qu’il se soumettait à toutes les volontés cruelles ou bizarres du souverain… Le contrat social de Rousseau n’a pas été jugé si sévèrement, parce que les hommes ne sont pas difficiles sur la logique d’un système qui établit tout ce qu’ils aiment le mieux, la liberté et l’égalité. Mais où s’est formée cette convention universelle ? Quelles en sont les clauses ? Dans quelle langue a-t-elle été rédigée ? Pourquoi a-t-elle toujours été ignorée ? Est-ce en sortant des forêts, en renonçant à la vie sauvage qu’ils ont eu ces grandes idées de morale et de politique, sur lesquelles on fait porter cette convention primitive ? Le contrat de Locke est plus précieux, parce qu’en effet il y a des monarchies dans lesquelles le souverain prend quelques engagements à son avènement au trône et reçoit des conditions de la part de la nation qu’il va gouverner. Cependant ce contrat est encore une fiction. L’essence d’un contrat est dans le consentement libre des parties intéressées. Il suppose que tous les objets de l’engagement sont spécifiques et connus. Or, si le prince est libre, à son avènement, d’accepter ou de refuser, le peuple l’est-il également ? Quelques acclamations vagues sont-elles un acte de consentement individuel et universel ? Ce contrat peut-il lier cette multitude d’individus, qui n’en n’ont jamais entendu parler, qui n’ont pas été appelés à le sanctionner, et qui n’auraient pas pu refuser leur consentement sans exposer leur fortune et leur vie ? _ D’ailleurs, dans la plupart des monarchies, ce contrat prétendu n’a pas même cette faible apparence de réalité. On n’aperçoit pas l’ombre d’un engagement entre les souverains et les peuples » (48).
Ainsi apparaît-il d’abord qu’au-delà de Blackstone et de son contractualisme, ce sont toutes les variantes du contractualisme qui auront fait l’objet d’un rejet de la part de Bentham, avec cette précision qu’il est communément admis que Bentham n’a pas initié cette condamnation 49. Surtout, et comme l’écrit Jean-Pierre Cléro, « ce qui intéresse Bentham, c’est que, sans le vouloir, puis qu’ils ne croient pas à leur réalité, les auteurs qui se servent du contrat social sont obligés de recourir à la préhistoire de l’état de nature et au moment initial de la société civile. Telle est la fiction : les auteurs qui s’en servent savent qu’ils ont recours à quelque chose de faux ou d’irréel, mais ils ne peuvent s’empêcher d’y recourir. Ils sont constamment en porte-à- faux (…). La victoire de la fiction tient à ce que les auteurs du contrat social sont contraints au discours projectif qu’ils nient par ailleurs. Sans doute Hume et Bentham ont-ils beau jeu de montrer qu’il n’y a eu ni événement du contrat social, ni état de nature à proprement parler ; mais leur critique est supérieure en ce qu’elle manifeste que les auteurs du contrat sont pris au piège de la temporalisation, alors même qu’ils la récusent » (50) .
Plus encore que le contractualisme, ce sont toutes les fictions politiques que refuse Bentham, d’où son autre rejet du jusnaturalisme et de l’idéologie des droits de l’homme (51), lequel s’est notamment exprimé dans une célèbre lettre adressée à Brissot : « Je regrette, écrit Bentham, que vous ayez entrepris de publier une Déclaration des Droits. C’est une oeuvre métaphysique _ le nec plus ultra de la métaphysique. Cela peut avoir été un mal nécessaire, ce n’en est pas moins un mal. La science politique n’est pas assez avancée pour qu’une telle déclaration soit possible. Quels que soient les articles, je me porte garant qu’ils peuvent être classés sous trois chefs : 1) inintelligibles ; 2) faux ; 3) à la fois l’un et l’autre. Vous ne pourrez jamais faire une loi contre laquelle on ne puisse alléguer que, par elle, vous avez abrogé la Déclaration des droits ; et l’allégation sera irréfutable » (52).
Le substrat de cette condamnation par Bentham des droits de l’homme est au fond qu’à ses yeux, « il est inconcevable d’invoquer des droits antérieurs à l’établissement d’un gouvernement, des droits susceptibles de contredire les droits positifs, légaux (c’est-à-dire les facultés d’action dûment définies et sanctionnées, dans une société politique donnée, par la volonté du législateur suprême). Nul ne saurait avoir de droit qu’en fonction de l’utilité sociale ; nul droit n’existe qui ne puisse être aboli légitimement si cette abolition sert la société ; personne ne peut revendiquer un droit en vertu de sa seule qualité d’homme, indépendamment de la loi positive » (53) .
IV. L’individualisme radical de Bentham
Puisque l’utilité est, comme le dit Bentham, « ce principe qui approuve ou désapprouve toute action d’après sa tendance à augmenter ou à diminuer le bonheur de la personne dont l’intérêt est en question », que chacun est guidé par la recherche de son utilité, c’est-à-dire de son bonheur et de son plaisir, chacun est donc juge de son utilité. « Chacun se constitue juge de son utilité », écrit Bentham, « cela est et cela doit être : autrement l’homme ne serait pas un agent raisonnable : celui qui n’est pas juge de ce qui lui convient est moins qu’un enfant, c’est un idiot. L’obligation qui enchaîne les hommes à leurs engagements n’est autre chose que le sentiment d’un intérêt d’une classe supérieure qui l’emporte sur un intérêt subordonné » (54) .
Le moment où cet individualisme de Bentham (55) semble se révéler incommunicable avec un lien politique c’est lorsque Bentham le pousse jusqu’à nier l’existence en tant que telle de la société. « Son réalisme », écrit encore François Rangeon, « le porte à considérer que seuls les individus ont une existence physique, matérielle. La « société » lui paraît être une abstraction qui suppose l’existence d’une réalité qui dépasserait et dominerait les individus » (56). Loin de nier que les individus entretiennent entre eux des relations, Bentham ne voit dans ces rapports qu’une somme de rapports individuels. Et de ce que la société n’existe pas en tant que telle, l’on ne saurait donc postuler qu’il y a un intérêt social, tout au plus existe-t-il un intérêt commun, soit le plus grand bonheur du plus grand nombre, qui paraît s’accomplir dans la somme éventuellement pondérée des utilités individuelles. Et viendrait-on à objecter à Bentham que des intérêts particuliers peuvent faire obstacle à l’accomplissement de cet intérêt commun qu’il répondrait que cette hypothèse n’a que peu de chances de se réaliser en raison de l’identité naturelle des intérêts individuels et de l’intérêt du plus grand nombre.
« La société est tellement constituée qu’en travaillant à notre bonheur particulier, nous travaillons pour le bonheur général. On ne peut augmenter ses propres moyens de jouissance sans augmenter ceux d’autrui. L’harmonie naturelle des intérêts », écrit-il encore, « en permettant à chacun de contribuer au bien général tout en poursuivant son intérêt propre, facilite la conciliation entre le bonheur particulier et l’utilité générale » (57). Autrement dit, Bentham établit une corrélation entre le bonheur particulier et la constatation par chacun du bonheur des autres. « La vertu sociale est le sacrifice qu’un homme fait de son propre plaisir pour obtenir, en servant l’intérêt d’autrui, une plus grande source de plaisir pour lui-même » (58). L’avantage de cette thèse de l’identité naturelle des intérêts est de permettre à Bentham de faire apparaître sa doctrine comme étant pour le moins éloignée d’une morale de l’égoïsme (59). En toute hypothèse, il fallait encore à Bentham s’interroger sur l’existence d’obstacles éventuels à cette identité spontanée des intérêts. Admettant que ces obstacles existent _ soit, pour reprendre le commentaire de Jean-Jacques Chevallier, la « mauvaise éducation » et la « nature dépravée » – Bentham dira alors que ce sont seulement et précisément ces obstacles qui déterminent aussi bien l’existence que les limites de l’action du pouvoir et du droit.
V. L’utilité : fondement et limite du pouvoir ou du droit
L’on imaginerait plutôt mal, en effet, que des données aussi immédiatement observables que l’autorité, l’obéissance à l’autorité puissent avoir été niées par une doctrine se voulant réaliste. Or la possibilité même du pouvoir semble en contradiction avec la souveraineté de l’individu dans la définition de son utilité. C’est dans le but de dépasser cette contradiction qu’ayant admis l’idée du pouvoir, du gouvernement, Bentham posera le principe d’utilité comme étant à la fois le fondement de ce pouvoir et la fin de son action. « Le véritable bien politique », écrit-il, « est dans l’immense intérêt des hommes à maintenir un gouvernement. Sans gouvernement point de sûreté, point de propriété, point d’industrie. C’est là qu’il faut chercher la base et la raison de tous les gouvernements, quels que soient leur origine et leur forme ; c’est en les comparant avec leur but qu’on peut raisonner solidement sur leurs obligations sans avoir recours à de prétendus contrats, qui ne peuvent servir qu’à faire naître des disputes interminables » (60). Plus précisément, Bentham pose que le pouvoir naît de la nécessité de « maintenir artificiellement l’identité des intérêts individuels avec l’intérêt du plus grand nombre, là où [elle] ne s’opère pas spontanément ». Aussi le fondement du pouvoir se confond-il chez Bentham avec son but. Par suite, le gouvernement est tenu de faire en sorte que le bonheur privé d’un homme soit garanti par des lois satisfaisant au plus grand bonheur du plus grand nombre. « Son intervention ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour pallier les obstacles qu’une mauvaise éducation ou une nature dépravée opposent à l’identité spontanée des intérêts » (61) .
Ce maintien artificiel de l’identité des intérêts, le législateur l’accomplira pour l’essentiel par le moyen de sanctions politiques encore appelées sanctions légales, que Bentham définit comme étant « les peines ou les plaisirs qu’on peut éprouver de la part des magistrats », ces sanctions politiques ou légales ne se confondant pas plus avec les sanctions physiques ou naturelles qu’avec les sanctions morales ou populaires (celle de l’opinion publique ou de l’église). Ainsi peut-on mesurer l’importance chez Bentham de la théorie des sanctions, celles-ci étant elles-mêmes entendues au sens de « peines ou plaisirs attachés à l’observation d’une loi ». Et, à la question de savoir si ces sanctions ne sont pas susceptibles d’être prises en méconnaissance du principe de l’utilité, Bentham répond par l’affirmative. De même que l’opprobre qui rejaillit sur l’ensemble de la famille d’une personne coupable d’une peine infamante est une erreur de la sanction populaire, soutient-il, de même y a-t-il erreur de la sanction politique à pénaliser nécessairement l’usure.
« L’usure, qui », écrit Bentham, « si on doit la considérer comme un délit commis avec consentement, c’est-à-dire avec l’accord de la partie censée en pâtir, ne peut trouver place dans le catalogue des délits, sauf dans les cas où l’accord ne serait pas libre ou serait obtenu frauduleusement. Celui-ci est un cas d’escroquerie ; celui-là un cas d’extorsion » (62).
Une énième question que soulève la doctrine de Bentham est de savoir si l’utilitarisme conçoit le droit de résistance à l’oppression comme pouvant être une sanction de la méconnaissance par la sanction politique du principe d’utilité. Sur la foi de la connaissance de la condamnation par Bentham des déclarations des droits de l’homme et de l’assimilation du droit de résistance à l’oppression à un sophisme anarchique, l’on est enclin à répondre spontanément par la négative à cette interrogation. Or en posant que les hommes « obéissent aussi longtemps que les méfaits probables de l’obéissance sont moindres que les méfaits probables de la résistance » (63), voire qu’« en prenant le corps tout entier, il est de son devoir d’obéir aussi longtemps que c’est son intérêt et pas davantage » (64), Bentham semble admettre une sorte de droit à la désobéissance dont le fondement est encore l’utilité. Mais si l’intérêt des gouvernés est d’obéir aussi longtemps que le gouvernement agit dans le sens d’accroître leur bonheur, et si, de ce fait, une résistance de leur part est pour Bentham contraire à leur intérêt, « la logique du même principe dictait », fait observer Jean-Jacques Chevallier, « (…) une réserve sérieuse [de la part de Bentham évidemment] : elle n’était déraisonnable, cette résistance, qu’aussi longtemps que ses maux probables (en considérant la communauté en général) apparaissaient aux sujets, conformément au meilleur calcul dont ils fussent capables, pires que les maux probables de l’obéissance ; et comme nul signe n’existait, perceptible à tous, qui leur permît de reconnaître, à un moment donné que ces maux-ci l’emporteraient, il revenait par suite à chaque individu en particulier de déterminer sa propre conviction intérieure d’un « excédent d’utilité du côté de la résistance ». Admirons, commente encore Jean-Jacques Chevallier, cette arithmétique politique en si parfaite symétrie avec l’arithmétique morale qui fait le fond du benthamisme ; apprécions cette substitution d’un raisonnement qui se veut scientifique à l’indémontrable notion métaphysique de respect des promesses incluses en un contrat initial purement imaginaire » (65) .
*
(1) Paris, 8 février 2022. Tous droits réservés.
(2) Christian Laval, Jeremy Bentham. Le pouvoir des fictions, P.U.F., 1994.
(3) La formation du radicalisme philosophique, P.U.F., collection «Philosophie morale». Les trois volumes de cet essai ont d’abord paru en 1901 et 1903. Pour une analyse critique de la lecture de Bentham par Élie Halévy, v. de Francisco Vergara, « Une critique d’Élie Halévy : réfutation d’une importante déformation de la philosophie britannique », Philosophy (Journal of the Royal Institute of philosophy), janvier 1998.
(4) Jeremy Bentham, Fragment sur le gouvernement suivi de Manuel des sophismes politiques (préf. Jean-Pierre Cléro), Bruylant-L.G.D.J.,
(5) Revue du Mauss (Éditions La Découverte). Ce titre est évidemment une référence au fondateur de l’ethnologie française et à l’auteur du célèbre Essai sur le don (Marcel Mauss, 1873-1950).
(6) Alain Caillé, Présentation de la Revue du Mauss, no 6, 1995, 10.
(7) V. notamment : Anthologie historique et critique de l’utilitarisme, Textes choisis et présentés par Cathérine Audard, P.U.F., 1999 ; Jeremy Bentham, Garanties contre l’abus de pouvoir et autres écrits sur la liberté politique, P.E.N.S. éd., 2001 ; Jean-Pierre Cléro, Le vocabulaire de Bentham, Ellipses, coll. Marketing, 2002 ; Guillaume Tusseau, Jeremy Bentham et le droit constitutionnel. Une approche de l’utilitarisme juridique, L’Harmattan, Logiques politiques, 2001.
(8) René Sève, in Dictionnaire de philosophie politique (sous la direction de Stéphane Rials et Philippe Raynaud), U.F., 1997, p. 711.
(9) A. Smith, D. Ricardo, B. Say, J. St. Mill.
(10) Que ce soit chez des «marginalistes» tels que Walras, V. Pareto, A. Marshall, W. Stanley Jevons, C. Menger ou chez des «néo-libéraux» tels que Hayek, M. Friedman, A. Laffer, voire chez des «libertariens» tels que J. Buchanan, D. Nozick, D. Friedman.
(11) Cf. notamment F.A. Hayek, Droit, législation et liberté, P.U.F., coll. Quadrige, 1995, T. 1, p. 161.
(12) notamment : Essays in the economics of crime and punishment, New York, N.B.E.R., Columbia University Press, 1974 ; The economic approach of human behavior, Chicago, University of Chicago Press, 1976.
(13) Dawkins soutient en substance que la compétition darwinienne se vérifie au niveau des gènes qui, pour assurer leur propre survie, peuvent le cas échéant sacrifier les organismes qui les Cf. Richard Dawkins, Le gène égoïste, O. Jacob, 1996.
(14) V. à ce propos le troisième volume de l’Anthologie historique et critique de l’utilitarisme de Catherine Audard (Thèmes et débats sur l’utilitarisme contemporain), U.F., 1999.
(15) John Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1987, 49.
(16) Au surplus, de ce que les grands textes de Bentham ou bien ne sont guère traduits en langue française ou bien font l’objet de traductions contestées, l’accès à sa pensée et l’interprétation de celle-ci ne s’en trouvent pas facilités. Sur cette question, voir les observations d’Élie Halévy in La formation du radicalisme philosophique, op. cit., T. 1, p. 326.
(17) André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F., 1960, p. 1177.
(18) John Stuart Mill, L’utilitarisme, essai sur Bentham, P.U.F., coll. Quadrige, 1988.
(19) «La doctrine qui prend pour fondement de la morale l’utilité ou le principe du plus grand bonheur, soutient que les actions sont bonnes dans la mesure où elles tendent à augmenter le bonheur, mauvaises en tant qu’elles tendent à en produire le contraire. Par bonheur on entend le plaisir et l’absence de douleur ; par son contraire, la douleur et l’absence de plaisir» (traduction donnée par André Lalande, op. cit., p. 1177, note 1).
(20) André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, op. cit., p. 1177.
(21) Alain Caillé, op. cit., p. 5.
(22) Ibid.
(23) Ibid. C’est pour vouloir prendre en considération ces deux propositions qu’Alain Caillé suggère de désigner comme utilitaristes, «les doctrines qui, affirmant que la recherche du bonheur constitue la grande affaire des hommes et que celui-ci est susceptible d’être obtenu à la suite d’un calcul rationnel parce que les éléments qui le composent _ les plaisirs, l’absence de peine, les intérêts, les utilités, les préférences, etc., sont réputés intrinsèquement calculables _ se retrouvent tiraillés entre ces deux propositions» (p. 4).
(24) Introduction aux principes de morale et de législation, chapitre premier. Sur cette ambivalence de l’utilitarisme, v. encore de Luc Marie Nodier, Définition de l’utilitarisme, Revue du Mauss, no 6, 1995, 19-20.
(25) Alain Caillé, cit., p. 8-9. Sur la généalogie des utilitarismes, voir l’article de René Sève, in Dictionnaire de philosophie politique, op. cit., 711 et s.
(26) Cité par Sophie Raffalovich, in Bentham, 1888, p. XVII.
(27) Le principe d’utilité n’y est pas moins posé comme alternative au contractualisme de De même la préface de Bentham à son Fragment sur le gouvernement contenait-elle déjà cette idée que «c’est le plus grand bonheur du plus grand nombre qui est la mesure du juste et de l’injuste».
(28) Entre-temps, Bentham a publié Défense de l’usure (1787), Essai sur la représentation (1788). Viendront plus tard le Book of fallacies (1824) ou le Constitutional Code (écrit en 1823 mais publié en 1830).
(29) Introduction aux principes de morale et de législation, chapitre premier (dans la traduction donnée par Élie Halévy, op. cit., T. 2, p. 37).
(30) Note de juillet 1822 au premier chapitre de l’Introduction aux principes de morale et de législation. Sur ce point, voir les notes de Jean-Pierre Cléro, in Fragment sur le gouvernement, op. cit., p. 128-129.
(31) Luc Marie Nodier, cit., p. 17.
(32) Jean-Jacques Chevallier, Histoire de la pensée politique, Payot et Rivages, 1993, 794.
(33) Ibid.
(34) Élie Halévy, op. cit., T. 2, p. 37.
(35) Ibid.
(36) Introduction aux principes de morale et de législation (chapitre II).
(37) Ibid.
(38) Élie Halévy, op. cit., p. 39.
(39) «Ce principe consiste à approuver ou à blâmer par sentiment, sans admettre aucune autre raison de ce jugement que le jugement même. J’aime, je hais, voilà le pivot sur lequel porte ce Une action est jugée bonne ou mauvaise, non parce qu’elle est conforme ou contraire à l’intérêt de ceux dont il s’agit, mais qu’elle plaît et déplaît à celui qui juge. Il prononce souverainement : il n’admet aucun appel ; il ne se croit pas obligé de justifier son sentiment par quelque considération relative au bien de la société» (Introduction aux principes de morale et de législation, chap. III, trad. S. Raffalovich).
(40) Élie Halévy, op. cit,, p. 40.
(41) Ibid.
(42) Introduction aux principes de morale et de législation, I, trad. S. Raffalovich.
(43) Élie Halévy, op. cit., p. 41. De cette savante arithmétique, v. le résumé donné par Élie Halévy, op. cit., T. 1, p. 41-42. L’on trouvera le texte d’un manuscrit de Bentham se rapportant à ce calcul des plaisirs et des peines en appendice du même ouvrage d’Élie Halévy (p. 301-309).
(44) Georges Burdeau, Traité de science politique, VI, L.G.D.J., 1987, p. 176.
(45) Introduction aux principes de morale et de législation, I, trad. S. Raffalovich.
(46) Fragment sur le gouvernement, op. cit., p. 111. Le Fragment sur le gouvernement n’est jamais qu’un passage d’un commentaire plus dense (A comment on the commentaries) fait par Bentham de la pensée de Blackstone.
(47) Fragment sur le gouvernement, op. cit., p. 122, note 2.
(48) Introduction aux principes de morale et de législation, traduction Sophie Raffalovich, 64-65.
(49) Sur l’antériorité de Hume, de celui-ci, La morale. Traité de la nature humaine III (G.F., Flammarion, 1993) et les observations données par Philippe Saltel dans son introduction.
(50) Jean-Pierre Cléro, op. cit., 31.
(51) Sur cette question, El Shakankiri, « J. Bentham : critique des droits de l’homme », Archives de Philosophie du droit, 1964, p. 129 et s. et de Bentham lui-même ses Sophismes anarchiques ; ou examen des déclarations des droits publics pendant la Révolution française (1795).
(52) Texte cité par Élie Halévy, cit., T. 2, p. 29.
(53) Jean-Jacques Chevallier, Histoire de la pensée politique, Payot et Rivages, 1993, p. 797.
(54) Jean-Jacques Chevallier, « Le pouvoir et l’idée d’utilité chez les utilitaires anglais », in Le pouvoir, Annuaire de l’Institut international de philosophie politique, 1, 1956, p.125 et s.
(55) L’on fera observer que John Rawls a pu faire valoir que l’utilitarisme n’était pas un individualisme, «du moins pas quand on l’envisage à partir de l’enchaînement de pensée le plus naturel ; car, alors, traitant tous les systèmes de désir comme un seul, il applique à la société le principe de choix qui est valable pour un individu» (Théorie de la justice, op. cit., p. 155).
(56) François Rangeon, L’idéologie de l’intérêt général, Économica, 1986, 160.
(57) Introduction aux principes de morale et de législation, trad. S. Raffalovich, op. cit., p. 43. 58 – (58) Déontologie, fr., 1834, T. 1, p. 173.
(59) Sur cette critique, voir notamment Louis Reybaud, Étude sur les réformateurs ou socialistes modernes, 1843, 2, p. 193. Pour la réfutation de cette lecture du benthamisme et pour son assimilation à une morale de l’altruisme, v. de Jacob Viner, Bentham and J.S. Mill : The Utilitarian Background (1949) et The Long View and the Short (Glencoe, III., Free Press, 1958, p. 312-314 et 316-319) ; voir plus récemment de Francisco Vergara, Introduction aux fondements philosophiques du libéralisme, Éd. La découverte, 1992.
(60) Introduction aux principes de morale et de législation, op. cit., p. 65.
(61) Ibid, p. 175-176.
(62) Introduction aux principes de morale et de législation, T. 1, chap. XVIII (tradution d’Élie Halévy, op. cit., T. 1, p. 256, note 84).
(63) Fragment sur le gouvernement, op. cit., p. 127.
(64) Ibid.
(65) Jean-Jacques Chevallier, op. cit., p. 796-797.