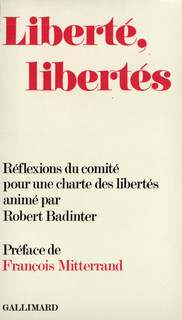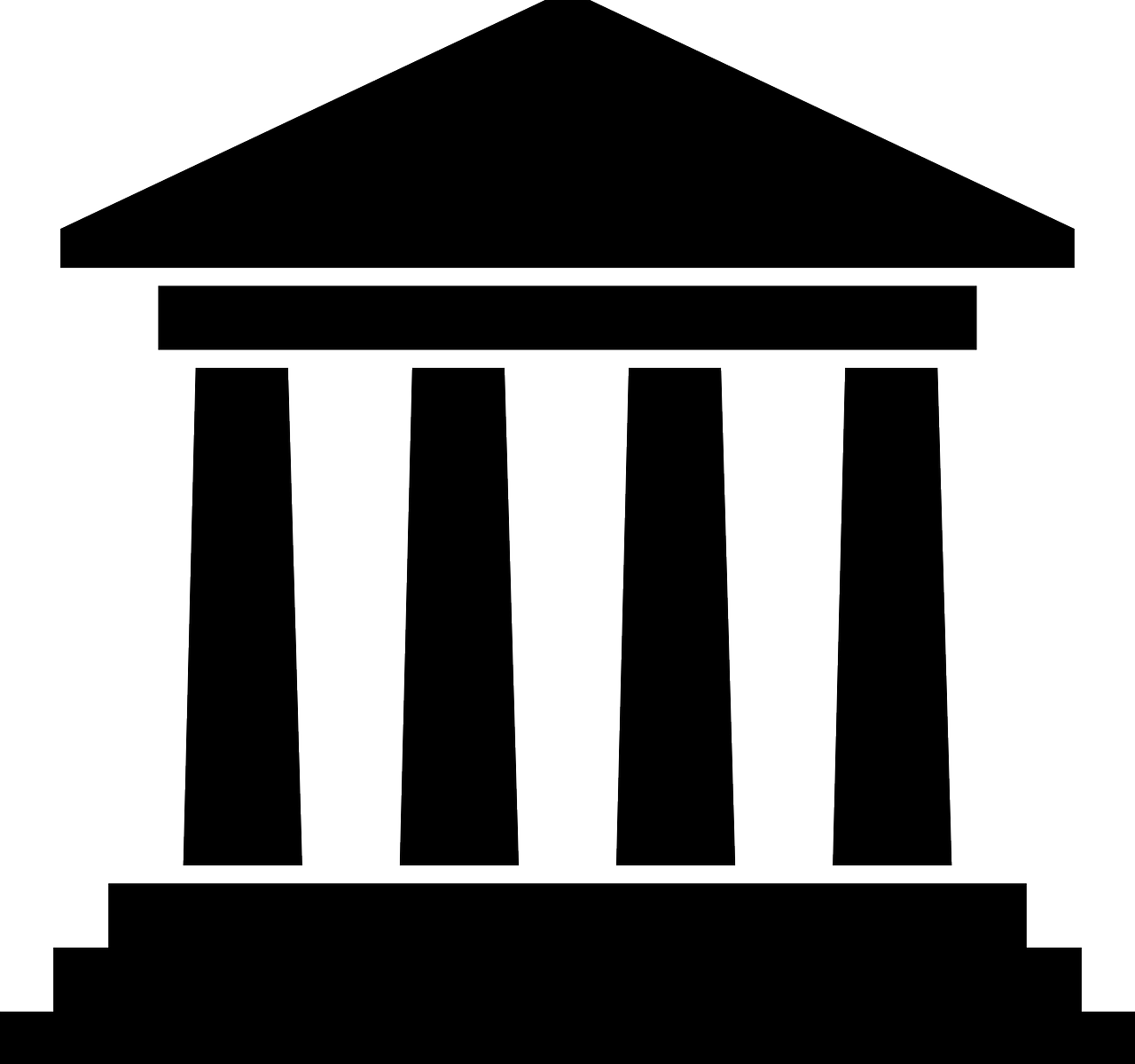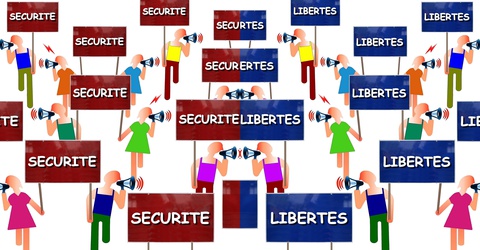L’histoire de France depuis le XVIIIe siècle a été particulièrement riche de ces circonstances exceptionnelles qui conduisent à l’application de la forme de légalité que l’on qualifie habituellement d’état d’exception : guerres, insurrections armées, émeutes, crises économiques, crises sociales, terrorisme. La Révolution française elle-même fut en quelque sorte un moment de référence en la matière, spécialement entre 1792 et 1794. Concentration des pouvoirs au profit de pouvoir exécutif − celui-ci étant considéré comme ayant seul la capacité d’agir avec célérité et efficacité – et limitations et suspensions importantes des libertés, les caractéristiques fondamentales des « états d’exception » ultérieurs sont déjà vérifiables sous la Révolution.
Sur un plan formel, ce qui distingue la France contemporaine est l’existence de textes juridiques codifiant les états d’exception. Il est habituel de distinguer les deux états d’exception prévus par la Constitution et l’état d’exception organisé par la loi. Ainsi, la Constitution française prévoit deux états d’exception. Le premier est prévu à l’article 16, qui ne le dénomme pas. Mais les juristes parlent à son propos des « pouvoirs de crise du président de la République », des « pleins pouvoirs du président de la République », des « pouvoirs exceptionnels du président de la République », voire de la « dictature provisoire du président de la République ». Le deuxième état d’exception prévu par la Constitution est cité à l’article 36 de la Constitution. Cet autre état d’exception est pour sa part qualifié par la Constitution elle-même d’état de siège. Alors que l’article 16 définit substantiellement les « pouvoirs de crise du président de la République », l’article 36 est paradoxal car il dispose simplement que « l’état de siège est discuté en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. ». Autrement dit, l’article 36 de la Constitution définit seulement la procédure de déclenchement et de prorogation de l’« état de siège », les autres règles caractéristiques de cet état d’exception étant quant à elles définies par la loi. Jusqu’à la création d’un Code de la défense en 2004, il existait en réalité deux lois en la matière : la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège et la loi du 3 avril 1878 relative à l’état de siège qui a abrogé certaines dispositions de la loi de 1849. Les dispositions de ces deux lois encore en vigueur en 2004 ont donc été incorporées dans le code de la défense[1].
Il existe par ailleurs un état d’exception codifié par la loi : l’état d’urgence. Ce régime a été fondé par la loi du 3 avril 1955, qui l’instituait seulement en Algérie et cela pour une période de six mois. Toutefois, la loi du 3 avril 1955 est devenue par la suite permanente[2], au point d’être à nouveau appliquée à différentes reprises par la suite :
| Les mises en œuvre de l’état d’urgence depuis 1955[3] |
| Territoire de la République concerné |
Période |
| Algérie |
3 avril 1955-1er décembre 1955 |
| Métropole |
17 mai 1958-1er juin 1958 |
| Métropole |
23 avril 1961-24 octobre 1962 |
| Nouvelle-Calédonie |
12 janvier 1985-30 juin 1985 (*) |
| Îles de Wallis et Futuna |
29 octobre 1986
(pas de prorogation par la loi) |
| Polynésie française (communes de la subdivision des Iles du Vent) |
24 octobre 1987
(pas de prorogation par la loi) |
| Métropole |
8 novembre 2005 – 4 janvier 2006 |
| Métropole et Corse, puis : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin. |
14 novembre 2015 – … |
| (*) La période durant laquelle l’état d’urgence s’est appliqué en Nouvelle-Calédonie est en fait discontinue, un délai supérieur à douze jours s’étant écoulé entre l’arrêté du haut-commissaire proclamant cet état d’urgence (du 12 janvier 1985) et la loi destinée à proroger cet état d’urgence (promulguée le 25 janvier 1985). |
La loi du 3 avril 1955 est constamment présentée comme « loi de circonstance ». Cette qualification peut paraître paradoxale : d’un côté, c’est un fait que toute loi est toujours inscrite dans des circonstances historiques particulières ; de l’autre côté, le concept de « loi de circonstance » a dans le lexique politique et juridique français un statut particulier d’argument de disqualification politique et morale d’une décision publique. Cette tension a accompagné la naissance de la loi de 1955, lorsque les « événements d’Algérie » ont convaincu des élus politiques, des juristes, des experts de la défense nationale et des experts de la sécurité civile, dès 1950, d’envisager la création d’un « état de droit intermédiaire entre la situation normale et l’état de siège »[4]. « Le projet de loi (…), disait encore le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, est inspiré par les troubles qui règnent dans certaines régions des départements algériens. Son exposé des motifs emprunte à la situation de l’Algérie la plupart de ses références. On peut le regretter »[5]. En même temps, rien ne dit que le texte aurait été accepté en 1955 si le gouvernement n’avait pas insisté sur cette urgence en Algérie qui, d’une part, a précisément fait préférer l’expression « état d’urgence » à celles d’« état d’insécurité » ou d’« état de péril », d’autre part, a fait adopter … en urgence la loi par le parlement.
Parce qu’ils sont des dispositifs se présentant comme « complets », à la différence d’autres dispositifs désignés par le code de la défense comme étant des « régimes d’application exceptionnelle » de défense[6], l’article 16 de la Constitution, l’état de siège et l’état d’urgence sont seuls concernés ici. Parler d’échographie de ces dispositifs est une manière de dire deux choses : en premier lieu, il ne s’agit pas de revenir en détail sur ces objets juridiques, qui ont déjà été particulièrement commentés[7] ; d’autre part, l’analyse proposée de ces dispositifs ne sera pas « interventionniste » − au sens où l’on parle « d’interventionnisme sociologique » pour désigner des formes d’engagement politique s’autorisant d’une position institutionnelle de sociologue −, soit une caractéristique partagée par de nombreux articles portant sur ces trois objets et signés par des juristes, des historiens, des sociologues ou des journalistes. Préférer une approche non-interventionniste ne revient pas à dire que cette approche est politiquement neutre. C’est plutôt une forme de résignation devant la quasi-impossibilité d’un consensus sur ce que doit être un régime libéral de l’état d’exception, et pas seulement par opposition à d’autres types de point de vue (libertaire, anarchiste, etc.) qui mobilisent eux aussi des formules habituelles du style « la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter les libertés fondamentales ». Par hypothèse, si un certain nombre de critiques réputées libérales de tel ou tel état d’exception peinent à convaincre les décideurs publics, c’est parce que ces critiques ne prennent pas au sérieux la peur collective provoquée par les événements ayant justifié l’état d’exception, cette peur étant disqualifiée d’office à partir d’une double idée : en tenir compte empêcherait d’avoir un point de vue libéral sur l’état d’exception ; cette peur est nécessairement « exploitée » par les décideurs publics. D’autre part, nombre de critiques présentées comme libérales de l’état d’exception sont indifférentes au fonctionnement empirique de l’état et aux problèmes importants et concrets de décision posés aux responsables politiques et aux institutions publiques de sécurité lorsque surviennent des événements susceptibles de justifier des dispositifs d’exception[8]. L’importance particulière de la conjuration de la peur dans le gouvernement des Hommes d’une part, les limites et failles (révélées par la crise) de la « procéduralisation » ou de la « bureaucratisation » des institutions publiques de renseignement et de sécurité d’autre part, sont particulièrement importantes pour comprendre la facilité relative de la mise en œuvre des états d’exception en France, qu’il s’agisse du minimalisme procédural prévu en la matière (I) ou de la généralité des motifs prévus par loi en vue du déclenchement de l’article 16 de la Constitution, de l’état de siège ou de l’état d’urgence (II). Ces considérations ne sont pas moins importantes pour comprendre, toujours sur la longue durée, la difficulté tendancielle des pouvoirs publics à réunir un consensus autour de la définition des dérogations à la légalité ordinaire admises dans le cadre des dispositifs de crise (III).
I. Minimalisme procédural et prérogative de l’exécutif
Les trois régimes français d’état d’exception − les deux régimes constitutionnels et le régime législatif − définissent chacun les conditions procédurales de leur mise en œuvre.
A. Faculté d’empêcher du parlement
Le déclenchement de l’état de siège est associé à des conditions procédurales relativement peu contraignantes pour le pouvoir exécutif puisque l’article 36 de la Constitution de 1958 prévoit seulement que « l’état de siège est décrété en Conseil des ministres » et que « sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ». Cette division du travail entre le pouvoir exécutif et le parlement est un compromis constitutionnel dans le débat qui a opposé dans la seconde moitié du XIXe siècle les partisans d’une souveraineté du pouvoir exécutif pour déclencher et faire cesser l’état de siège et les partisans d’une compétence du parlement.
Ainsi, dans la rédaction originelle de la loi de 1849, le déclenchement de l’état de siège était une compétence du parlement. Après le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, la Constitution du 14 janvier 1852 décida de confier à l’Empereur « le droit de déclarer l’état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai (…) »[9]. Après la chute du Second Empire, et pendant la période intermédiaire allant du 19 février 1871 au 31 décembre 1875, l’Assemblée nationale élue le 8 février 1871 considéra pour sa part qu’elle avait la compétence « constitutionnelle » primaire pour déclarer l’état de siège. Mais elle conçut (loi du 28 avril 1871) de déléguer l’exercice de cette compétence pendant trois mois au « Chef du pouvoir exécutif ».
Dans sa rédaction originelle, la loi de 1878 n’était pas moins ambivalente puisque si elle réserve au parlement, par le vote d’une loi, le pouvoir de « déclarer l’état de siège » (article 1er), elle prévoyait néanmoins deux hypothèses dans lesquelles la déclaration d’état de siège pouvait être faite par le président de la République : 1/ en cas d’ajournement des chambres, sur avis du Conseil des ministres, et avec l’obligation constitutionnelle pour les deux chambres de se réunir deux jours après cette déclaration, à charge pour elles de décider du maintien ou de la levée de l’état de siège ; 2/ en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, le président de la République pouvait également déclarer l’état de siège mais seulement s’il y avait « une guerre étrangère », seulement dans « les territoires menacés par l’ennemi » et « à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans les plus bref délais » (article 3). Quant à la cessation de l’état de siège, elle échappait au pouvoir exécutif sans dépendre exclusivement du parlement. En effet, il était prévu que l’état de siège prendrait fin de plein droit à la date de cessation fixée par la loi qui l’a déclaré. Lorsqu’il avait été décidé par le président de la République, il revenait aux chambres spécialement réunies sur le sujet, ou bien de le faire cesser, ou bien de le proroger. Or la loi avait prévu qu’en cas de désaccord entre les deux chambres, l’état de siège était levé de plein droit.
Sous l’empire de la Constitution du 4 octobre 1958, l’état de siège est donc « décrété en conseil des ministres » et sa prorogation au-delà de douze jours ne pouvant être autorisée que par le Parlement (article 36). Les rédacteurs de la Constitution de la Ve République ont à l’évidence procédé par imitation de ce qui était prévu pour l’état d’urgence[10]. Comme l’explique Olivier Gohin, « (…) une fois déclaré et donc décrété, l’état de siège prend fin, en droit positif, − à défaut de sa prorogation par la loi (art. 36, al. 1er) − ou au terme que le législateur fixe dans la loi de prorogation (ibid., al. 2) ; − ou encore à la date prévue, après la loi de prorogation, par le législateur (Const., art. 34) ou, le cas échéant, par l’exécutif, régulièrement et donc, depuis 1958, constitutionnellement habilité à cet effet (Const., art. 38) »[11].
Lorsque le dispositif de l’état d’urgence est créé en 1955, le gouvernement avait conscience de ce qu’il lui serait plus facile de faire accepter son texte par le parlement s’il était prévu que, précisément, c’est le parlement seul qui déclencherait ce dispositif. Aussi, dans sa rédaction originelle, la loi de 1955 prévoyait que « l’état d’urgence ne peut être déclaré que par la loi » (article 2) et que « la loi fixe la durée de l’état d’urgence qui ne peut être prolongée que par une loi nouvelle (article 3). La loi de 1955 prévoyait encore deux autres règles procédurales. En premier lieu, il était prévu qu’en cas de démission du gouvernement ou de vacance de la présidence du Conseil, le nouveau gouvernement devait demander la confirmation par le parlement de la loi déclarant l’état d’urgence dans un délai de quinze jours francs à compter de la date à laquelle il a obtenu la confiance de l’Assemblée nationale. Si cette demande n’était pas présentée dans le délai prescrit, la loi déclarant l’état d’urgence était caduque (article 3). D’autre part, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, la loi ayant déclaré l’état d’urgence était abrogée de plein droit (article 4).
La procédure de déclenchement de l’état d’urgence ne fit donc l’objet que d’un bref débat en 1955, à l’initiative du député Francis Vals, qui voulait que la loi ne puisse déclarer l’état d’urgence qu’à la majorité des deux tiers de chacune des chambres du parlement[12]. La raison avancée par le député était assez curieuse : plutôt que de justifier sa proposition par la nécessité d’une forte légitimité parlementaire dans le déclenchement de l’état d’urgence, Francis Vals fit valoir que la règle de majorité qualifiée qu’il proposait était seule de nature à rendre le texte du gouvernement conforme à la Constitution… dans la mesure où l’état d’urgence n’avait pas de fondement dans la Constitution de 1946. Le Gouvernement objecta qu’une loi ne pouvait imposer à une autre loi une condition de majorité qualifiée qui n’était pas prévue par la Constitution. Surtout, le Gouvernement fit remarquer qu’une majorité parlementaire qui voudrait déclarer l’état d’urgence « à une partie quelconque du territoire » ne prendrait pas plus d’« une minute » pour abroger d’abord l’exigence d’un vote des deux tiers dans chaque chambre et, ensuite, déclarer à une majorité simple l’état d’urgence[13].
En réalité, ce que le ministre de l’Intérieur, Maurice Bourgès-Maunoury, dit ainsi implicitement en 1955, c’est que le principe du déclenchement de l’état d’urgence par la loi était accepté par le Gouvernement à partir d’un calcul simple : le vote d’une telle loi serait nécessairement une formalité dans la mesure où il était impensable (à moins d’ajouter une crise politique à un péril interne ou externe) qu’une majorité parlementaire refuse au Gouvernement qu’elle soutient la mise en œuvre de l’état d’urgence. Le général De Gaulle ne reprit pas à son compte ce calcul et préféra être plus clairement « décisionniste » puisque, par une ordonnance du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi de 1955, il décida que l’état d’urgence était désormais déclaré par décret du président de la République pris en Conseil des ministres (nouvel article 2 de la loi de 1955), la loi n’étant compétente que pour autoriser sa prorogation au-delà de douze jours et, par la même occasion, pour fixer sa durée définitive (nouvel article 2 de la loi de 1955). L’ordonnance du 15 avril 1960 a également voulu que la loi prorogeant l’état d’urgence soit caduque seulement dans un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale (nouvel article 4 de la loi de 1955).
C’est donc depuis 1960 que le déclenchement de l’état d’urgence est une prérogative du pouvoir exécutif, la compétence du parlement étant « accessoire » pour le proroger au-delà de douze jours. Les idées sous-jacentes à ce consensus entre les « partis de gouvernement » sont apparentes. Il s’agit de la double idée selon laquelle il y a des situations de crise dans lesquelles il faut décider illico presto et que cette décision doit revenir aux décideurs politiques qui exercent un commandement opérationnel sur les forces publiques de sécurité et sur l’armée.
B. Souveraineté présidentielle dans l’article 16
De manière unanime, l’historiographie du gaullisme prête au général De Gaulle l’idée selon laquelle le chef de l’état devait avoir les mains libres pour faire face aux circonstances exceptionnelles et que si cette faculté d’action avait existé en 1940 en faveur du président Albert Lebrun, peut-être le cours de l’histoire en aurait-il été changé[14]. Aussi, l’article 16 de la Constitution de 1958 peut être mis en œuvre par le président de la République simplement « après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel »[15], le chef de l’état devant par ailleurs « [informer] la Nation par un message ».
Jusqu’à la fin des années 1980, la contestation par la gauche de l’article 16 de la Constitution, lorsqu’elle ne proposait pas purement et simplement l’abrogation de cet article, envisageait plutôt le renforcement du pouvoir de contrôle des juges sur les mesures prises et la définition des conditions de la cessation de la mise en œuvre de ce dispositif. De ce réformisme, il ne restera dans les années 1990 et 2000 que l’idée de la définition des conditions de la cessation de la mise en œuvre du dispositif de l’article 16, compte tenu de ce qu’en 1961, il fut appliqué du 23 avril au 30 septembre, alors que le « putsch d’Alger » qui justifia son déclenchement avait échoué le 25 avril.
Le rapport du comité d’experts en institutions politiques et en droit constitutionnel présidé par le doyen Georges Vedel a légitimé en 1993 ce réformisme minimal :
« Le comité n’a pas jugé nécessaire une modification des conditions d’application de l’article 16 ni des pouvoirs que cet article reconnaît au président de la République.
En revanche, il lui a paru indispensable que soit précisé comment se termine la période d’application de cet article : il appartiendrait normalement au Président de la République de demander au Conseil constitutionnel de constater que les conditions exigées pour l’application de cet article ne sont plus réunies. Toutefois, le comité n’a pu écarter l’éventualité d’un exercice abusif de ce pouvoir du fait d’une trop longue durée. Pour tenir compte de cette hypothèse, il propose que le Président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, puissent également, par une demande conjointe, saisir le Conseil constitutionnel aux mêmes fins.
Il convient de souligner que l’exigence d’un accord, sur ce point, entre les deux présidents des assemblées parlementaires supposerait à l’évidence une situation particulièrement grave et serait de nature à empêcher qu’une telle demande soit faite pour un motif autre que l’intérêt national (…) »[16].
À bien y regarder, cette analyse avait quelque chose d’ambigu. Le rapport commence par envisager une intervention du Conseil constitutionnel à la demande du président de la République afin de mettre fin à l’application de l’article 16 avant de faire valoir qu’il a tenu compte de « l’éventualité d’un exercice abusif de ce pouvoir [par le président de la République] du fait d’une trop longue durée ». Ce que semble vouloir dire le rapport, c’est que l’on peut faire l’hypothèse que le président de la République ne s’oblige pas à saisir le Conseil constitutionnel ou ne le fasse que très tardivement. Or, ce risque pouvait être limité si la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République sur la nécessité de mettre fin à l’article 16 était enfermée dans certains délais. C’est donc pour ne pas avoir à faire peser sur le président de la République des délais de saisine du Conseil constitutionnel sur la nécessité de continuer avec l’article 16 de la Constitution que les rédacteurs du rapport ont préféré donner aux présidents des assemblées parlementaires une faculté concurrente de saisir le Conseil constitutionnel.
Cette ambiguïté fut explicitée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 puisque cette révision constitutionnelle s’est purement et simplement refusée à obliger le président de la République à saisir le Conseil constitutionnel aux fins de la constatation de l’opportunité de mettre fin à l’article 16, le Conseil constitutionnel ne pouvant intervenir qu’à la demande des présidents des assemblées parlementaires ou de soixante députés ou soixante sénateurs après trente jours ou de plein droit après soixante jours d’application de l’article 16 :
« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ».
Il est à noter que c’est bien un « avis » et non une « décision » que le Conseil constitutionnel est supposé rendre : les rédacteurs de la révision constitutionnelle sont partis du présupposé selon lequel le pouvoir exécutif serait politiquement et moralement contraint de mettre fin à l’article 16 si l’avis du Conseil constitutionnel allait dans ce sens. L’on peut néanmoins être sceptique sur l’effectivité des règles ajoutées à la Constitution en 2008 : la probabilité de voir neuf juges n’ayant pas accès aux informations secrètes des institutions policières, militaires (ou de renseignement) se substituer au pouvoir exécutif dans l’appréciation des risques et des menaces pesant sur l’état et la nation, pour conclure dans un simple avis qu’il n’est pas opportun de maintenir en application l’article 16, paraît assez faible.
Du rapport Vedel de 1993 jusqu’à la révision constitutionnelle de 2008, une ambiguïté traverse la question de la cessation de l’article 16 : les promoteurs d’une incorporation du Conseil constitutionnel dans le dispositif de sortie de l’état de crise sont portés par l’idée selon laquelle cette sortie ne demande pas d’appréciation particulière − politique, policière ou militaire – et ne serait qu’une « constatation d’un fait ». à supposer que cela soit vrai, on comprend alors mal qu’il n’en aille pas de même du déclenchement de l’article 16.
II. Généralité des motifs justificatifs
L’article 15 § 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme, prévoit en faveur des états parties une faculté de déroger aux droits garantis par la Convention seulement « en cas de guerre ou en cas d’autres dangers publics menaçant la vie de la nation ». L’article 4 du pacte international sur les droits civils et politiques ne prévoit pour sa part la même faculté en faveur des états parties que « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation ». Ces instruments internationaux témoignent d’une difficulté déjà observable dans les droits internes, celle de définir objectivement et de manière non-équivoque les événements justificatifs du déclenchement de l’état d’exception.
A. Motifs justificatifs de l’état de siège
Le dispositif de l’état de siège est souvent identifié à une situation de guerreinterétatique. Il est vrai que ce concept fut originellement associé à la guerre, puisque déjà, dans la loi des 8-10 juillet 1791[17], le motif justificatif de l’état de siège était le fait que des places ou des postes « sont en état de guerre», autrement dit en cas d’« investissement d’une place par l’ennemi ». Toutefois, c’est dès la Révolution française que l’état de siège fut envisagé comme dispositif applicable également en cas de « péril intérieur ». La Constitution du 14 septembre 1791 le prévoit « si des troubles agitent tout un département ». La loi du 16 fructidor an V (2 septembre 1797) prévoit à son tour la faculté de mettre en œuvre l’« état de guerre » dans « les communes de l’intérieur de la République » et l’« état de siège » en cas d’investissement des communes « par des troupes ennemies ou des rebelles ». La Constitution de 1799 n’utilise pas le concept mais prévoit que « la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu’elle détermine, l’empire de la Constitution », dans le cas « de révolte armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l’état ». En 1802[18], il est dit seulement que « le Sénat déclare, quand les circonstances l’exigent, des départements hors de la Constitution ». Cette « sortie de la Constitution » de certains départements, que les contemporains analysaient comme équivalente d’un état de siège, pouvait donc être déterminée par des circonstances extérieures ou intérieures.
Entre la loi du 9 août 1849 relative à l’état de siège et celle du 3 avril 1878 sur le même objet, le dispositif de l’état de siège ne pouvait être mis en œuvre qu’« en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure ». C’est donc sur cette base que l’état de siège avait pu être appliqué en 1870 lors de la guerre franco-allemande, en 1871 lors de la commune de Paris et, toujours en 1871, à la faveur de l’insurrection kabyle en Algérie. Depuis la loi du 3 avril 1878 relative à l’état de siège, ce dispositif ne peut plus être mis en œuvre qu’« en cas de péril imminent, résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée »[19]. C’est sous l’empire de cette rédaction que l’état de siège avait pu être appliqué en 1879, en 1914 dans le cadre de la Première Guerre mondiale et en 1939 dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale.
La définition légale des motifs justificatifs de l’état de siège appelle deux observations. En premier lieu, l’élément de stabilité de cette définition − le concept de « péril imminent » − est supposé être sa composante subjective, puisque la nature et l’imminence du péril en question relèvent théoriquement de l’appréciation des pouvoirs publics[20]. En deuxième lieu, le fait même que la deuxième composante de ce motif ait changé entre 1849 et 1878 montre qu’elle est tout sauf objective : d’une part, en 1849, il est question de la « sécurité intérieure ou extérieure » alors que depuis 1878, il est question d’une « guerre étrangère » ou d’une « insurrection armée » ; d’autre part, en 1849, c’est la « sécurité intérieure ou extérieure » qui doit être l’objet du « péril imminent » alors qu’en 1878, la « guerre étrangère » ou l’« insurrection armée » doit être la cause du « péril imminent ». Or, et en toute hypothèse, chacun des syntagmes de la définition légale de l’état de siège – « sécurité intérieure ou extérieure » en 1849, « guerre étrangère », « insurrection armée » en 1878 – peut se prêter à des interprétations plus ou moins extensives. Au demeurant, la distinction entre « sécurité intérieure » et « sécurité extérieure » de la loi de 1849 ne « colle » pas complètement au lexique contemporain des pouvoirs publics français, puisque s’il existe bien un « code de la sécurité intérieure », il est symétrique d’un « code de la défense » désigné ainsi par évitement du concept de « sécurité extérieure » (et même de celui de « sécurité nationale » qui figure néanmoins dans le Code de la défense[21]). Quant aux références contemporaines à la « guerre étrangère » et à l’« insurrection armée », elles perpétuent l’ancienne distinction entre la « guerre étrangère » et la « guerre civile » alors que ces concepts sont concurrencés de nos jours par ceux de « conflit armé international » (CAI) ou de « conflit armé non international » (CANI), qui sont plus englobants des différentes formes contemporaines de violences politiques commises avec des armes. Pour ainsi dire, la question se pose de savoir si le dispositif de l’état de siège est susceptible d’être appliqué dans la période contemporaine, par exemple, en cas de conflit armé international engageant la France mais non précédé d’une déclaration de guerre en bonne et due forme[22].
B. Motifs justificatifs de l’état d’urgence
Aux termes de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le dispositif de l’état d’urgence quant à lui ne peut être mis en œuvre que dans deux hypothèses alternatives. Première hypothèse : en cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Deuxième hypothèse : en cas d’« événements présentant par leur nature et par leur gravité, le caractère de calamité publique ». Seule la première hypothèse a été utilisée depuis 1955 par les pouvoirs publics, qu’il s’agisse du « problème algérien » en 1955, 1958 et 1961, de la Nouvelle-Calédonie en 1985 ou des violences urbaines en 2005. C’est donc autour d’elle que se fixent les critiques, qui sont à peu près les mêmes depuis toujours, même si en 1955 les deux hypothèses ont pu être critiquées.
À l’Assemblée nationale, le 31 mars 1955, c’est au député Albert Maton qu’il revint de dire en particulier pourquoi le motif tiré du « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » était problématique pour les adversaires du texte :
« L’article 1er [du projet de loi] tend à déterminer les circonstances dans lesquelles l’état d’urgence pourra être appliqué.
Chacun conviendra que cette détermination est extrêmement vague et élastique. La notion d’atteintes graves à l’ordre public ou d’événements présentant par leur nature un caractère de calamité publique est vraiment trop générale et donnerait à l’état d’urgence un champ d’application indéfini, ce qui pourrait entraîner des conséquences dont la gravité ne doit pas nous échapper.
Une telle disposition légale permettrait à une majorité parlementaire et à un gouvernement de se livrer aux pires aventures anticonstitutionnelles et antirépublicaines. Elle leur donnerait les moyens légaux de se livrer aux pires agressions contre le fonctionnement de la machine républicaine (…) »[23].
Le député Albert Maton désignait ensuite des exemples d’événements à la faveur desquels la nouvelle loi aurait pu être appliquée, par exemple les grandes grèves caractéristiques de la tradition politique française, à commencer par celles d’août 1953. Le député Albert Maton proposa donc en 1955 que l’état d’urgence ne puisse être déclenché qu’« en cas de guerre étrangère ou d’insurrection armée », autrement dit pour les mêmes raisons que celles prévues pour l’état de siège. Cette rédaction ne fut pas retenue par l’Assemblée nationale[24].
La loi du 3 avril 1955 « [instituait] un état d’urgence et en [déclarait] l’application en Algérie ». Or l’opportunité de cette application du nouveau texte à l’Algérie ne fut pas moins discutée en avril 1955 qu’en août 1955 lorsque l’état d’urgence fut prolongé pour une durée de six mois par la loi du 7 août 1955. Et il y eut de la même manière des controverses publiques et intellectuelles lorsqu’une loi du 17 mai 1958 déclara l’état d’urgence sur le territoire métropolitain pour trois mois à la suite de la tentative de « coup d’état du 13 mai 1958 », ou le 24 avril 1961 à la suite du « putsch des généraux ». En 1985, la contestation de l’applicabilité de l’état d’urgence aux troubles indépendantistes en Nouvelle-Calédonie ne porta pas sur la question de savoir si ces troubles entraient dans les motifs prévus par la loi de 1955. Les arguments développés par les députés et par les sénateurs devant le Conseil constitutionnel contre la loi du 25 janvier 1985 qui a prorogé au-delà de douze jours, du 27 janvier au 30 juin 1985, l’application de ce régime[25], étaient de toute autre nature. L’argument principal était purement formel : il s’agissait en substance de dire que la loi « ne peut porter d’atteintes, même exceptionnelles et temporaires, aux libertés constitutionnelles que dans les cas prévus par la Constitution », et que « la Constitution prévoit exclusivement l’état de siège »[26]. In fine, il s’agissait de dire que la Constitution de 1958 avait implicitement abrogé la loi de 1955, un argument rejeté par le Conseil constitutionnel[27] comme par le Conseil d’état.
En 2005, lors des violences urbaines qui ont frappé certaines banlieues françaises, la contestation juridique de la mise en œuvre de l’état d’urgence comprenait un argument relatif à la question de savoir si les événements en cause correspondaient aux motifs justificatifs de l’état d’urgence prévus par la loi de 1955. Afin d’obtenir l’annulation des décrets du 8 novembre 2005 mettant en œuvre l’état d’urgence et définissant sa portée, il fut ainsi soutenu devant le Conseil d’état que la pratique constante depuis la loi de 1955 a été de limiter la mise en œuvre de l’état d’urgence à des situations de guerre civile ou à des tentatives de coup d’état, et qu’à aucun moment ce régime d’exception n’avait été appliqué à des situations de violence urbaine. Cette lecture historiciste de la justification légale de l’état d’urgence n’avait cependant pas convaincu les juges. Pas plus qu’ils n’avaient été convaincus par l’argument formel de l’abrogation implicite de la loi de 1955 par la Constitution de 1958 ou par l’argument substantiel de l’incompatibilité des restrictions aux libertés prévues par la loi de 1955 avec la Convention européenne des droits de l’Homme[28]. En 2015, après les attentats de Paris, certains opposants à l’état d’urgence mobilisèrent les mêmes registres d’argumentation : une argumentation historiciste destinée à faire valoir que des attentats comme ceux du 13 novembre 2015 ne correspondaient pas au « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » prévu par la loi de 1955 ; une argumentation substantialiste sur la conformité à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l’Homme des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.
C. Motifs justificatifs de l’article 16
Le dispositif de l’article 16 de la Constitution ne peut être mis en œuvre que « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés (sic) d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu »[29].
La seule et unique fois où le dispositif de l’article 16 a été appliqué depuis 1958 (la guerre d’Algérie), le général De Gaulle n’avait pas cru devoir se justifier dans son décret de déclenchement et expliquer en quoi les conditions constitutionnelles étaient réunies[30], se contentant de renvoyer à « l’avis motivé » du Conseil constitutionnel. Ce dernier avait en effet assuré dans son avis du 23 avril 1961 :
« (…) Considérant qu’en Algérie, des officiers généraux sans commandement et, à leur suite, certains éléments militaires sont entrés en rébellion ouverte contre les pouvoirs publics constitutionnels dont ils usurpent l’autorité ; qu’au mépris de la souveraineté nationale et de la légalité républicaine, ils édictent des mesures de la seule compétence du Parlement et du Gouvernement ; qu’ils ont mis hors d’état de remplir leurs fonctions et privé de leur liberté les plus hautes autorités civiles et militaires d’Algérie dépositaires des pouvoirs qui leur ont été délégués par le Gouvernement de la République en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts nationaux, ainsi qu’un membre du Gouvernement même ; que leur but avoué est de s’emparer du pouvoir dans l’ensemble du pays ;
Considérant qu’en raison de ces actes de subversion, d’une part, les Institutions de la République se trouvent menacées d’une manière grave et immédiate, d’autre part, les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent fonctionner d’une façon régulière,
Est d’avis :
que sont réunies les conditions exigées par la Constitution pour l’application de son article 16. (…) ».
Cette motivation n’avait cependant pas convaincu tout le monde, ni en 1961, ni après, pour des raisons parfaitement exposées par le professeur de droit Georges Burdeau :
« Savoir si ces deux conditions sont remplies dépend évidemment d’une appréciation des faits. La Constitution ne dit pas expressément à qui elle incombe ; mais la logique de la situation implique évidemment que cette appréciation appartient à celui qui qui est appelé à en tirer les conséquences, c’est-à-dire au Président de la République. Il s’agit là, pratiquement, d’une compétence discrétionnaire car, si l’évaluation du danger couru par l’intégrité du territoire peut s’imposer par des considérations objectives, il n’en va pas de même d’une menace pour les institutions. Et de même on imagine aisément des hypothèses dans lesquelles l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics pourrait prêter à des interprétations divergentes. C’est ainsi qu’en avril 1961 ; lorsque le Président de la République décida d’appliquer l’article 16, rien n’empêchait matériellement le fonctionnement des pouvoirs publics. Mais, pour légitimer sa décision, le chef de l’état invoqua l’hypothèque morale qui pesait sur leur activité du fait de la crise algérienne »[31].
Alors que les universitaires discutent de rédactions alternatives et hypothétiquement « pertinentes » des circonstances justificatives du déclenchement de l’article 16 de la Constitution, les décideurs publics ou les comités d’experts en matière constitutionnelle considèrent pour leur part qu’un statu quo rédactionnel est préférable[32]. Et si la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a changé le dispositif de l’article 16 de la Constitution, elle n’a cependant pas modifié la définition des circonstances susceptibles de justifier son application.
D. Observations complémentaires
Les trois régimes français d’état d’exception, les deux régimes constitutionnels et le régime législatif, définissent chacun par des standards juridiques, les circonstances de sa propre application, la notion de standards désignant des « notions à contenu indéterminé » ou « une certaine catégorie d’expressions normatives caractérisées par l’absence de toute prédétermination et l’impossibilité de les appliquer sans procéder au préalable à une appréciation ou à une évaluation, c’est-à-dire en plaçant le fait auquel on les rapporte sur une échelle des valeurs (étalonnage) »[33]. Les standards juridiques se voient reconnaître en général un inconvénient et un avantage que l’on peut vérifier en matière de déclenchement d’états d’exception. Leur inconvénient est que leur contenu indéterminé constitue une source d’insécurité juridique, un facteur d’imprévisibilité du droit. Dans l’autre sens, leur avantage consiste dans le fait que leur contenu indéterminé permet et favorise une adaptabilité constante du droit aux évolutions et aux situations politiques, économiques et sociales.
Une question se pose à propos des motifs formels de déclenchement des trois dispositifs français d’état de crise. Il s’agit de savoir s’il est possible aux juristes de définir ces motifs d’une manière qui soit absolument objective. La réponse est ici négative, compte tenu de la très grande diversité matérielle des situations de crise susceptibles de se présenter. De fait, il n’y aucun état au monde qui peut prétendre avoir défini les motifs de déclenchement de ses dispositifs de crise d’une manière absolument objective[34]. Ce qui est en revanche particulièrement caractéristique de la France c’est le fait que les motifs justificatifs de ses trois dispositifs de crise se recoupent considérablement. Aussi, la décision de choisir l’un ou l’autre de ces dispositifs peut dépendre tout à la fois de la nature des événements, de la nature des décisions envisagées par le pouvoir exécutif, et des conséquences politiques susceptibles d’être induites par le choix de l’un ou de l’autre. En 1955 par exemple, l’invention et l’application du dispositif de l’état d’urgence fut une manière d’éviter la proclamation de l’état de siège[35], aussi bien pour des raisons « opérationnelles » (la suffisance alléguée de mesures non-militaires) que politiques (le refus de concéder aux nationalistes algériens une qualification de militaires, le refus de légitimer la qualification de la guerre d’Algérie comme « guerre d’indépendance »)[36]. Et, en 1961, l’état d’urgence fut d’abord articulé à l’article 16 de la Constitution[37] alors que l’on pouvait imaginer que ces deux dispositifs étaient alternatifs l’un à l’autre.
III. Dérogations à la légalité ordinaire admissibles pendant l’exception
Du point de vue de leur portée normative, les dispositifs français de crise peuvent être classés en fonction des pouvoirs d’immixtion dans les libertés ou de dérogation à la légalité ordinaire qu’ils accordent au pouvoir exécutif : le dispositif de l’article 16 de la Constitution précède celui de l’état de siège qui précède à son tour l’état d’urgence.
A. Indétermination des pouvoirs présidentiels au titre de l’article 16 de la Constitution
L’article 16 de la Constitution offre d’autant plus de pouvoirs d’immixtion dans les libertés ou de dérogation à la légalité ordinaire au pouvoir exécutif que : d’une part, et à la différence des deux autres dispositifs d’exception, il s’applique nécessairement sur l’ensemble du territoire national ; d’autre part, il se limite à dire que les mesures décidées par le président de la République ou sur son habilitation « doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet ». Si la nature de ces mesures n’est pas définie, le texte constitutionnel prévoit néanmoins deux garanties minimales : − la réunion du parlement de plein droit ; − l’impossibilité pour le président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale pendant l’application de l’article 16 de la Constitution. Le Conseil d’état en a ajouté une troisième, celle consistant en la possibilité pour la Haute juridiction administrative de statuer sur la validité de celles de certaines mesures prises par le président de la République en application de l’article de la Constitution : il s’agit de celles des mesures du président de la République qui ne concernent pas des questions qui, en temps ordinaire, relèvent de la compétence de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution[38].
De l’unique expérience d’application de l’article 16, celle de 1961 par le général De Gaulle, il est difficile de dire que chacune des mesures prises a été perçue par tout le monde comme étant intimement rattachable à ce que la Constitution appelle une « volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission »[39]. La décision en date du 3 mai 1961 par laquelle le président de la République a institué un Tribunal militaire fut l’une des plus contestées dans le débat public, concurremment à sa contestation devant le Conseil d’état[40]. Des critiques ne furent pas moins dirigées contre la décision du président de la République du 27 avril 1961 ayant habilité le ministre de l’Intérieur ou le ministre de l’Information à interdire par voie d’arrêté « les écrits, périodiques ou non, revêtant la forme de cahiers, de feuilles ou de lettres de renseignement, quel que soit leur mode de diffusion, qui apportent de quelque façon que ce soit un appui à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités ou les lois de la République, ou qui diffusent des informations secrètes d’ordre militaire ou administratif »[41].
Historiquement, la critique du principe des pouvoirs présidentiels au titre de l’article 16 de la Constitution a été plus constante dans la littérature des juristes que dans les discours politiques. Le responsable politique le plus critique du principe même de ces pouvoirs fut François Mitterrand. En 1965, il prenait sa part à la tradition consistant depuis 1958 à parler de « pouvoirs dictatoriaux »[42], mais en envisageant successivement au cours de la même campagne électorale présidentielle de 1965 d’« abroger » l’article 16, de le « modifier » ou de ne pas l’appliquer s’il était président de la République[43]. Et lorsqu’il devint président de la République en 1981, non seulement François Mitterrand ne prit aucune initiative en vue de modifier ou d’abroger l’article 16 de la Constitution, mais en plus les gouvernements socialistes ne formèrent jamais le projet de lever la réserve qui a été faite en 1974 par la France au moment de sa ratification de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la compatibilité de l’article 16 de sa Constitution, ainsi que de ses dispositifs d’état de siège et d’état d’urgence, avec l’article 15 de cette convention. Cette réserve a une double conséquence. En premier lieu, « si les conditions de mise en œuvre de l’article 16 ou des lois sur l’état de siège ou l’état d’urgence sont réunies, les organes internationaux ou internes n’auront pas à se poser la question de savoir si celles auxquelles l’application de l’article 15 de la Convention est subordonnée sont réunies, la réserve française [l’impliquant] automatiquement »[44]. D’autre part, la France avait précisé que « pour l’interprétation et l’application de l’article 16 de la Constitution de la République, les termes « dans la stricte mesure où la situation l’exige » ne sauraient limiter le pouvoir du président de la République de prendre « les mesures exigées par les circonstances » »[45].
En 1993, le président François Mitterrand et son Premier ministre, Pierre Bérégovoy, proposèrent néanmoins l’abrogation pure et simple de l’article 16 de la Constitution plutôt qu’une « nouvelle rédaction »[46]. « Il apparaît en effet que cet article, soutenaient-ils, qui n’a au demeurant été utilisé qu’une fois, il y a plus de trente ans, ne conditionne ni le rôle ni la place éminente du président de la République dans les institutions. De plus, notre droit prévoit, en dehors de l’article 16, les moyens nécessaires pour répondre à une situation de crise grave, notamment avec les régimes de l’état de siège et e l’état d’urgence. Enfin, et surtout, l’article 16 apparaît comme une exception dans la tradition démocratique du monde occidental : aucun des pays développés et démocratiques d’Europe ne dispose d’un dispositif juridique autorisant une telle concentration de compétences, de façon aussi contraire aux principes »[47]. Cette proposition d’abrogation est « saugrenue », jugea le doyen Georges Vedel[48], quelque peu contrarié de voir le président ne pas tenir compte de l’avis du comité d’experts qu’il venait de présider. La presse fit également savoir que cette abrogation avait fait l’objet d’un avis négatif du Conseil d’état lorsque ce dernier étudia l’avant-projet du gouvernement[49]. Comme le retour d’une majorité de droite à l’Assemblée nationale en 1993 condamnait à l’avance cette proposition d’abrogation de l’article 16, il a été dit qu’elle avait simplement servi au président Mitterrand à revendiquer une continuité dans sa contestation de l’article 16 de la Constitution.
B. L’état de siège : ni loi martiale, ni suspension de la Constitution
Si le concept de « loi martiale » désigne la situation dans laquelle la législation militaire et les institutions militaires se substituent, de manière complète ou significative, à la législation civile et aux autorités civiles, il est difficile de dire du dispositif de l’état de siège qu’il organise la « loi martiale » en France. S’agit-il davantage d’un dispositif de « suspension de la Constitution » ? Pas tout à fait. D’une part, ce dispositif ne se préoccupe pas de l’exercice du pouvoir politique tel qu’il est défini par la Constitution (il ne concerne pas les élections politiques, ni la distribution des compétences constitutionnelles entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif). D’autre part, ce dispositif n’affecte pas la mise en œuvre de chacun des droits et des libertés garantis par la Constitution mais seulement de ceux qui sont susceptibles d’entrer en conflit avec le maintien de l’ordre : l’état de siège permet de restreindre la liberté d’aller et de venir mais pas la liberté de se marier, même s’il est vrai que les restrictions de la liberté d’aller et de venir peuvent avoir des conséquences sur l’exercice effectif de la liberté de se marier, ce qui est une autre question. Le législateur a d’ailleurs été maladroit lorsqu’il a précisé que « nonobstant l’état de siège, l’ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s’exercer, lorsque leur jouissance n’est pas suspendue en vertu des articles précédents »[50]. En effet, l’état de siège n’affecte pas la jouissance de certains droits garantis par la Constitution, mais plutôt leur exercice : ce dispositif ne supprime aucun droit garanti par la Constitution, il en relativise plutôt l’exigibilité.
L’état de siège peut être décrété sur l’ensemble du territoire national ou sur un territoire limité[51]. Le fait de décréter l’état de siège a une triple portée juridique.
1. Portée de la substitution des autorités militaires aux autorités civiles en matière d’ordre public
En premier lieu, « aussitôt l’état de siège décrété, les pouvoirs dont l’autorité civile était investie pour le maintien de l’ordre et la police sont transférés à l’autorité militaire », l’autorité civile « [continuant] à exercer ses autres attributions »[52]. Comme le précise Olivier Gohin, ce transfert de compétences ne consiste pas en une suppression de la subordination des autorités militaires au pouvoir civil, ou plus exactement au Gouvernement[53].
En juxtaposant le « maintien de l’ordre » et la « police (administrative) », le législateur semble avoir voulu dire que les autorités militaires ne seraient pas seulement compétentes pour édicter des décisions administratives individuelles (autorisations individuelles, agréments individuels, etc.) ou réglementaires de police mais également pour exercer le commandement opérationnel des forces publiques de sécurité dans des opérations de maintien de l’ordre. Les décisions administratives ou individuelles de maintien de l’ordre et de police dont l’exercice est ainsi transféré aux militaires sont notamment celles qui sont prises en période ordinaire par le président du conseil général, par le préfet de département ou par le maire[54]. Or ces décisions ne sont pas uniquement celles qui sont visées par le code général des collectivités territoriales. Elles peuvent avoir été prévues par d’autres textes : tel est le cas, par exemple, des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la police des manifestations et des rassemblements, à la vidéoprotection, aux armes et munitions (police de l’acquisition et de la détention, police du commerce de détail…), aux jeux de hasard, aux casinos et aux loteries, à la fermeture administrative de certains établissements. Comme l’état de siège n’a plus été appliqué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la question n’a donc guère été posée de savoir s’il ne faudrait pas définir précisément et par voie d’énumération les pouvoirs de maintien de l’ordre et police transférables aux autorités militaires, compte tenu notamment de l’extension considérable des pouvoirs de maintien de l’ordre et de police des autorités administratives intervenue depuis 1849 et concomitante à l’extension de la notion d’« ordre public ».
2. Pouvoirs spéciaux de police des autorités militaires
L’état de siège permet cependant aussi aux autorités militaires d’exercer des pouvoirs de police dont les autorités civiles n’ont pas nécessairement la prérogative en période ordinaire. Les autorités militaires peuvent ainsi[55] : 1° faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ; 2° éloigner toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ; 3° ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ; 4° interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à menacer l’ordre public. De ces différents pouvoirs, celui qui s’est souvent prêté à une attention particulière des historiens et des autorités militaires est celui relatif à la censure. Alors qu’en 1849, il était prévu que cette censure ne puisse être décidée qu’à l’égard des publications auxquelles il était reproché d’« exciter ou [d’]entretenir le désordre », elle est désormais applicable de manière extensive aux publications « de nature à menacer l’ordre public ». Toutefois, même cette définition très large de la censure militaire peut ne pas « sécuriser » les autorités militaires dans le contexte d’une guerre, du fait du souvenir de la guerre franco-allemande de 1870 et des révélations par la presse à l’ennemi des positions des 12e et 13e corps d’armée du Maréchal de Mac-Mahon. Aussi, pendant la Première Guerre mondiale, l’armée avait préféré obtenir du Gouvernement et du parlement une loi pénale spéciale de censure : la loi du 5 août 1914 sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre[56] interdisait, à peine d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 5000 francs, la publication d’informations et de renseignements « autres que ceux qui seraient communiqués par le Gouvernement ou le commandement, sur les points suivants : ‒ les mouvements des troupes ‒ les pertes militaires ‒ les effectifs ‒ les renseignements stratégiques », et plus généralement la publication d’informations ou articles « concernant les opérations militaires ou diplomatiques de nature à favoriser l’ennemi et à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de l’armée et des populations ».
3. Compétence des juridictions militaires
La troisième et dernière portée juridique de l’état de siège a rarement fait l’objet en elle-même de critiques : il s’agit de la compétence des juridictions militaires pour connaître de certaines infractions. Cette compétence, qui ressort de l’article 700 du code de procédure pénale, du code de la défense et du code de justice militaire, est mise en œuvre de manière spécifique à celui des motifs invoqués par les pouvoirs publics pour déclencher l’état de siège. Ce sont ainsi certaines infractions spécifiques, quels qu’en soient les auteurs principaux ou les complices, dont la connaissance est transférable exceptionnellement à des juridictions militaires « dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère »[57], ce régime exceptionnel « [cessant] de plein droit à la signature de la paix »[58]. Ce sont certaines autres infractions spécifiques dont la connaissance est transférable exceptionnellement à des juridictions militaires « si l’état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d’une insurrection à main armée »[59].
C. L’état d’urgence : un dispositif démiurgique ou un fétiche animiste ?
Dans la très grande multiplicité des opinions de toutes origines (élus politiques, juristes, universitaires, journalistes, citoyens) produites depuis 1955 à la faveur de chaque application de l’état d’urgence, trois écoles peuvent être distinguées à propos des pouvoirs de crise caractéristiques de l’état d’urgence. Les uns acceptent ces pouvoirs « sans états d’âme ». Une deuxième catégorie d’opinions veut pouvoir apprécier au cas par cas la mise en œuvre de l’état d’urgence. Il y a enfin ceux qui rejettent le principe même de tels pouvoirs. La dernière catégorie, celle des adversaires du principe même de la loi de 1955, est intéressante parce qu’elle a pu être partagée entre deux courants dont un seul a survécu à l’histoire de la loi. Ce courant est celui de ceux pour qui la combinaison entre la police administrative « ordinaire » (police des réunions, police des manifestations et des rassemblements, police des circulations, etc.) et la procédure pénale (pour ainsi dire les procureurs de la République en général et le parquet anti-terroriste de Paris depuis les années 1980 en particulier), permet de gérer les événements qui sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’état d’urgence[60]. Le courant critique des pouvoirs d’état d’urgence dont on ne trouve plus d’écho en 2016 est celui qui consistait à soutenir que ce dispositif est plus attentatoire aux libertés que le dispositif de l’état de siège. Et, parmi les nombreuses raisons avancées à l’appui de cette thèse, il y avait celui consistant à dire que le pouvoir accordé au ministre de l’Intérieur d’ordonner des assignations administratives à résidence « conduirait inévitablement, sous une forme ou une autre, qu’on l’avoue ou qu’on ne l’avoue pas, à l’institution de camps de concentration, ne serait-ce que pour faciliter la surveillance, la nourriture et le logement des gens qui seraient déplacés »[61].
1. Droit en vigueur au moment des attentats de Paris
Avant sa modification par la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, les pouvoirs administratifs assortis à l’état d’urgence étaient les suivants[62] :
| Article de la loi du 3 avril 1955 |
Mesure |
Acte juridique de mise en œuvre de la mesure |
Condition supplémentaire de l’acte de mise en œuvre |
| Article 5 |
Interdiction de la circulation des personnes ou des véhicules |
Arrêté préfectoral |
– |
| Article 5 |
Institution de zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé |
Arrêté préfectoral |
– |
| Article 5 |
Interdiction de séjour |
Arrêté préfectoral |
– |
| Article 6 |
Assignation à résidence |
Arrêté ministériel |
Décret fixant les zones d’application de l’état d’urgence |
| Article 8 |
Fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion |
Arrêté préfectoral, ou arrêté ministériel (Intérieur) sur l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence |
Décret fixant les zones d’application de l’état d’urgence |
| Article 9 |
Remise des armes de 1ère, 4ème et 5ème catégories |
Arrêté ministériel (Intérieur) |
– |
| Article 10 |
Réquisitions de personnes ou de biens |
Ordre de réquisition préfectoral |
– |
| Article 11 (1°) |
Perquisitions à domicile de jour et de nuit |
Ordre de perquisition du ministre de l’Intérieur ou du préfet |
Mention expresse dans le décret déclarant ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence ; décret fixant les zones d’application de l’état d’urgence. |
| Article 11 (2°) |
Contrôle des médias[63] |
Arrêté préfectoral ou ministériel |
Mention expresse dans le décret déclarant ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence |
| Article 12 |
Compétence de la juridiction militaire pour les crimes |
Revendication de la poursuite par l’autorité militaire |
Décret ministériel (Justice et Défense)
|
La défense du dispositif de l’état d’urgence tel qu’il existait au moment des attentats de Paris de 2015 consistait à dire que les pouvoirs accordés au Gouvernement et aux préfets sont d’autant moins déraisonnables qu’ils sont gradués par l’article 11 de la loi : d’une part, l’état d’urgence peut être limité à certains territoires seulement, auquel cas ces différents pouvoirs ne peuvent s’exercer que dans les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles l’état d’urgence est décrété par le pouvoir exécutif ; d’autre part, deux des pouvoirs prévus par la loi de 1955 n’étaient applicables que si le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence le prévoyaient par « une disposition expresse » (la pratique de perquisitions administratives à domicile de jour et de nuit et le contrôle des médias).
La loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions n’a pas changé l’économie générale du dispositif de l’état d’urgence, même si elle contenait aussi bien de nouvelles mesures restrictives des libertés que de mesures de « libéralisation » du dispositif.
2. « Renforcement » du dispositif par la loi du 20 novembre 2015
Entre autres apports restrictifs des libertés de la loi du 20 novembre 2015, il y avait :
− la faculté pour les forces publiques de sécurité pratiquant des perquisitions administratives d’état d’urgence d’accéder aux terminaux informatiques trouvés sur les lieux de la perquisition et de stocker les données recueillies à cette occasion. Cette « adaptation » des perquisitions administratives à « l’évolution des technologies » a été invalidée par le Conseil constitutionnel le 19 février 2016. Après avoir considéré que la copie de données informatiques pendant une perquisition administrative d’état d’urgence était « assimilable à une saisie », le Conseil constitutionnel constata que « ni cette saisie ni l’exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l’occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s’y oppose et alors même qu’aucune infraction n’est constatée » et qu’« au demeurant peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition ». Par conséquent, a conclu le Conseil constitutionnel, la restriction au droit au respect de la vie privée des personnes prévue par la nouvelle loi était contraire à la Constitution[64].
− la faculté pour le ministre de l’Intérieur de procéder à des assignations administratives à résidence non plus seulement contre toute personne « dont l’activité s’avère dangereuse », mais contre toute personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que [leur] comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics (…) ». Cette définition plus large des conditions dans lesquelles une assignation administrative à résidence peut être décidée a été complétée par la possibilité pour le ministre de l’Intérieur de décider que la personne concernée était tenue de se présenter périodiquement à un commissariat de police ou à une brigade de gendarmerie ou qu’il lui était interdit d’entrer en contact avec d’autres individus nommément désignés par le ministre de l’Intérieur[65].
− la création d’une nouvelle possibilité de dissolution administrative d’une association. Outre les cas de dissolution administrative d’une association prévu par le droit en vigueur[66], il était désormais possible au président de la République de dissoudre en conseil des ministres « les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent »[67].
− l’attribution au ministre de l’Intérieur, pendant l’état d’urgence, du pouvoir de « prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ». L’on ne comprend la portée de cette disposition qu’en partant de la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme qui a introduit en droit français un mécanisme de blocage, à l’initiative du ministère de l’Intérieur, de sites internet provoquant à des actes terroristes ou apologétiques du terrorisme. Ce mécanisme oblige le Gouvernement à saisir d’abord les éditeurs et les hébergeurs afin de leur demander de retirer les contenus illicites. Ce n’est que si ce retrait n’a pas été opéré dans les 24 heures que le Gouvernement peut se tourner vers les fournisseurs d’accès afin d’obtenir le blocage du site problématique. Il appartient enfin à la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) de veiller à la bonne application de ces règles : les demandes de blocage du ministère de l’Intérieur lui sont communiquées et la commission peut demander au juge administratif de se prononcer sur leur légalité. Or, la loi du 20 novembre 2015 relative à l’état d’urgence, non seulement ne prévoit plus le délai de 24 heures, mais en plus elle ne prévoit pas non plus l’intervention de la CNIL. Au surplus, son langage est moins précis que celui de la loi de 2014 puisqu’il y est question « d’interruption de service » lorsque la loi de 2014 parlait plus précisément de retrait ou de blocage de sites, ainsi que de déréférencement de pages.
3. « Libéralisation » du dispositif par la loi du 20 novembre 2015
En 2015, le législateur a prétendu aller dans le sens du libéralisme avec principalement six innovations juridiques :
− désormais, l’Assemblée nationale et le Sénat « sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures »;
− les perquisitions administratives d’état d’urgence ne doivent être décidées que « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le lieu perquisitionné « est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Ce qui semblait être une évidence était désormais précisé dans la loi ;
− les perquisitions administratives d’état d’urgence ne pouvaient pas avoir lieu « dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ». Autrement dit, pendant l’état d’urgence, seules des perquisitions judiciaires pouvaient être diligentées dans ce type de lieux dans le cadre des règles « ordinaires » prévues par le code de procédure pénale ;
− les perquisitions administratives d’état d’urgence devaient être accomplies avec des égards pour l’article 66 de la Constitution qui prévoit que « l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ». Aussi, le procureur de la République territorialement compétent doit être informé de la décision du ministre de l’Intérieur ou du préfet de pratiquer une telle perquisition[68]. D’autre part, cette perquisition devait avoir lieu en présence d’un policier ou d’un gendarme ayant qualité d’« officier de police judiciaire ». Enfin, les perquisitions ne pouvaient être pratiquées qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins, autrement dit dans des conditions relativement proches de celles des perquisitions judiciaires ;
− l’abrogation du pouvoir du ministre de l’Intérieur ou du préfet de prendre des mesures de contrôle des médias (presse et publications de toute nature, émissions radiophoniques, projections cinématographiques, représentations théâtrales). Ce pouvoir avait été activé en faveur du ministre de l’Intérieur et du gouverneur général de l’Algérie pendant tout la durée de l’état d’urgence en Algérie en 1955, en faveur du ministre de l’Intérieur et des préfets pendant l’application de l’état d’urgence sur le territoire métropolitain en 1958 et en 1961. En revanche, l’état d’urgence de 1985 en Nouvelle-Calédonie, celui de 2005 ou celui de 2015-2016 n’ont pas été assortis d’une disposition expresse prévoyant l’application éventuelle d’une censure de la presse, de la radio, de la télévision, du cinéma ou du théâtre.
− l’abrogation du pouvoir du Gouvernement de transférer à des tribunaux militaires la compétence de juger « de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d’assises ».
4. Adaptations nouvelles introduites par la loi du 21 juillet 2016
Le projet de loi déposé par le Gouvernement au parlement le 19 juillet 2016 avait un double objectif. Il s’agissait d’abord de proroger pour une durée de trois mois l’état d’urgence[69] en assortissant cette prorogation d’une remise en vigueur des perquisitions administratives d’état d’urgence. Le Gouvernement a dit vouloir ainsi tirer les conséquences « de la persistance d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » après l’attentat commis le 14 juillet 2016 à Nice[70]. Le deuxième objectif du Gouvernement était de doter les forces de police du pouvoir de procéder à la saisie et à l’exploitation des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur le lieu d’une perquisition administrative d’état d’urgence. Ce faisant, le Gouvernement entendait surmonter les objections formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 19 février 2016[71].
La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste est triplement frappante au premier abord, d’une part en raison de son adoption par le parlement dans le cadre d’une session extraordinaire, d’autre part en raison du délai remarquablement court (deux jours) de son adoption par le parlement, enfin par son contenu et sa portée plus étendus et plus denses que ne l’était le projet gouvernemental puisqu’il s’est finalement agi d’un texte hybride comprenant concurremment des dispositions relatives au régime de l’état d’urgence et des dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme en dehors même de toute considération d’état d’urgence[72].
Dans ses dispositions relatives à l’état d’urgence, la loi du 21 juillet 2016 comporte donc plusieurs innovations :
− le ministre de l’Intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des « lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes »[73] ;
− le ministre de l’Intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner l’interdiction de cortèges, de défilés et de rassemblements pour lesquels la sécurité ne peut être garantie[74] ;
− le préfet peut autoriser, par décision motivée, les policiers et les gendarmes ayant qualité d’officier, d’agent de police judiciaire et d’agent de police judiciaire adjoint[75], à procéder à des contrôles d’identité, à des fouilles de véhicules, à des fouilles et inspections de bagages[76].
La loi modifia par ailleurs le régime juridique des perquisitions administratives en état d’urgence. Il a été précisé que lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu remplit les conditions fixées pour ces perquisitions, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition, cette autorisation étant régularisée en la forme dans les meilleurs délais et le procureur de la République en étant alors informé sans délai.
Surtout, et comme le souhaitait précisément le Gouvernement, la loi habilite les personnels de police à procéder à la saisie de données informatiques lors des perquisitions administratives : « Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, est-il prévu, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition ». Afin de « prendre en compte les raisons qui avaient conduit le Conseil constitutionnel à censurer ces dispositions dans leur rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 », trois garanties ont été définies par le législateur. En premier lieu, la saisie ou la copie de données informatiques, qui se fait en présence de l’officier de police judiciaire nécessairement présent lors de toute perquisition administrative, donne lieu à un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis, une copie en étant remise aux personnes intéressées. D’autre part, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et sans qu’aucune personne ne puisse y avoir accès avant l’autorisation du juge. Enfin, seul précisément un juge – le juge des référés du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition – peut autoriser l’exploitation de données ou de matériels saisis lors d’une perquisition administrative[77]. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en prévoyant ces différentes garanties légales, le législateur a, en ce qui concerne la saisie et l’exploitation de données informatiques, « assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public » et n’avait pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif[78]. Le Conseil constitutionnel s’est plutôt formalisé de l’hypothèse dans laquelle les données copiées caractériseraient une menace pour la sécurité et l’ordre publics sans conduire à la constatation d’une infraction. Or le législateur n’avait prévu aucun délai, après la fin de l’état d’urgence, à l’issue duquel ces données seraient détruites. Aussi, a jugé le Conseil constitutionnel, le législateur, en ce qui concerne la conservation de ces données, « n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public »[79].
5. « Constitutionaliser l’état d’urgence »
Immédiatement après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, le président de la République prit l’engagement de présenter au parlement un projet de loi constitutionnelle en vue d’« inscrire l’état d’urgence dans la Constitution ». Beaucoup de juristes exprimèrent leur enthousiasme dans les médias[80], sans s’interroger sur le fait de savoir s’il était dans les principes ou dans les traditions du constitutionnalisme de vouloir réviser la Constitution pendant un état d’exception[81] et sans se poser des questions sur l’urgence même de cette révision constitutionnelle ou sur la différence entre le fait de « constitutionnaliser » un dispositif ou un principe et le fait de le définir de manière libérale.
En faisant la proposition d’une révision de la Constitution dans un moment particulièrement dramatique, alors que les rues de Paris étaient désertes et que des touristes estimaient devoir quitter la France, le président de la République a nécessairement donné le sentiment de voir dans cette révision de la Constitution une urgence. Toutefois, le président de la République avait lui-même contredit ce sentiment d’urgence en plaçant sa proposition sous l’autorité du « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République » présidé par l’ancien Premier ministre Edouard Balladur et dont le rapport datait de… 2007[82]. À l’évidence, l’urgence de cette proposition n’avait pas sauté aux yeux des députés, des sénateurs et du pouvoir exécutif lorsque la Constitution a fait l’objet en 2008 de sa plus importante révision[83] d’un point de vue « quantitatif » et du point de la protection constitutionnelle des libertés[84]. D’une certaine façon l’urgence et/ou la nécessité de cette révision constitutionnelle ont été démenties par l’échec parlementaire, au printemps 2016, du projet de loi constitutionnelle « de protection de la nation » déposé par le gouvernement au parlement le 23 décembre 2015. Le fait que le désaccord entre le Sénat et l’Assemblée nationale n’ait pas porté sur les dispositions de ce texte qui se proposaient de donner une assise constitutionnelle à l’état d’urgence mais sur celles relatives à la déchéance de nationalité ne change rien à l’affaire.
La révision constitutionnelle envisagée aurait donc voulu ajouter dans la Constitution un article 36-1 ainsi rédigé :
« L’état d’urgence est déclaré en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements.
« La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée. »
Il s’agissait de faire remonter de la loi vers la Constitution les motifs justificatifs de l’état d’urgence, sans rien changer à l’énonciation formelle de ces motifs tout en empêchant il est vrai le parlement de les modifier, dans un sens (libéral) ou un autre (non libéral). Pour autant, si la disposition constitutionnelle envisagée avait existé en 2005 ou en 2015, il n’y aurait pas moins eu des controverses sur l’opportunité de recourir à l’état d’urgence. Il s’agissait encore de faire remonter de la loi vers la Constitution la compétence du parlement pour maintenir en vigueur l’état d’urgence au-delà de douze jours. Cela voulait dire que cette compétence de la loi ne pouvait pas être supprimée ou modifiée par une majorité parlementaire mais par une révision constitutionnelle et qu’une loi ne pourrait pas prévoir que la durée de l’état d’urgence serait indéterminée. Pour autant, quand bien même la disposition constitutionnelle envisagée aurait-elle existé en 2005 ou en 2015, il n’y aurait pas moins eu des controverses sur l’opportunité des prorogations de l’état d’urgence décidées par le parlement.
Trois silences du projet de révision constitutionnelle présenté en 2015 retiennent l’attention.
Le premier silence a porté sur la nature des pouvoirs et des dérogations à la légalité ordinaire assortis à l’état d’urgence. Le Gouvernement a d’autant moins envisagé de « constitutionnaliser » ces pouvoirs, autrement dit de suspendre leur modification à une révision constitutionnelle, qu’il venait d’obtenir du parlement, rapidement et sans complications, une adjonction de nouveaux pouvoirs de police dans la loi de 1955[85], au nom de l’efficacité de l’action policière.
Le deuxième silence du texte gouvernemental portait sur une idée à laquelle il avait dû renoncer et qui aurait permis au Gouvernement de pouvoir faire usage de ses pouvoirs d’état d’urgence après l’expiration de ce dernier. C’est ce que le Gouvernement a présenté comme une « sortie progressive de l’état d’urgence » : « C’est indispensable, avait plaidé un conseiller du Président de la République, si nous le levons d’un seul coup et qu’un attentat survient dans la foulée, vous imaginez les réactions »… »[86]. Le Gouvernement avait donc envisagé de proposer l’introduction dans la Constitution d’une disposition aux termes de laquelle « Lorsque le péril ou les événements ayant conduit à décréter l’état d’urgence ont cessé mais que demeure un risque de terrorisme, les autorités civiles peuvent maintenir en vigueur les mesures prises [en vertu de l’état d’urgence] pour une durée maximale de six mois ». « Mais, comme dirait M. de La Palice, avait-on fait remarquer, si le danger « demeure », c’est qu’il n’a « pas cessé » ! Et inversement. Comment, alors, justifier la levée ou le maintien de l’état d’urgence ? Autre souci : durant la période intermédiaire, les restrictions des libertés pourront non seulement être intégralement maintenues mais aussi étendues grâce à de nouvelles « mesures générales » »[87]. Le Gouvernement s’est rangé à ces objections et a renoncé finalement à une idée qui ne figura finalement pas dans le projet de loi constitutionnelle soumis au parlement.
Le troisième silence du projet de révision constitutionnelle a porté sur les contrôles de l’application de l’état d’urgence. L’explication de ce silence est quelque peu prosaïque : le Gouvernement n’a pas trouvé d’idées réformistes et innovantes en la matière qui doivent absolument faire l’objet d’une ou de plusieurs dispositions spécifiques dans la Constitution. Pour cause, le système français de contrôle des dispositifs d’état d’exception était formellement moins lacunaire en 2015 qu’il ne pouvait l’être un demi-siècle plus tôt.
*
Formellement, le contrôle politique que l’opinion publique est supposé exercer sur l’état d’exception a gagné aussi bien avec la disparition de la tutelle exercée par l’état sur la radio et la télévision jusqu’au début des années 1980 qu’avec l’internationalisation de l’information et la démultiplication de services de communication en ligne. Le fait est néanmoins qu’aussi bien en 2005 qu’en 2015, l’acceptation par l’opinion publique de l’état d’urgence et son apathie vis-à-vis de certaines formes de démesure policière ont été imputées à la « propagande gouvernementale » ou à l’influence des « médias de masse ». à tort ou à raison, peu ou prou, cette vision fait de l’opinion publique un « sujet » infantile ou aliéné à la peur.
Les moyens formels du contrôle politique que le parlement est supposé exercer sur l’état d’exception sont pour la plupart d’entre eux liés au parlementarisme : − qu’il s’agisse des « procédures d’information » et des débats (les différents types de questions susceptibles d’être posées au Gouvernement) ; − qu’il s’agisse de la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement ; − qu’il s’agisse des commissions parlementaires d’enquête ou des autres prérogatives parlementaires de mener des investigations dont ont été dotées les chambres dans la période contemporaine (missions d’information, groupes de travail créés par les commissions parlementaires) ; − qu’il s’agisse de la prérogative de voter des résolutions[88] consentie aux assemblées parlementaires par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ; − qu’il s’agisse encore de la disposition introduite par la loi du 20 novembre 2015 dans la loi de 1955 sur l’état d’urgence et qui, d’une part, exige du Gouvernement qu’il informe « sans délai » l’Assemblée nationale et le Sénat des mesures prises pendant l’état d’urgence, d’autre part permet aux assemblées parlementaires de « requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ». L’état d’urgence décrété après les attentats de Paris du 13 novembre 2015 est peut-être la première application de l’état d’exception en France qui ait fait l’objet de la part du parlement d’une importante sollicitation de ses moyens de contrôle[89]. Par hypothèse cet intérêt participe de la culture du contrôle parlementaire ayant prospéré en France au tournant des années 2000. L’on peut néanmoins se demander si cette désinhibition du contrôle parlementaire ne se fait pas, malgré tout, à l’intérieur de cette autre contrainte « culturelle » qu’est l’hypersensibilité des institutions policières et militaires aux critiques et à la très grande appropriation de cette hypersensibilité par les décideurs politiques[90].
Une équivoque caractérise les contrôles juridictionnels des états d’exception : alors que le décret par lequel le président de la République déclenche l’article 16 ne se prête pas à un contrôle du Conseil d’état parce qu’il constitue un « acte de gouvernement », le Conseil d’état n’applique pas le même principe au décret qui déclenche l’état de siège ou l’état d’urgence, ce qui veut dire que le président de la République n’est pas « souverain » dans l’appréciation de la nécessité de déclencher l’état de siège ou l’état de siège. Mais cette différence de traitement par le Conseil d’état entre l’article 16 de la Constitution et les deux autres dispositifs ne s’appuie pas sur des raisons claires. Dans le cas de l’état de siège, il a souvent été dit que le Conseil d’état n’a fait que perpétuer une solution de la Cour de cassation datée du xixe siècle[91]. Or l’arrêt Geoffroy c. ministère public n’a pas tout à fait porté sur la validité du déclenchement de l’état de siège et il a été rendu, comme l’arrêt Sieur Huckel du Conseil d’état de 1953[92], dans un contexte dans lequel l’état de siège n’avait pas de fondement constitutionnel. En tout état de cause, la probabilité de voir le Conseil d’état contredire le président de la République sur la nécessité de déclencher l’état de siège ou l’état d’urgence est particulièrement faible, puisque le Conseil n’exerce sur ces décisions qu’un « contrôle restreint ».
Deux innovations ont marqué l’histoire contemporaine des contrôles juridictionnels susceptibles de s’exercer à l’occasion d’un état d’exception. La première innovation consiste dans le contrôle du Conseil constitutionnel, qu’il s’agisse de son contrôle a priori d’une loi prorogeant l’état de siège ou l’état d’urgence, ou de son contrôle a posteriori en « question prioritaire de constitutionnalité » de dispositions législatives adoptées par des lois de prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence[93]. La deuxième innovation consiste dans la création par la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, d’une procédure d’urgence (« référé-liberté ») permettant de saisir ces juridictions afin de leur demander de se prononcer dans les 48 heures sur l’opportunité de suspendre une décision administrative portant « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Or les mesures administratives prises dans le cadre des différents dispositifs d’état d’exception ne sont pas exclues du champ d’application de cette procédure d’urgence.
Il n’est cependant pas aisé d’évaluer les décisions rendues par les juges sur des mesures prises pendant un état d’exception, pour quatre raisons. En premier lieu, un grand nombre de ces décisions sont rendues par des juridictions « de base » et n’accèdent pas à la visibilité des décisions rendues par ailleurs par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’état. D’autre part, on ne saurait postuler que le libéralisme consiste pour le juge à accéder à toutes les mises en cause des décisions prises par les autorités publiques[94]. En troisième lieu, si l’on est convaincu de ce que les juges français sont « aux ordres du pouvoir », la tentation est grande de vouloir légitimer cette prémisse en se fixant davantage sur les décisions des juges favorables à l’état[95]. Enfin, comme le principe même de l’état d’exception est de permettre de déroger à la légalité ordinaire, il faudrait pouvoir juger les décisions rendues à ce titre par les tribunaux à l’aune d’autres standards que ceux de la légalité ordinaire. Pour ainsi dire, les juges eux-mêmes doivent décider à l’aune d’autres standards que ceux qu’ils éprouvent en légalité ordinaire. Et ils sont supposés le faire en gardant à l’esprit que l’état d’exception aiguise particulièrement la « demande de sécurité » des citoyens (ou excite particulièrement leur « sentiment d’insécurité », ça dépend du point de vue où l’on se place). L’autolimitation des juges en période d’exception – que leur langage traduit de nombreuses manières[96] − a donc quelque chose d’inévitable. La question devient alors celle-ci : comment distinguer une autolimitation des juges (celle-ci étant en théorie libérale) d’une compromission des juges avec le refus du libéralisme ?
[1] Articles L.2121-1 à L.2121-8.
[2] Pour toutes sortes de raisons, les pouvoirs publics ont renoncé à codifier la loi de 1955 dans le Code de la défense ou dans le Code de la sécurité intérieure lorsque ces deux codes ont été créés (2004 et en 2012). Chacun de ces codes contient néanmoins un chapitre sur l’état d’urgence mais avec un renvoi à la loi de 1955 (article L. 2131-1 du code de la défense, article L. 213-1 du code de la sécurité intérieure).
[3] Tableau emprunté au rapport présenté le 15 novembre 2005 par le député Philippe Houillon sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (Assemblée nationale, document parlementaire n° 2675).
[4] Jacques Genton, rapporteur, Assemblée nationale, 2e séance du 30 mars 1955, compte-rendu intégral, p. 2130.
[5] Ibid.
[6] Le code désigne, en effet, sept régimes juridiques « exceptionnels » de défense : la guerre ; l’état d’urgence ; l’état de siège ; la « mobilisation » ; le « service de défense » ; les « sujétions résultant des manœuvres et exercices » ; le « dispositif de réserve de sécurité nationale ».
[7] Ces références bibliographiques sont données par : Olivier Gohin, « Les dispositifs d’état d’exception », in Traité de droit de la police et de la sécurité (Pascal Mbongo, dir.), LGDJ, 2014, p. 301-333 ; voir également de Olivier Gohin et Xavier Latour (dir.), Code de la sécurité intérieure, Lexisnexis, 2016.
[8] Voir par exemple de Bruno Dive, Au cœur du pouvoir. L’exécutif face aux attentats, Plon, 2016, et notre recension de l’ouvrage : « Les attentats de Paris et le for intérieur de l’État », nonfiction.fr, 9 mars 2016.
[9] Article 12.
[10] La Constitution du 27 octobre 1946 ne contenait pas à l’origine une référence à l’état de siège. C’est une loi constitutionnelle du 7 décembre 1954 qui a complété son article 7 par la phrase : « L’état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi ».
[11] Olivier Gohin, in Traité de droit de la police et de la sécurité (Pascal Mbongo, dir.), LGDJ, 2014, p. 315.
[12] Assemblée nationale, 1re séance du 31 mars 1955, compte-rendu intégral, p. 2173.
[13] Maurice Bourgès-Maunoury, ministre de l’Intérieur, Assemblée nationale, 1re séance du 31 mars 1955, compte-rendu intégral, p. 2174.
[14] Jean-Louis Debré, Les idées constitutionnelles du général De Gaulle, Paris, LGDJ, 1974, p. 186 et s. ; Michèle Voisset, L’article 16 de la Constitution de 1958, Paris, LGDJ, 1969.
[15] L’avis du Conseil constitutionnel est motivé et publié (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, article 53). Il s’agit d’un « avis simple ». Autrement dit, il n’oblige pas le président de la République.
[16] Rapport remis au président de la République le 15 février 1993 par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution, J.O., 16 février 1993, p. 2540.
[17] Loi des 8-10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs. Ce texte est souvent désigné comme étant le « décret de 1791 » ou la « loi du 10 juillet 1791 ».
[18] Senatus consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802).
[19] Article L. 2121-1 du Code de la défense.
[20] Sur la possibilité pour les juges de se prononcer sur un décret de déclenchement de l’état de siège, voir notre conclusion.
[21] Article L. 1111-1 du code de la défense.
[22] Article 35 de la Constitution.
[23] Assemblée nationale, 1re séance du 31 mars 1955, compte-rendu intégral, p. 2170.
[24] Ibid.
[25] L’état d’urgence décidé en Nouvelle-Calédonie le 12 janvier 1985 l’avait été par le haut-commissaire de la République en application d’un texte spécial donnant à ce « préfet » le pouvoir d’appliquer le dispositif de la loi de 1955.
[26] Saisine de soixante députés et de soixante sénateurs par le Conseil constitutionnel contre la loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
[27] Cons. Const., n° 85-187 DC, 25 janvier 1985, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, Recueil, p. 43.
[28] C.E., ordonnance de référé du 14 novembre 2005, M. Rolin, Recueil Lebon, 499 ; AJDA 2006. 501, note Chrestia ; BJCL 11/05, p. 754, obs. J.-C. B.
[29] Nous écrivons sic parce que cette phrase comprend une faute de grammaire : le verbe menacer aurait dû être au féminin.
[30] Décision du 23 avril 1961 portant application de l’article 16. Le général De Gaulle s’était néanmoins justifié dans un célèbre discours radiotélévisé du 23 avril 1961.
[31] Georges Burdeau, Libertés publiques, Paris, LGDJ, 1972, p. 54.
[32] Rapport remis au président de la République le 15 février 1993 par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution, J.O., 16 février 1993, p. 2540.
[33] Paul Ourliac, « Standard juridique », in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de philosophie du droit, LGDJ, 1993, p. 581.
[34] Voir notamment : Sénat, direction de l’initiative parlementaire et des délégations, Le régime de l’état d’urgence. Étude de législation comparée (Allemagne – Belgique – Espagne – Italie – Portugal – Royaume-Uni), mars 2016 : http://www.senat.fr/lc/lc264/lc264.pdf
[35] François Mitterrand, député, Assemblée nationale, 1re séance du 31 mars 1955, compte-rendu intégral, p. 2167. François Mitterrand était ministre de l’Intérieur du gouvernement de Pierre Mendès France qui élabora un premier projet de loi sensiblement différent de celui présenté en mars 1955 par le gouvernement d’Edgar Faure.
[36] Sylvie Thénault, « L’état d’urgence (1955-2005). De l’Algérie coloniale à la France contemporaine : destin d’une loi », Le mouvement social, n° 218, janvier-mars 2007, p. 65-66.
[37] Sur les détails de cette articulation, voir les précisions données par Olivier Gohin, in Traité de droit de la police et de la sécurité, p. 326.
[38] CE, Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens, Recueil Lebon, p. 143.
[39] La liste des mesures intervenues en vertu de l’article 16 de la Constitution entre le 23 avril 30 et le 29 septembre 1961 est consultable sur le site du professeur Michel Lascombe :
http://michel-lascombe.pagesperso-orange.fr/CDVR16.html#ListeMesuresA1 de la CoNS T6
[40] CE, Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens, Recueil Lebon, p. 143.
[41] J.O., 28 avril 1961, p. 3947. Ce système de censure a été en vigueur jusqu’au 15 juillet 1962.
[42] François Mitterrand, allocution radiotélévisée du 22 novembre 1965, citée par Roger-Gérard Schwartzenberg, in La campagne présidentielle de 1965, Paris, PUF, 1967, p. 35.
[43] Roger-Gérard Schwartzenberg, La campagne présidentielle de 1965, Paris, PUF, 1967, p. 35.
[44] Alain Pellet, « La ratification par la France de la Convention européenne des droits de l’Homme », RDP, 1974, p. 1359-1360.
[45] Cet aspect de la réserve française se prête depuis lors à des débats doctrinaux sur sa compatibilité avec l’interdiction de réserves de caractère général posées par l’article 64 § 1er ancien (article 57 § 1er actuel) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
[46] François Mitterrand, déclaration faite à l’Agence France-Presse le 2 mars 1993 et citée par Gilles Paris, « François Mitterrand propose l’abrogation de l’article 16 », Le Monde, 4 mars 1993).
[47] Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle n° 231 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VII, VIII, IX et X déposé au Sénat le 11 mars 1993).
[48] Georges Vedel, La Croix, 6 mars 1993.
[49] Thierry Bréhier, « Le Conseil d’état est opposé à l’abrogation de l’article 16 », Le Monde, 11 mars 1993.
[50] Article L. 2121-8 du code de la défense.
[51] Article L. 2121-1 du code de la défense.
[52] Article L. 2121-2 du code de la défense.
[53] Olivier Gohin, in Traité de droit de la police et de la sécurité, précité, p. 316.
[54] Voir en premier lieu les articles L. 131-1 à L. 131-6 du code de la sécurité intérieure.
[55] Article L. 2121-7 du code de la défense.
[56] J.O., 6 août 1914, p. 7128.
[57] Article L. 2121-3 du code de la défense.
[58] Ibid.
[59] Article L. 2121-4 du code de la défense.
[60] Pouria Amirshahi (député socialiste), « Pourquoi je voterai contre la prolongation à 3 mois d’un état d’urgence », Lemonde.fr, 19 novembre 2015.
[61] Louis Vallon (député), Assemblée nationale, 1re séance du 31 mars 1955, compte-rendu intégral, p. 2161.
[62] Source du tableau : Jean-Jacques Urvoas, Rapport au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi, Assemblée nationale, document n° 3237, 19 novembre 2015, p. 52.
[63] Presse, publications de toute nature, émissions radiophoniques, projections cinématographiques, représentations théâtrales.
[64] Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l’homme.
[65] Dans un sens plus libéral, il a également été prévu que cette restriction à la liberté des personnes pouvait s’appliquer à temps partiel à raison de huit heures par jour afin de permettre à l’intéressé de pouvoir exercer son activité professionnelle.
[66] L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure a codifié la célèbre loi du 10 janvier 1936 « sur les groupes de combat et les milices privées », qui a connu des modifications successives. Cet article permet donc au président de la République de dissoudre, par décret en conseil des ministres, une association ou un « groupement de fait » (autrement dit une association non déclarée aux pouvoirs publics) : 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ; 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ; 6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
[67] Cette disposition a souvent été justifiée par la nécessité de donner au Gouvernement le moyen juridique de dissoudre rapidement certaines mosquées.
[68] La loi du 18 novembre 2015 a codifié ainsi une pratique d’autant plus établie qu’il revient au procureur de la République de donner des suites judiciaires en cas de découverte d’indices d’infractions pénales.
[69] L’état d’urgence fut déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et prorogé par les lois du 20 novembre 2015, du 19 février 2016 et du 20 mai 2016.
[70] « Au cours des dernières semaines, la réorientation de la stratégie de l’organisation terroriste Daech constitue un élément de contexte nouveau. Celle-ci a été affaiblie dans sa zone d’influence syro-irakienne, à la suite des opérations militaires ayant permis, notamment, la reprise particulièrement symbolique de la ville de Fallouja. L’organisation Daech a ainsi perdu, au cours de la période récente, une part significative du territoire qu’elle contrôlait. Cette évolution de la situation, conjuguée à la perte d’une part significative de ses combattants, amène l’organisation à redoubler ses frappes à l’étranger pour prouver que sa capacité destructrice reste réelle malgré cet affaiblissement. Cette évolution de la donne stratégique renforce l’intensité de la menace terroriste sur notre territoire » (exposé des motifs).
[71] Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l’homme.
[72] Ces règles relatives à la lutte contre le terrorisme se rapportent aux modalités d’aménagement de peine des personnes condamnées pour terrorisme, au régime de vidéosurveillance dans les cellules des établissements pénitentiaires notamment pour les personnes en détention provisoire, à l’augmentation de la durée maximale d’assignation à résidence pour les personnes de retour d’un théâtre d’opérations à l’étranger de groupements terroristes, à l’augmentation du quantum des peines applicables aux crimes terroristes, à l’allongement des délais de détention provisoire pour les mineurs mis en cause dans des procédures terroristes, à la rétention de sûreté et surveillance de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme, à l’automaticité de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers, à l’assouplissement des conditions d’autorisation de l’armement des policiers municipaux…
[73] Article 8 modifié de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
[74] Ibid.
[75] Plus exactement il s’agit des agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.
[76] Article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
[77] Ce juge statue en urgence dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, sa décision d’accorder ou non l’autorisation demandée étant rendue, « au vu des éléments révélés par la perquisition », à la lumière de la régularité de la procédure de saisie et de la question de savoir si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. Voir à ce propos l’ordonnance rendue par le Conseil d’état le 5 août 2016 (ministère de l’intérieur, n° 402139).
[78] Cons. const., n° 2016-600 QPC, M. Raïme A. [Perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence III].
[79] Ibid.
[80] M. Jean-éric Callon par exemple, dans les colonnes du Monde, assura que cette révision était « urgente » et que toute objection à la nécessité ou à l’urgence de cette révision n’étaient qu’« ergotage » (Jean-éric Callon, « Oui, il faut réviser la Constitution », Le Monde, 7 décembre 2015). Sur ces « ergotages », voir les annexes 2 et 3 du présent volume.
[81] Certaines constitutions (Pologne, Roumanie, Lituanie…) interdisent d’ailleurs de modifier la Constitution durant un état d’exception. L’article 89 de la Constitution de la Ve République pour sa part n’interdit la révision constitutionnelle que « lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire », et sans référence particulière aux dispositifs d’état d’exception. Au demeurant, l’interdiction posée par l’article 89 de la Constitution ne vaut en principe que pour les révisions constitutionnelles menées selon cette procédure et pas pour celles qui sont menées suivant la procédure de l’article 11.
[82] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000697.pdf
[83] Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
[84] Consécration constitutionnelle de l’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes, précision de la portée de la liberté des partis politiques, encadrement des pouvoirs exceptionnels de crise du président de la République, création de la question prioritaire de constitutionnalité, création du Défenseur des droits, etc.
[85] Voir supra.
[86] Le Canard Enchaîné, 9 décembre 2015.
[87] H. L., « Les acrobaties de l’état d’urgence », Le Canard Enchaîné, 9 décembre 2015.
[88] Article 34-1 de la Constitution.
[89] Création d’un comité de suivi de l’état d’urgence au Sénat, veille de la commission des lois de l’Assemblée nationale, questions parlementaires, auditions de responsables politiques, de hauts responsables de la police et de la gendarmerie, d’experts et de défenseurs des libertés (voir par exemple : Dominique Raimbourg et Jean-Dominique Poisson, Rapport du 25 mai 2016 au nom de la commission des lois sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, Assemblée nationale, document parlementaire n° 3784).
[90] Entre autres raisons de cette appropriation, il y a la conscience des décideurs publics de la difficulté particulière du travail policier ou militaire, leur prise en compte de ce que les Français ont un rapport équivoque vis-à-vis de la police nationale et de l’armée.
[91] Cass., Geoffroy c. ministère public, 30 juin 1832, Recueil Dalloz, p. 265-274.
[92] CE, Ass., 23 octobre 1953, Sieur Huckel, Rec. 452.
[93] Voir par exemple, à propos des assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence : Cons. Const., n° 2015-527 QPC, 22 décembre 2015, M. Cédric D., JO, 26 décembre 2015, p. 24084.
[94] Ce postulat était très caractéristique de la tribune anonyme publiée le 29 décembre 2015 sur le site d’information en ligne Mediapart par « une dizaine de juges administratifs ». « Lorsque la loi, écrivaient ces juges anonymes, comme c’est le cas de celle portant application de l’état d’urgence, instaure un état d’exception dont la nature est d’éclipser des pans entiers de l’ordre constitutionnel normal et permet de déroger à nos principaux engagements internationaux, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le pouvoir du juge est limité : il doit seulement vérifier si les mesures exceptionnelles autorisées par l’état d’urgence pouvaient être prises à l’encontre des personnes concernées. Ce pouvoir, les sept ordonnances rendues le 11 décembre 2015 par le Conseil d’État ne l’ont pas, à notre sens, suffisamment renforcé ». Source : https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/291215/etat-d-urgence-des-juges-administratifs-appellent-la-prudence
[95] C’est dans cette dernière mesure que la tradition académique française se partage entre ceux qui sont convaincus de ce que le Conseil d’état a été « gardien des libertés » et ceux qui sont convaincus de ce que le Conseil d’état a plutôt été accommodant avec les refus du libéralisme.
[96] L’« absence d’erreur manifeste d’appréciation » de la part des pouvoirs publics, le « caractère non-déraisonnable de la décision litigieuse », etc.