



Dans son rapport aux libertés fondamentales, François Mitterrand se distingue significativement de ses prédécesseurs et de ses successeurs sous la Ve République par le fait que sa biographie ‒ au-delà de la fréquentation par l’intéressé de cercles et de manifestations de la « droite de la droite » avant-guerre[1] ‒ est infiniment plus articulée à ces questions que celles des autres présidents de la République.
François Mitterrand est diplômé en droit (1934-1939). L’on peut faire l’hypothèse qu’ayant fréquenté la faculté de droit avant-guerre, il y a été socialisé à certains questionnements ou à des réflexions de nature plus ou moins savante sur les « libertés publiques », comme on disait à l’époque[2]. En revanche, François Mitterrand a plutôt été membre du Barreau de Paris qu’il n’a été… avocat. Peut-être l’inscription au Barreau de Paris était-elle la seule possibilité qui s’offrait alors à qui ne se sentait pas une disposition particulière pour la magistrature ou le notariat[3].
François Mitterrand a plus sûrement exercé de très nombreuses fonctions politiques dans le contexte desquelles la référence aux « libertés publiques » fut centrale à différents égards[4]. En tant que député de la Nièvre (1946-1958), il fut membre de la commission de la presse, secrétaire d’État à la présidence du Conseil chargé de l’information dans le cabinet André Marie (26 juillet 1948-5 septembre 1948), Secrétaire d’état à la vice-présidence du Conseil dans le deuxième cabinet Robert Schuman (5 septembre 1948-11 septembre 1948), Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil dans le premier cabinet Henri Queuille (11 septembre 1948-28 octobre 1949), membre de la commission de l’Intérieur (27 janvier 1956-31 janvier 1956), ministre d’État, garde des sceaux chargé de la Justice dans le cabinet Guy Mollet (1er février 1956-13 juin 1957). Sénateur de la Nièvre (1959-1962), il fut membre de la commission des affaires étrangères et il fit l’expérience de la levée de son immunité parlementaire le 25 novembre 1959 dans l’affaire de l’Observatoire. Député de la Nièvre (1962-1981), il siégea à la commission des lois jusqu’en 1973 puis à celle des Affaires étrangères jusqu’en 1980.
Surtout, François Mitterrand a accédé à la présidence de la République en 1981 avec une propriété plus distinctive encore : il est le seul président de la République ayant promu une vision dogmatique, systématique des libertés avant son élection. Cette vision dogmatique a eu pour moment intellectuel de référence le Comité d’étude et de réflexion pour une Charte des libertés et des droits fondamentaux qu’il met en place en 1975[5], un comité que présidait Robert Badinter et qui comptait d’autres professeurs de droit comme lui, des avocats, des magistrats. Cette vision dogmatique des libertés a été traduite dans celles des 110 propositions de 1981 et dans ceux des développements du programme législatif du parti socialiste qui se rapportaient aux libertés.
La question que l’on voudrait envisager est celle de la résonance législative (ou réglementaire), sous la double présidence de François Mitterrand, de cette apparente doctrine des libertés. Cette manière d’envisager les choses a au moins une justification formelle (la compétence primaire de la loi en matière de « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », art. 34 Const.) et elle exclut du champ de l’étude la jurisprudence luxuriante du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l’Homme, de la Cour de cassation ou du Conseil d’état, puisque par définition, cette jurisprudence n’est pas imputable au président de la République ou à une majorité parlementaire. La thèse que l’on se propose de défendre est la suivante : même si, en effet, il y eut, l’abolition de la peine de mort (1981), la « dépénalisation de l’homosexualité » (1982) ou les lois Auroux, vue de manière plus globale, la politique législative des gouvernements de gauche sous la double présidence de François Mitterrand n’a pas été révolutionnaire par rapport à ce que Pierre Rosanvallon appelle l’« illibéralisme » français[6]. On voudra vérifier cette thèse en mettant en évidence, s’agissant du libéralisme institutionnel, l’absence dans les décisions prises pendant ces années d’une vision cohérente des freins et des contrepoids (I) et, s’agissant du pluralisme, la perpétuation du magistère de l’état sur la communication sociale (II).
Lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, le système institutionnel français est confronté à deux défis au regard des standards de la prééminence du droit déjà promus par le Conseil de l’Europe : l’absence d’un véritable tiers-pouvoir (A), la très grande autonomie du pouvoir policier (B).
Entre 1981 et 1995, le système juridictionnel français s’est considérablement « approfondi », avec le développement considérable d’une jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative aux libertés et aux droits fondamentaux ou l’inscription des juridictions françaises dans un système de normes plus complexe et surplombé par des normes constitutionnelles ou d’origine externe qui accroissent nécessairement le pouvoir de ces juridictions.
Exception faite de la suppression de la Cour de sûreté de l’État[7] et de la compétence en temps de paix des juridictions militaires[8], l’« approfondissement » du système juridictionnel français doit ainsi pour une très large part à des facteurs extérieurs à une décision des organes politiques élus. En effet, la rampe de lancement du Conseil constitutionnel a été installée dans les années 1970. Quant à l’acceptation par la France des instruments internationaux et européens relatifs aux libertés et aux droits fondamentaux, son assise dans le champ politique s’élargit dans les mêmes années 1970. Il est vrai cependant que cette tendance ne trouve son point d’orgue que dans les trois premières années de la présidence de François Mitterrand, avec : l’acceptation du droit de recours individuel devant la défunte commission européenne des droits de l’Homme (1981) ; l’acceptation du recours individuel devant le comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (1982) ; la déclaration française de mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies du 9 septembre 1975 sur la protection des personnes contre la torture, les peines et les traitements cruels, inhumains et dégradations (1982) ; la ratification de la Convention européenne relative à la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données personnelles (1982) ; la ratification du premier protocole au pacte international relatif aux droits civils et politiques (1983) ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1983). Cette pleine inscription de la France dans la protection internationale des libertés et des droits ne s’est pas toujours faite sans ambiguïtés, comme le montre, par exemple, le fait que, dans le même temps, les réserves françaises à la CESDH ou aux pactes des Nations unies de 1966 n’avaient pas été levées. C’est que, en effet, ces initiatives étaient plutôt souvent perçues par le Gouvernement comme autant de « gestes symboliques » dont il n’attendait pas qu’ils affectent les pratiques françaises mais qu’ils consolident la politique extérieure de la France, notamment les condamnations françaises des violations des libertés et des droits commises à l’étranger[9].
L’« approfondissement » du système juridictionnel français n’est cependant pas allé jusqu’à une remise en cause radicale de la subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. De manière constante entre 1958 et 1981, François Mitterrand, et avec lui toute la gauche parlementaire, a mis en cause la partialité des recrutements judiciaires, la partialité des nominations et des avancements, la pratique de sanctions arbitraires, les compromissions du Conseil supérieur de la magistrature. Dans sa dimension constitutionnelle, cette question intéressait le Titre VIII de la Constitution (« De l’autorité judiciaire ») et spécialement les articles 64 et 65 dont la rédaction était la suivante en 1981 :
Article 64
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur comprend en outre neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions fixées par une loi organique.
Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d’appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par une loi organique sur les propositions du ministre de la justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les grâces dans les conditions fixées par une loi organique.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation.
Dans ses 110 propositions en vue de l’élection présidentielle en 1981, François Mitterrand écrivait seulement : « L’indépendance de la magistrature sera assurée par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ». Les critiques plus générales et substantielles de la gauche contre le statut formel de la magistrature et les pratiques prêtées aux gouvernements de droite n’ont cependant pas concrétisé une politique d’émancipation du pouvoir judiciaire après l’alternance de 1981, par crainte du « corporatisme judiciaire » et de la « politisation de la justice ». Cette double crainte est balisée par deux moments notables entre 1981 et 1993[10].
Le premier de ces moments fut l’installation le 25 janvier 1982 par le garde des Sceaux Robert Badinter d’une « commission de réforme du Conseil supérieur de la magistrature et du statut de la magistrature ». La réflexion de cette commission fut d’autant plus laborieuse qu’il lui fallait tenir compte des divergences profondes entre les organisations professionnelles des magistrats ainsi que des propositions réformistes formulées avant l’alternance par François Mitterrand et par le parti socialiste. Au demeurant, le Gouvernement avait cru devoir faire savoir que les conclusions de la commission « ne sauraient [l’]engager »[11]. Et, après que le rapport de la commission fut enfin remis en avril 1983 ‒ soit avec un an de retard sur l’agenda prévisionnel ‒ le Gouvernement conçut de consulter les magistrats sur ses propositions. Les divergences des magistrats sur la configuration idéale de leur corps furent suffisamment manifestes pour qu’il parût évident au Gouvernement qu’une réforme consensuelle était proprement inconcevable[12]. En plus de l’évidence que la révision constitutionnelle nécessitée par certaines demandes du corps judiciaire et par certaines propositions du parti socialiste avant l’alternance n’avait guère de chances, avec un Sénat à droite, de réunir 3/5e des suffrages exprimés dans un congrès du parlement à Versailles.
Le deuxième moment formel d’expression d’une crainte du « corporatisme judiciaire » et de la « politisation des juges » fut l’échec du réformisme judiciaire du ministre de la Justice Pierre Arpaillange (1988-1990), dans des conditions plus ou moins comparables à l’échec du réformisme judiciaire de Robert Badinter sous le premier septennat de François Mitterrand. L’ambition réformiste prêtée à Pierre Arpaillange à sa nomination comme garde des Sceaux du premier gouvernement de Michel Rocard devait en réalité davantage à sa qualité de magistrat et à sa réputation de juriste libéral qu’à l’existence d’une doctrine claire et précise du président de la République réélu, du nouveau premier ministre ou même du nouveau garde des Sceaux sur une éventuelle réforme judiciaire. Aussi Pierre Arpaillange conçut-il à son tour de faire « réfléchir » une commission sur la réforme souhaitable du Conseil supérieur de la magistrature et du statut de la magistrature (nominations, avancements, discipline). Cette réflexion fut confiée à la « commission permanente d’études » du ministère de la Justice. Celle-ci perdit en chemin son crédit en raison du départ de l’Union syndicale des magistrats, un départ justifié par l’absence de garanties expresses du chef de l’État en faveur de l’initiative constitutionnelle nécessaire à la réforme judiciaire souhaitée par l’organisation professionnelle.
C’est François Mitterrand lui-même qui finit par expliciter sa défiance à l’égard du « corporatisme » et de la « politisation » à l’occasion d’une allocution prononcée devant la Cour de cassation le 30 novembre 1990 dans le cadre des festivités marquant le bicentenaire de la Cour :
« On discute beaucoup du Conseil supérieur de la magistrature. J’ai moi-même, naguère, pris part à cette controverse, et l’on me renvoie de temps à autre ‒ c’est de bonne guerre ‒ à mon engagement de 1981, rédigé en ces termes : ‟l’indépendance de la magistrature sera assurée par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature”, formule brève et même, je l’admets, un peu courte, mais je n’ai rien à y redire. Faut-il recourir pour cela au grand appareil de la révision constitutionnelle ? Certains le souhaitent qui voudraient rompre tout lien avec le chef de l’État.
L’article 64 de la Constitution dit en effet : ‟Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire”. Et qu’il est ‟assisté par le Conseil supérieur de la magistrature”. Mais alors, je vous le demande, qui serait le garant de votre indépendance dans notre République ? Les organisations professionnelles et syndicales ? La corporation ? Sous le prétexte de protéger les magistrats contre les abus éventuels du pouvoir politique, toujours soumis au contrôle du Parlement et de l’opinion publique, on instaurerait l’emprise sur la magistrature des pouvoirs irresponsables… Plus sage, il me semble serait de modifier la loi organique du 22 décembre 1958 »[13].
Les préventions exprimées en 1990 par François Mitterrand sont en réalité déjà caractéristiques des programmes de la gauche dans les années 1970, au point que les visages du Conseil supérieur de la magistrature étaient remarquablement variables d’un programme à un autre et qu’un non-dit traverse cette production : l’adhésion de la gauche à la subordination des magistrats du parquet au pouvoir exécutif. Ce non-dit fut lui aussi explicité par François Mitterrand dans la même allocution du 30 novembre 1990 :
« Ceux qui, hors de la magistrature, par ignorance ou par sectarisme, contestent par exemple le rôle du parquet devraient apprendre ou réapprendre que selon notre tradition très ancienne d’avant la Révolution française, c’est le pouvoir exécutif chargé de l’ordre public qui a, naturellement, la responsabilité des poursuites et que cette tradition existe dans bien d’autres démocraties et ce, dans le cadre de dispositions qui chez nous, laissent au parquet une grande marge d’appréciation. Nous ne reviendrons pas là-dessus ».
De fait, ni la loi organique du 25 février 1992 modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ni la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVIII (réforme du Conseil supérieur de la magistrature) ne mirent en cause la subordination des magistrats du parquet au pouvoir exécutif. Cette question ne devient un aspect du réformisme judiciaire de la gauche qu’au tournant des années 2000, à la faveur de pressions politiques (une demande pressante d’organisations professionnelles des magistrats et de la presse) et de facteurs juridiques (l’évidence de la nécessité d’une révision constitutionnelle pour ce faire[14], les arrêts Medvedyev et autres c. France (29 mars 2010) et Moulin c. France (23 novembre 2010) de la Cour européenne des droits de l’Homme concluant que le parquet français ne saurait être analysé comme étant une « autorité judiciaire » au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme).
La question du pouvoir policier et de sa libéralisation fut particulièrement importante dans le débat public français des années 1960-1970.
Cette importance devait, concurremment, à des considérations factuelles et à des considérations idéologiques. Au nombre des considérations factuelles, l’on peut ranger : ‒ la guerre d’Algérie et la critique des « crimes d’état » commis dans ce contexte ; ‒ l’effervescence politique portée dans les années 1960 et 1970 par des radicalismes de droite et de gauche et dont la loi « anti-casseurs »[15] fut l’une des réponses formelles des pouvoirs publics ; ‒ la confrontation entre le thème de la « sécurité » porté par la droite et celui du « sentiment d’insécurité » porté par la gauche[16] et la résonance de cette opposition en matière de politique pénale, de contrôles d’identité de police administrative, d’éloignement des étrangers du territoire. Deux considérations « idéologiques » justifiaient par ailleurs l’importance à gauche de cette question. Il s’agit, d’une part, de la critique marxiste des institutions policières[17] dont certains à gauche se revendiquaient et, d’autre part, du soupçon à gauche d’un « noyautage fasciste » des institutions policières.
Entre 1981 et 1995, la question du pouvoir policier et de sa libéralisation n’est plus seulement un marqueur entre droite et gauche, elle devient un objet de dissensus au sein même de la gauche, voire au sein même du parti socialiste. Ce dissensus interne au parti socialiste aura eu plusieurs moments de référence, à commencer par l’enterrement du rapport Belorgey sur la réforme de la police (1982-1983)[18]. En substance, ce sont trois enjeux que recouvre la question du pouvoir policier et de sa libéralisation : la définition du périmètre policier légitime, la limitation des prérogatives policières, le refus de l’autonomie policière.
L’on peut filer la politique législative (ou l’absence de politique législative) de François Mitterrand sur l’enjeu du périmètre policier en envisageant la question de la mission policière de conservation des biens et des personnes et la question des « polices parallèles ».
Conservation des biens et des personnes. Formellement, les activités policières de conservation des biens et des personnes sont une composante des objectifs de valeur constitutionnelle de « sauvegarde de l’ordre public » et de « recherche des auteurs des infractions ». Ces activités sont néanmoins balisées par différents droits et libertés garantis aussi bien au plan constitutionnel que par des instruments internationaux ou européens : l’interdiction des accusations, des arrestations et détentions arbitraires, la légalité des délits et des peines, la stricte et évidente nécessité des peines, la non-rétroactivité de la loi pénale et la présomption d’innocence.
La politique législative de François Mitterrand dans cette matière était supposée se traduire par une modernisation et une libéralisation substantielle du droit pénal. Cette ambition ne fut menée à son terme qu’après une longue et laborieuse maturation politique et parlementaire. La primo-initiative du nouveau Code pénal de 1992[19] et la philosophie durable de cette réforme ont été définis en réalité par Robert Badinter avec le projet de loi portant réforme du Code pénal déposé au Parlement en 1986. L’exposé des motifs du texte préparé par Robert Badinter confirmait la nécessité d’une nouvelle législation pénale[20] à travers sa description des défauts du Code pénal alors en vigueur :
« *Archaïque par les survivances qu’il comporte. Ainsi le vagabondage et la mendicité constituent-ils encore dans notre code pénal des infractions punies de peines sévères d’emprisonnement. Et le prêtre qui célèbre des mariages religieux sans mariage civil préalable encourt vingt ans de détention criminelle!
* Inadapté aux exigences de notre société. Ainsi les agents économiques essentiels, les sociétés, échappent-elles à toute sanction pénale pour les infractions qu’elles commettent notamment dans le domaine industriel ou en matière de législation du travail.
* Contradictoire si l’on compare certaines dispositions. Dans la hiérarchie des peines du code pénal, les infractions les plus graves sont des crimes punis de réclusion, les moins graves des délits punis d’emprisonnement. Or, aujourd’hui, le trafic de stupéfiants est un délit passible d’une peine de vingt années d’emprisonnement. En revanche, l’abus de confiance commis par un notaire est un crime passible de dix années de réclusion. À la faveur des modifications législatives successives, la hiérarchie pénale a perdu sa cohérence.
* Incomplet, car une grande partie des textes de droit pénal ne figure plus dans le code pénal, mais dans des lois spéciales multiples, difficiles parfois à connaître, ce qui nuit à l’harmonie et à la clarté juridique du droit pénal »[21].
Pour autant, ni le projet Badinter, ni le Code pénal de 1992, ne furent univoquement libéraux car si ces textes participaient de la philosophie pénale ayant fécondé au fil du temps une individualisation et une humanisation des peines, ils ne s’appropriaient pas moins la tendance moderne et contemporaine à la « prolifération des incriminations » à la faveur de nouvelles sensibilités sociales (sécurité, environnement, santé) ou de nouveaux objets sociaux (sport, nouvelles technologies, etc.).
Les « polices parallèles ». La mise en cause de ce qu’il appelle lui-même les « polices parallèles » a été récurrente dans la réflexion politique de François Mitterrand avant son arrivée au pouvoir.
Cette condamnation pouvait désigner, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les « polices privées » qui commencent alors de prospérer. L’encadrement des activités privées de sécurité par la loi du 12 juillet 1983 se fait alors très loin des débats des années 2000 sur la question de savoir si ces activités constituent ou non une « privatisation d’une fonction régalienne de l’état »[22].
La condamnation des « polices parallèles » était spécialement dirigée contre des pratiques d’institutions policières ayant une existence légale[23]. Les « services secrets » français ‒ le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE)[24] ‒ furent ainsi analysés comme une « police parallèle », notamment pour avoir enlevé en février 1963 à Munich et livré à la police française d’une manière peu orthodoxe l’un des responsables de l’OAS, le colonel Antoine Argoud[25], et pour n’avoir pas empêché les services secrets marocains d’enlever à Paris l’opposant Mehdi Ben Barka[26]. Quant aux Renseignements généraux ‒ une administration policière dont les prémisses remontent au XIXe siècle[27] ‒, ils ne furent pas moins qualifiés de « police parallèle », au point que leur « suppression » comptait au nombre des engagements du parti socialiste avant l’alternance.
Après l’alternance, seul le contre-espionnage français fut « réformé » avec la création en lieu et place du SDECE d’une Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) dont la définition des missions n’était pas moins générale et imprécise que celle des missions de la précédente structure. Le décret du 2 avril 1982 portant création et fixant les attributions de la Direction générale de la sécurité extérieure voulait en effet que cette direction « placée sous l’autorité d’un directeur général relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres » ait pour mission « au profit du Gouvernement [sic] et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés », de « rechercher et d’exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d’entraver, hors du territoire national, les activités d’espionnage dirigées contre les intérêts français afin d’en prévenir les conséquences ». L’affaire du Rainbow Warrior (10 juillet 1985) avait tôt fait de montrer que le décret du 2 avril 1982 en lui-même n’avait pas changé le périmètre ou les méthodes du contre-espionnage français.
À l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir, la Direction centrale des renseignements généraux de la Direction générale de la police nationale et les renseignements généraux de la préfecture de Police (Paris) étaient formellement chargés d’une mission d’« information politique, sociale et économique » et d’une mission de surveillance des courses et des jeux. Les mises en cause de cette structure du ministère de l’Intérieur n’ont cependant jamais porté que sur sa mission d’« information générale » du Gouvernement. Ces critiques puisaient à deux considérations : d’une part, la surveillance et/ou l’« infiltration » par les Renseignements généraux des organisations politiques « républicaines » ‒ et non pas des seules organisations « extrémistes » ou « radicales » ‒ ou d’acteurs politiques plus ou moins connus, était analysée comme une « atteinte du pouvoir » à la liberté des partis politiques[28] ; d’autre part, les « remontées » vers le pouvoir politique parisien, via les préfets, de l’« information générale » recueillie localement par les Renseignements généraux, étaient perçues comme un avantage pour les élus politiques de la majorité dans la compétition électorale, puisque, par hypothèse, le Gouvernement pouvait ajuster sa politique aux attentes locales spécifiques saisies par les Renseignements généraux.
La suppression des Renseignements généraux ne fut cependant pas même envisagée sous la présidence de François Mitterrand[29]. Et il a fallu deux « affaires » ‒ l’affaire du pasteur Doucé (1990) et l’affaire de l’« espionnage » du Conseil national du parti socialiste par les Renseignements généraux (1994)[30] ‒ pour voir des textes successifs essayer de « moraliser » les activités de cette dépendance du ministère de l’Intérieur, en donnant une base textuelle à certains fichiers automatisés des Renseignements généraux qui contenaient des informations interdites à la collecte par la loi Informatique et libertés de 1978 (1990-1991), en la dispensant du suivi des partis politiques « républicains » et en l’engageant à un plus important investissement sur des formes de contestation sociale susceptibles d’avoir des conséquences en matière d’ordre public, sur les violences urbaines, sur la criminalité économique, sur les « sectes », sur les « groupements ésotériques ».
L’ambition d’une limitation des prérogatives policières et d’un contrôle effectif des activités policières a été revendiquée par François Mitterrand, et plus généralement par la gauche, à la faveur d’un certain nombre de débats et textes législatifs antérieurs à l’alternance. Ces débats et ces textes se rapportaient pour certains d’entre eux à certaines mesures policières restrictives de liberté (le contrôle et la régulation des circulations des marchandises et des personnes, les écoutes téléphoniques) et pour certains autres à certaines mesures privatives de liberté et à la nécessité d’un « habeas corpus à la française » (la garde à vue, la détention provisoire[31]).
Contrôle et régulation des circulations des marchandises et des personnes. Cet aspect du pouvoir policier fut caractérisé par un renoncement marquant : la non-abrogation du décret du 1er février 1792 sur les passeports, soit le texte (législatif) qui fonde depuis très longtemps les immixtions de l’administration dans la liberté de circulation des citoyens en dehors de la France[32].
Les contrôles d’identité de police administrative furent l’objet d’un conflit mémorable entre le garde des sceaux Robert Badinter et le ministre de l’Intérieur Gaston Defferre dans le contexte du débat politique et parlementaire relatif à l’abrogation (totale ou partielle) de la loi « sécurité et liberté »[33]. L’abrogation partielle de ce texte par la loi du 10 juin 1983 laissa donc exister ‒ certes au prix de « précisions » législatives successives et de « cadrages » de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel » dirigés contre les contrôles arbitraires ou discriminatoires ‒ des contrôles d’identité de police administrative.
La police de la circulation des étrangers non-européens connut pour sa part un double statu quo. En premier lieu, la présidence de François Mitterrand ne remit pas en cause le principe de la souveraineté de l’état pour définir les conditions de l’admission ou de l’éloignement des étrangers. Pour ainsi dire, un droit de migrer ne fut pas consacré. En deuxième lieu, si François Mitterrand et les gouvernements de gauche des années 1981-1986 refusaient, s’agissant des étrangers, la superposition du contrôle d’identité et du contrôle de la régularité du séjour, ils ne revinrent pas en 1988 sur cette superposition qui avait entre-temps été introduite dans le droit par le gouvernement et la majorité de cohabitation (1986-1988).
Écoutes téléphoniques. S’il est vrai que les écoutes téléphoniques[34] firent l’objet d’un texte ‒ la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ‒, il n’est pas moins vrai que la genèse de ce texte ne témoigne pas d’un très grand libéralisme puisque cette loi intervient dix ans après l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir et neuf ans après le rapport sur les écoutes téléphoniques élaboré par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation, Robert Schmelck (1982)[35]. D’autre part, la loi de 1991 fut en réalité la « réception » formelle de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme pour défaut de « base légale » des écoutes téléphoniques administratives ou judiciaires (Kruslin et Huvig c. France, 24 avril 1990) : elle fut donc le produit d’une contrainte extérieure. Surtout, la loi du 10 juillet 1991 ne saurait être considérée comme une amnistie symbolique des écoutes téléphoniques illégales pratiquées tous azimuts entre 1982 et 1986 par la « cellule anti-terroriste de l’Elysée » contre des personnalités du monde de la presse, du monde du spectacle, de la politique, voire des avocats. Aussi bien le tribunal correctionnel (2005) que la Cour d’appel de Paris (2007), à l’appui de leur condamnation des acteurs principaux de ces écoutes, établirent que ces écoutes ne pouvaient pas se réclamer de la protection des intérêts fondamentaux de la nation ou de l’état, puisqu’elles participaient d’une volonté de protéger le chef de l’état de révélations sur sa vie personnelle (l’existence d’une fille naturelle).
L’habeas corpus « à la française ». La référence à un habeas corpus à la française, y compris dans sa profonde ambiguïté, n’est pas plus spécifique à la gauche que circonscrite aux années 1970[36]. Or c’est plutôt la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (« Loi Guigou ») ‒ son champ était infiniment plus large que les mesures privatives de liberté avant le jugement pénal ‒ que tout autre texte daté de la double présidence de François Mitterrand[37] qui a aura constitué le texte de référence du libéralisme en la matière de la gauche au pouvoir. À cette précision près que ce libéralisme fut lui aussi mis en œuvre sous une forte contrainte extérieure, celle d’une Cour européenne des droits de l’Homme qui, par exemple, dans un remarqué arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992 (donc en pleine présidence de François Mitterrand), a condamné la France pour la violation par une garde à vue des articles 5 § 3, 3 (traitements inhumains et dégradants) et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme[38].
Refus et acceptation de l’autonomie policière
La question de la soumission de la police au droit va se présenter dans les années 1980-1990 sous l’angle d’une définition, en assortiment de la loi, de principes déontologiques ou éthiques exigibles des forces publiques de sécurité. Cette question, qui est déjà envisagée en 1982 par le Rapport Belorgey, commence de se poser seulement à la toute fin des années 1970, à travers notamment la Déclaration sur la police adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 1979. La loi du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale a accédé facilement à cette préoccupation en enjoignant au Gouvernement d’édicter « avant le 31 décembre 1985, par décret en Conseil d’État, un code de déontologie de la police nationale » (art. 4). Cette demande fut satisfaite par le décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale. Toutefois, si ce code n’a pas été remis en question par les gouvernements et les majorités ultérieurs, tel ne fut en revanche pas le cas de l’« autorité administrative indépendante » préposée au contrôle externe de la police nationale[39] : le Conseil supérieur de l’activité de la police créé par la gauche … seulement en 1993 (décret du 16 février 1993) est immédiatement supprimé par le Gouvernement d’édouard Balladur (décret du 7 mai 1993) puis remplacé par un Haut conseil de déontologie de la police nationale (décret du 9 septembre 1993)[40].
« Érigé en tuteur de la société, l’état a toujours prétendu jouer [en France] le rôle d’intercesseur, de médiateur, mais aussi de superviseur de toute communication sociale, au nom des intérêts généraux de la collectivité : c’est par lui qu’il revient de faire circuler l’information à travers la société »[41]. Cette caractéristique fondamentale de la culture politique française, qui voudrait voir l’État avoir la maîtrise de toutes les institutions sociales investies dans ce que François Dubet appelle « le travail sur autrui » (l’école, la justice, les médias), est clairement vérifiable dans la « libéralisation des ondes » en France, dans la « querelle scolaire » de 1984 et dans la production normative relative aux polices des discours et des images datée des années 1981-1995.
Deux lois sur la presse ont ponctué la première présidence de François Mitterrand : celle du 23 octobre 1984 relative aux entreprises de presse et celle du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. Le premier de ces textes fut l’œuvre de la majorité socialiste et du Gouvernement de Pierre Mauroy, le second ‒ qui a abrogé celui de 1984 ‒ fut l’œuvre d’une majorité de « cohabitation » de droite et du Gouvernement de Jacques Chirac mais n’a pas été abrogé par la gauche sous la deuxième présidence de François Mitterrand, ni d’ailleurs plus tard. Et chacun de ces deux textes a eu pour objet de définir des règles relatives à la transparence de la propriété des publications de presse, ainsi que des règles limitatives des concentrations des entreprises de presse.
Il a été dit à l’époque que le premier de ces textes était une « loi anti-Hersant » lorsque le second était une « loi Hersant », parce que Robert Hersant ‒ le propriétaire du groupe de presse (le Groupe Hersant) le plus concerné par ces textes en raison de ses acquisitions successives de journaux et de sa position dominante ‒ était de droite, et que le vaisseau amiral du groupe (Le Figaro) était lui aussi d’une sensibilité de droite. Il ne reste pas moins que les philosophies des deux textes furent diamétralement opposées, et qu’en particulier, le « refus des puissances d’argent » qui a inspiré la loi de 1984 ‒ dans un emprunt idéologique explicite aux rédacteurs des ordonnances sur la presse de la Libération (celles des 22 et 26 août 1944) ‒ a été déterminé par le postulat d’une opposition par nature entre le pluralisme et les concentrations en matière de presse. Le parti socialiste avait pourtant été avisé des limites de ce postulat, voire de sa contre-productivité au regard de l’objectif même de pluralisme de la presse, par un rapport rédigé pour le Conseil économique et social en 1979 par le professeur Georges Vedel[42]. Le rapport Vedel expliquait ainsi que le pluralisme « n’est pas l’envers de la concentration » puisque si « toute suppression d’un titre, pure et simple ou par absorption, est à la fois concentration et régression du pluralisme », l’on ne pouvait cependant pas dire que « le maintien, voire la création d’un titre [a] la signification inverse », cette création pouvant correspondre à une « occupation de terrain » tout sauf intéressée par le pluralisme.
Le programme législatif de François Mitterrand en matière de communication audiovisuelle ne fut pas moins contrarié par ce fonds commun de culture politique partagé par la droite et par la gauche (sauf peut-être dans la période 1986-1988) qui fait que ce sont principalement des préventions qui substantialisent la législation applicable en France à la radio et à la télévision : préventions à l’égard des « puissances d’argent » ; crainte du pouvoir réel ou supposé de la radio et de la télévision et de ses effets pathologiques (réels ou supposés) ; crainte de l’abêtissement des individus par les divertissements audiovisuels[43].
Ces craintes retentirent sur la politique législative de François Mitterrand de différentes manières, loin de la mythologie sur « la libéralisation des ondes » par la gauche. Ainsi, la loi du 9 novembre 1981 « portant dérogation au monopole de l’État », comme son nom l’indique d’ailleurs, n’est pas une loi créant le pluralisme externe en matière de communication audiovisuelle en France, mais une loi qui se propose de pérenniser le monopole public en matière de radio et de télévision, la brèche ouverte dans ce monopole étant simplement en faveur des radios associatives (nouvelle expression d’un refus des « puissances d’argent »). La loi de 1981 ne « tint » pas un an puisque la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, en se substituant à elle, a élargi les possibilités de création et d’émission de « radios libres », dans un contexte (non pris en compte en 1981) où leur installation locale était facilitée par l’abaissement du coût des équipements, où les réseaux (câble, satellites, télématique) et les supports (magnétoscopes, vidéodisques) de communication se développaient, où la mondialisation de la communication prenait son essor avec le développement des satellites de diffusion directe. Les craintes de la gauche en 1981-1982 ne furent d’ailleurs pas levées par la loi Léotard de 1986 mais plutôt relativisées à la lumière des transformations techniques et économiques du secteur audiovisuel : en 1982 comme en 1986, le législateur conçoit donc à la fois des règles garantissant l’équité concurrentielle entre les opérateurs[44], des règles garantissant une police des discours et des images, des obligations positives à caractère culturel pour les opérateurs (quotas de production, quotas de diffusion, qualité des programmes)[45]. Il reste que, dès la loi du 29 juillet 1982, la conception française de la liberté de la communication audiovisuelle est fixée autour de trois principes : la différenciation statutaire de la communication audiovisuelle au sein de la liberté de la communication ; la différenciation statutaire de l’« information » au sein de la « communication » ; l’existence d’une autorité indépendante chargée de garantir le système.
La naissance du pluralisme externe en matière de communication audiovisuelle ne s’est pas caractérisée seulement par une succession de lois séparées les unes les autres de deux ans à peine, voire d’un an (1982, 1984, 1985, 1986, 1989), mais également par l’importance des ingérences formelles[46] ou informelles[47] du pouvoir politique dans l’organisation de ce pluralisme externe, à l’abri d’« autorités administratives indépendantes » pourtant vouées à la « garantie » de la liberté de la communication et à la « régulation » de l’audiovisuel[48].
Le projet de loi « relatif aux rapports entre l’État, les communes, les départements, les régions et les établissements d’enseignement privés » (« projet de loi Savary »[49]) retiré en 1984 à la suite d’importantes manifestations de défense de l’« école libre »[50] n’a finalement été qu’une caisse de résonance de l’ambiguïté initiale des 110 propositions pour la France de François Mitterrand[51] :
« Un grand service public, unifié et laïque de l’éducation nationale sera constitué. Sa mise en place sera négociée sans spoliation ni monopole. Les contrats d’association d’établissements privés, conclus par les municipalités, seront respectés. Des conseils de gestion démocratiques seront créés aux différents niveaux »[52].
L’historiographie de François Mitterrand et de la gauche plus généralement convient de ce que cette proposition, et avec elle la révision de la loi Debré modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’état et les établissements d’enseignement privés, ne comptait pas au nombre des éléments de la doxa du parti socialiste auxquels François Mitterrand pouvait s’identifier personnellement : la Convention des institutions républicaines qu’il présidait alors au moment du Congrès d’Épinay d’« unification des différentes familles socialistes » (1971) ne revendiquait pas la création d’un SPULEN[53], à la différence d’autres « familles socialistes » comme le Centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste (CERES) de Jean-Pierre Chevènement. François Mitterrand s’est donc plutôt rallié à l’idée du SPULEN, pour des raisons qui, pour certains de ses biographes, devaient à la nécessité d’un accord politique avec Jean-Pierre Chevènement ‒ figure de proue de l’une des six motions défendues au Congrès d’Épinay ‒ en vue de la création à la fois d’une alliance majoritaire dans le nouveau parti socialiste et de la désignation de François Mitterrand comme « Premier secrétaire » de la nouvelle formation politique.
Formellement, le projet Savary se proposait de revenir sur la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’état et les établissements d’enseignement privés (« loi Debré ») à travers quatre groupes de règles : des conditions de fond et de procédure (pour le moins complexes) d’admissibilité d’établissements d’enseignement privés à un contrat d’association avec l’état ; des règles redéfinissant les modalités du financement public des écoles privées sous contrat d’une manière supposée garantir que les établissements publics ne soient pas « lésés » (celles des communes intéressées à ne pas financer des établissements privés auraient bénéficié d’une dispense légale à cette fin) ; des règles relatives au rattachement des établissements privés sous contrat à une nouvelle personne morale de droit public (un « établissement d’intérêt public ») chargée de la concertation entre les différents acteurs du nouveau système relationnel entre personnes publiques et établissements privés sous contrat, de la collecte et de l’affectation des ressources destinées aux établissement d’enseignement privés ; des règles nouvelles sur le statut des personnels des établissements privés sous contrat.
L’échec du projet Savary en 1984 est remarquable à différents égards. D’abord en raison des circonstances politiques extrêmement laborieuses de la préparation même du texte, entre les pressions de certains milieux « laïques » (la Ligue de l’enseignement ou la Fédération de l’éducation nationale) qui redoutaient un renoncement de la nouvelle majorité et la résistance des milieux catholiques à la perspective (réelle ou imaginée) d’une disparition des subventions publiques aux écoles privées et/ou d’une intégration des maîtres de l’enseignement privé dans le secteur public[54]. D’autre part, la discussion parlementaire du projet de loi a mis en évidence différentes lignes de partage au sein même de la gauche : lorsque les communistes revendiquaient clairement leur double refus de tout financement des collectivités territoriales pour les écoles privées et de la titularisation des maîtres de l’enseignement privé telle que prévue par le texte, les socialistes pour leur part se déployaient sur un large spectre allant de l’adhésion au projet de loi jusqu’à la préférence pour un statu quo[55]. En troisième lieu, les circonstances politiques de l’échec en lui-même ont ceci de particulier que c’est l’opinion publique, à travers d’imposantes manifestations tout au long du premier semestre 1984 (Lyon, Versailles) ‒ jusqu’à celle qui réunit environ 1.300.000 personnes à Paris le 24 juin 1984 ‒ qui fit « plier le pouvoir », et qu’elle le fit sur un thème jusqu’alors très identifié à la gauche : la « défense des libertés ».
Cet opprobre ‒ l’idée d’une gauche « liberticide » ‒ fut perçu comme tel par François Mitterrand pour que sa « réplique » ait consisté en un « référendum sur le référendum » : puisque l’opposition appelait à un référendum sur le projet de loi Savary, François Mitterrand, sur le conseil de Michel Charasse (de l’avis général), crut devoir faire remarquer que ce référendum n’était possible qu’à la condition d’une révision préalable de l’article 11 de la Constitution qui incorpore les « libertés publiques » dans le champ d’application du référendum législatif. D’où le dépôt d’un projet de loi constitutionnelle « portant révision de l’article 11 de la Constitution pour permettre aux Français de se prononcer par référendum sur les garanties fondamentales en matière de libertés publiques ». Un texte dont l’exposé des motifs ne disait cependant rien du caractère circonstanciel et instrumental [56]. De manière comparablement circonstancielle et instrumentale, le Sénat, majoritairement à droite, aura revendiqué une dignité de « gardien des libertés » pour faire échec à la révision constitutionnelle envisagée par François Mitterrand.
Il reste que, sur le fond, le projet Savary se prêtait à une authentique discussion sur sa compatibilité ou son incompatibilité avec la liberté de l’enseignement, une discussion que son retrait a dispensé le Conseil constitutionnel de trancher. Les partisans du texte faisaient valoir que la liberté de l’enseignement n’était pas mise en cause dès lors que les établissements d’enseignement privés n’étaient pas empêchés d’exister. Les adversaires du texte soutenaient pour leur part que cette liberté était mise en cause à travers les nombreuses sujétions attachées au contrat d’association ‒ ces sujétions étant réputées annihiler la « liberté pédagogique » des établissements sous contrat et par voie de conséquence la « liberté de choix » des parents ‒ et par l’absence de garanties du « caractère propre » de ceux des établissements d’enseignement privés ayant un caractère confessionnel[57] qui auraient passé un contrat d’association avec l’état, soit une atteinte à la « liberté de conscience des maîtres et des enfants »[58].
Si le Conseil constitutionnel a par la suite fait siens les arguments promus par l’opposition en 1984, ce n’est cependant pas toujours avec la portée normative que la droite en espérait. Ainsi, lorsque le Conseil constitutionnel fut saisi de la « loi d’apaisement » voulue par le Gouvernement de Laurent Fabius ‒ la loi du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’État et les collectivités territoriales (« loi Chevènement ») ‒ il ne vit pas de violation de la « liberté de choix » des parents ‒ l’expression n’est pas utilisée par le Conseil ‒ dans le fait pour le législateur de subordonner l’aide financière de l’État aux établissements d’enseignement privés à la condition que les maîtres soient nommés par accord entre l’État et la direction de l’établissement privé[59]. D’autre part, après avoir posé que la reconnaissance du caractère propre des établissements d’enseignement privés « n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté d’enseignement, qui a valeur constitutionnelle », le Conseil constitutionnel crut devoir ajouter que l’obligation faite aux maîtres de respecter le caractère propre de leur établissement « ne peut être interprétée comme permettant qu’il soit porté atteinte à la liberté de conscience des maîtres, qui a valeur constitutionnelle » mais leur « impose » néanmoins « d’observer dans leur enseignement un devoir de réserve »[60]. Enfin, lorsque la droite conçut en 1993 de réviser la loi Falloux, le Conseil constitutionnel lui objecta que les aides des collectivités territoriales aux établissements d’enseignement privés devaient, par ailleurs, veiller au respect du principe d’égalité entre les établissements d’enseignement privés sous contrat se trouvant dans des situations comparables et « éviter que des établissements d’enseignement privés puissent se trouver placés dans une situation plus favorable que celle des établissements d’enseignement publics, compte tenu des charges et des obligations de ces derniers »[61].
Pour avoir été des « marqueurs » de la gauche dans les années 1960 et 1970, les manifestations, les pétitions, les tribunes contre la « censure » n’ont en réalité jamais suggéré que la gauche au pouvoir substituerait à la conception traditionnellement élitaire de la liberté d’expression en France[62] une conception plus libérale[63], quand bien même cette nouvelle conception n’irait pas jusqu’à une imitation de la conception américaine. Comme la critique de la « censure » ne définit pas une conception particulière de la liberté d’expression, deux polices des discours et des images datées de la période 1981-1995 se sont à leur tour prêtées à cette critique : d’une part l’interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac par la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (« Loi évin ») ; d’autre part, l’incrimination pénale du négationnisme par la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (« loi Gayssot »)[64]. Surtout, il faut comprendre ainsi pourquoi aucune des quatre polices administratives ou pénales des discours et des images qui se sont prêtées avant 1981 à d’importantes contestations, spécialement lorsque le Gouvernement estimait devoir les exercer ‒ la police des publications « dangereuses pour la jeunesse », la « censure cinématographique », la police des publications, le délit d’offense au chef de l’état ‒ ne fut supprimée pendant les quatorze années de présidence de François Mitterrand.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse habilite le ministre de l’Intérieur à interdire : ‒ de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ; ‒ d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ; ‒ d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées[65]. L’existence de cette police n’a cependant pas été remise en cause par la gauche au pouvoir. Et c’est même plutôt de manière consensuelle que son champ d’application a été élargi aux publications faisant de la place à la discrimination ou à la haine raciale. Toutefois, l’application de l’article 14 de la loi de 1949 fut relativement moins contestée dans les années 1980-1990[66] qu’elle ne le fut dans les années 1960-1970[67] et de nombreuses interdictions prononcées avant l’arrivée de la gauche au pouvoir furent levées au profit notamment d’Histoire d’O de Pauline Réage, d’Emmanuelle prêtée à Emmanuelle Arsan, des œuvres de Sade, d’Henry Miller, etc[68].
Depuis sa codification en 1956 par le Code de l’industrie cinématographique (art. 19 à 22) et sa modification par la loi du 30 décembre 1975 (loi de finances pour 1976, art. 11 et 12), la police administrative spéciale du cinéma (le « visa d’exploitation ») ne fut pas moins contestée dans son principe autant que dans ses applications avant 1981. Ce n’est cependant qu’à la faveur de polémiques déclenchées par certains avis de la Commission de classification que le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, Jack Lang, conçut de redéfinir les règles de la classification cinématographique en faisant prendre le décret du 23 février 1990. Les avis de la Commission et les décisions du ministre chargé de la culture consistaient désormais en : ‒ un visa autorisant pour tous publics la représentation de l’œuvre cinématographique ; ‒ un visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; ‒ un visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; ‒ une interdiction totale de l’œuvre cinématographique[69]. Le décret Lang n’empêcha d’ailleurs pas de nouvelles polémiques à la suite des avis de la Commission de classification et/ou de décisions du ministre chargé de la culture. Au point qu’un nouveau décret fut pris en 2001 par un gouvernement de gauche mais sous la présidence de Jacques Chirac[70]. Ce texte n’a d’ailleurs pas spécialement créé de nouveaux niveaux de classification mais plutôt exigé une majorité des deux tiers des membres présents de la Commission pour un avis favorable à un visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans, à une inscription de l’œuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 entraînant l’interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans, ou à une interdiction totale de l’œuvre cinématographique.
La troisième police des discours ou des images contestée avant 1981, dans son principe comme dans ses applications, était celle des publications étrangères telle qu’elle ressortait alors, depuis un décret-loi du 6 mai 1939, de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En vertu de ce texte, le ministre de l’Intérieur avait le pouvoir d’interdire « la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère ». Au surplus, le ministre de l’Intérieur pouvait prononcer cette interdiction à l’encontre des « journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l’étranger ou en France ». La violation de l’interdiction administrative était sanctionnée pénalement mais aussi par des saisies administratives des exemplaires et des reproductions de journaux et écrits interdits ainsi que de « ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent »[71]. La non-abrogation par les majorités successives de la police des publications étrangères reçut durablement le soutien du Conseil d’Etat qui, encore dans son arrêt Association Ekin du 9 juillet 1997, faisait valoir que le pouvoir exercé par le ministre de l’Intérieur en vertu de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 n’était pas incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, alors même que ce pouvoir ne s’appliquait qu’aux seules publications étrangères. La Cour européenne des droits de l’Homme infirma l’analyse du Conseil d’État en faisant valoir en particulier que « si la situation très particulière régnant en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, pouvait justifier un contrôle renforcé des publications étrangères, il apparaît difficilement soutenable qu’un tel régime discriminatoire à l’encontre de ce type de publications soit toujours en vigueur »[72]. L’abrogation pure et simple de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 attendra le décret du 4 octobre 2004, que le Gouvernement de l’époque ne prit qu’après que le Conseil d’état lui avait adressé une injonction dans ce sens[73].
Le délit d’offense au chef de l’Etat de l’ancien article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse occupe à lui seul un chapitre entier du Coup d’État permanent de François Mitterrand (1964), avec des lignes introductives dans un style inimitablement « mitterrandien » :
« L’Histoire retiendra peut-être le nom de ceux qui ont, un moment, menacé le consulat du général de Gaulle en retournant contre lui les armes dont, sous sa haute autorité et pour son plus grand profit, ils s’étaient précédemment et victorieusement servis pour abattre la IVe République : le putsch et le complot. Mais elle commettrait une injustice si aux noms de Challe et de Salan, de Jouhaud et d’Argoud, de Bidault et de Soustelle elle n’ajoutait pas celui de Vicari. Vicari ? Pourquoi Vicari ? Qui est Vicari ? Questions légitimes puisque nos gazettes ont négligé de l’apprendre aux Français. Et il est vrai que si le garde des Sceaux à qui rien n’échappe dans son zèle inquisitorial n’avait pas extrait le sieur Vicari de la masse obscure des citoyens qui vont et qui viennent, qui parient au tiercé, qui, à la télévision, ne ratent pas une arrivée d’étape du Tour de France, qui baguenaudent au passage du spectacle ambulant et quasi permanent qu’offre gratis le chef de l’état à nos chères provinces, l’oubli aurait définitivement enseveli et la mémoire du personnage dont je répète, pour qu’on le sache bien, qu’il s’appelle Vicari et le souvenir de l’acte dont Vicari fut l’auteur »[74].
Vicari avait en effet été condamné à 1000 francs d’amende pour offense à chef de l’État et port d’arme prohibé, l’offense ayant consisté à « crier ‟hou hou” et (à) siffler lors du passage de la voiture présidentielle qui conduisait le chef de l’état à l’Arc de Triomphe, pour la cérémonie du 11 novembre 1962 »[75]. Le même événement valut à un autre prévenu, du nom de Castaing, d’être condamné par la même juridiction à 500 francs d’amende pour avoir « crié ‟à la retraite !” alors que la voiture du chef de l’état passait devant lui, avenue des Champs-Elysées ». L’histoire politique et judiciaire de l’ancien article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a été suffisamment rapportée[76] pour qu’il suffise de dire que si des poursuites pénales sur ce chef ne furent pas engagées sous François Mitterrand, l’abrogation formelle du texte ne fut pas non plus proposée par l’un de ses gouvernements, de droite ou de gauche[77].
*
La première production dogmatique du parti socialiste après la fin du deuxième septennat de François Mitterrand intervient très peu de temps après l’élection de Jacques Chirac à la présidence de la République avec le « Texte d’orientation » présenté à la Convention nationale de la Villette des 29-30 juin 1996[78]. Ce document peut être lu de deux manières. L’on peut y voir un bilan critique des inactions en matière de libertés entre 1981 et 1995 ou un recyclage de figures devenues rituelles dans le discours des libertés de la gauche depuis la fin des années 1960. Il y est en effet question d’élaborer une « Charte des droits et des libertés », d’abroger l’article 16 de la Constitution, de remplacer le Médiateur de la République par un « défenseur des droits du peuple » (sic), de réformer le Conseil supérieur de la magistrature, de conjurer l’influence des « intérêts privés » sur les médias. L’on était donc toujours dans une sorte de libéralisme parlementaire, un libéralisme dans lequel les libertés sont « octroyées ». Un peu comme si le parti socialiste ne s’était pas avisé de ce que les demandes de droits et de libertés émanaient d’individus (et non du « peuple »), que ces droits et libertés avaient nécessairement aussi une « dimension horizontale », que les demandes de droits et de libertés étaient plus communément adressées aux juges, sous le magistère notamment de la Cour européenne des droits de l’Homme. Pour ainsi dire, en 1996 encore, le parti socialiste ne s’est toujours pas projeté dans le libéralisme des juges. On le voit très clairement dans le fait que son « Texte d’orientation » de 1996 ne milite pas spécialement en faveur de l’introduction en France d’une « exception d’inconstitutionnalité » (soit un équivalent de la future « question prioritaire de constitutionnalité ») alors que cette procédure avait fait l’objet en vain de deux initiatives constitutionnelles sous le second septennat de François Mitterrand[79]. Même si le document de 1996 comptait un élément de rupture en étant le premier texte du parti socialiste, sinon l’un des tout premiers, à promouvoir la suppression du lien de subordination des magistrats du parquet au pouvoir exécutif, c’était néanmoins sans considération de différentes réformes judiciaires jugées conséquentes ou connexes dans une perspective authentiquement libérale : la suppression du juge d’instruction, le rattachement de la police judiciaire à la justice ou la création d’un corps de police judiciaire propre à la justice, la protection effective du droit à l’avocat pour les personnes faisant l’objet d’une mesure policière de privation de liberté, la reconnaissance du droit au silence et la prohibition de l’auto-incrimination dans les procédures pénales, la création d’un juge des libertés et de la détention…
*
[1] L’on a préféré l’expression « droite de la droite » pour cette raison que l’affiliation de François Mitterrand à « l’extrême droite » avant-guerre est discutée, en particulier parce que si son appartenance aux Croix-de-Feu est établie (l’organisation naît en 1934 et devient le Parti social français en 1936), le caractère « fasciste » ou d’« extrême droite » de cette organisation est réfutée par certains historiens (voir par exemple Michel Winock, François Mitterrand, Gallimard, 2015, p. 30-31). « Dans les écrits qui restent de lui », écrit Michel Winock, « dans ses fréquentations, dans les témoignages de ses contemporains, tout invite à situer François Mitterrand politiquement à droite. Non pas à l’extrême droite comme des adversaires se sont plu à le dire » (Michel Winock, op. cit., p. 33).
[2] La controverse sur la valeur juridique ou métajuridique de la Déclaration de 1789, la « controverse 1901 » entre Boutmy et Jellinek, la controverse sur l’état légal et l’état de droit. En tout cas, l’on trouve chez François Mitterrand beaucoup de « signes culturels » caractéristiques du « savoir juridique des docteurs en droit », autrement dit d’un intellectualisme juridique, à commencer par de nombreuses sollicitations ou citations de professeurs de droit.
[3] Les biographes de François Mitterrand expédient tous cette question, faute de s’être intéressés aux archives du Barreau de Paris (sur son inscription, son « exercice professionnel » comme on dit au Barreau, etc.) ou aux archives judiciaires (pour une recension de toutes les affaires sur lesquelles il a travaillé). Faute aussi d’avoir pris la mesure de la séduction que pouvait exercer à l’époque la « République des avocats » chez des diplômés en droit passionnés de politique (Gilles Le Béguec, La République des avocats, Armand Colin, 2003). « Les quatre premières années passées dans la capitale », lit-on néanmoins sur le site de l’Institut François Mitterrand, « sont des années d’études. Il s’inscrit pour cela à la faculté de droit – cette éloquence qu’il a pu constater l’a sans doute convaincu d’être avocat – mais aussi en sciences politiques, preuve qu’il ne limitait pas ses ambitions » (http://www.mitterrand.org/1934-1939-Les-annees-de-formation.html)…
[4] L’on sait moins en quoi ont consisté exactement les responsabilités de François Mitterrand sous le Gouvernement provisoire de la République française. Il y a été membre du 1er cabinet Charles De Gaulle (10 septembre 1944-21 novembre 1945), du 2e cabinet Charles De Gaulle (21 novembre 1945-26 janvier 1946), du cabinet Félix Gouin (26 janvier 1946-24 juin 1946), du cabinet Léon Blum (16 décembre 1946-22 janvier 1947).
[5] Les membres du Comité d’étude et de réflexion pour une Charte des libertés étaient : Élisabeth Badinter – Édouard Baldo – Hubert Beuve-Méry – Pierre Birnbaum – Michel Blum – François Chatelet – Claude-Albert Colliard – Jean-Claude Colliard – Jean-Pierre Cot – Jean-Claude Danmanville – Yve Daram – Michel Deguy – Eugène Descamps – David Desrameaux – Pasteur André Dumas – Josy Eisenberg – Elisabeth de Fontenay – Christian Gavalda – Claude Germon – Michel Gentot – Jean Gicquel – Benoîte Groult – Francis Hamon – Charles Hernu – Daniel Jacoby – Michel Jeol – Yve Jouffa – Jack Lang – R. P. Philippe Laroche – Emmanuel Le Roy Ladurie – Père Pierre-André Liège – André Lwoff – Arnaud Lyon-Caen – Pierre Lyon-Caen – Claude Manceron – Pierre Marcilhacy – Gilles Martinet – Henri Mercillon – Jean-Pierre Michel – Paul Milliez – Pierre Nicolay – Bernard Picinbono – Nicole Questiaux – Jacques Ribs – Philippe Robert – Jacques Robert – Michel Rocard – Yvette Roudy – Charles Salzmann – Maurice Seveno – Simone Souchi – Jean Terquem – Gérard Timsit – Michel Troper – Céline Wiener. Le Comité de rédaction du comité comprenait : Jacques Attali – Jean-Denis Bredin – Régis Debray – Laurent Fabius – Roger-Gérard Schwartzenberg – Michel Serres.
Le rapport de ce Comité est publié avec une préface de François Mitterrand qui précisait que ce document « n’est pas et ne saurait être la Charte des libertés. Il n’est pas davantage la doctrine ou le programme du parti socialiste » (Libertés, Libertés, Gallimard, 1976). Deux propositions de loi constitutionnelle accompagnent en 1975 le travail du Comité : une proposition de loi constitutionnelle « relative à l’élaboration et à l’adoption d’une Charte des libertés annexée au préambule de la Constitution » est l’œuvre du parti socialiste ; une proposition de loi constitutionnelle portant déclaration des libertés est pour sa part l’œuvre du parti communiste, et ses 89 articles se répartissent entre des « libertés individuelles et collectives », des « droits économiques et sociaux », des « droits à la culture et à l’information », des « droits politiques et à l’information », des « droits politiques et institutions », des garanties judiciaires.
[6] « On appellera ‟illibérale” une culture politique qui disqualifie en son principe la vision libérale. Il ne s’agit donc pas seulement de stigmatiser ce qui constituerait des entorses commises aux droits des personnes, marquant un écart plus ou moins dissimulé entre une pratique et une norme proclamée. Le problème est plus profondément de comprendre une étrangeté constitutive » (« Fondements et problèmes de l’‟illibéralisme” français », communication à l’Académie des sciences morales et politiques, 15 janvier 2001 : en ligne).
[7] Loi n° 81-737 du 4 août 1981 portant suppression de la Cour de sûreté de l’État.
[8] Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’État.
[9] Ce poids des préoccupations diplomatiques est flagrant dans l’acceptation française du recours individuel devant le Comité des nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale. Cette acceptation a été expressément présentée par les pouvoirs publics comme étant une sorte de titre moral à critiquer l’Apartheid.
[10] Pour de plus amples développements sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage La gauche au pouvoir et les libertés publiques. 1981-1995, L’Harmattan, 1999, p. 159-214.
[11] Robert Badinter, allocution prononcée le 25 juin 1982 devant le congrès de l’Union syndicale des magistrats, Le Monde, 29 juin 1982.
[12] La consultation eut lieu entre le 31 juin et le 30 novembre 1983 et 4156 magistrats (sur 5522) y firent valoir leur point de vue.
[13] Le Monde, 2 décembre 1990.
[14] On se permet de renvoyer sur ce point à nos études : « L’originalité statutaire des magistrats du Parquet et la Constitution », Pouvoirs, n° 2005/4, n° 115, p. 167-176 » ; « Justice et politique. Nouvelles réflexions sur le statut du Parquet », Gazette du Palais, 19–21 décembre 2004, p. 2–6. Voir également : Louis Favoreu, « Brèves observations sur la situation du Parquet au regard de la Constitution », Rev. sc. crim., octobre-décembre, 1994, p. 679 et s..
[15] La gauche au pouvoir et les libertés publiques. 1981-1995, op. cit., p. 83-94.
[16] Voir notre étude : « La « sécurité », brève histoire française d’un camaïeu », in Sécurité, Libertés et Légistique. Autour du Code de la sécurité intérieure (en co-direction avec X. Latour), L’Harmattan,, 2012, p. 13-23. Sur la « découverte de la pression sécuritaire » par la gauche dans les années 1981-1983, voir La gauche au pouvoir et les libertés publiques. 1981-1995, op. cit., p. 221-224.
[17] Ces institutions étant perçues comme des instruments de domination de la classe ouvrière.
[18] Jean-Michel Belorgey, La Police au rapport. études sur la police, Presses universitaires de Nancy, 1991.
[19] Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ‒ Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ‒ Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens ‒ Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique.
[20] Cette nécessité était admise avant 1981 puisqu’une commission de révision du Code pénal fut réunie en 1974 et qu’un avant-projet relatif aux dispositions générales du Code pénal fut arrêté en 1978. Une commission renouvelée de révision du Code pénal fut nouvellement activée en 1981 par Robert Badinter qui en présidait lui-même les travaux et dont les conclusions déterminèrent le projet de loi déposé au parlement en 1986 à la veille de l’alternance qui fut favorable à la droite.
[21] Exposé des motifs du projet de loi portant réforme du code pénal, Sénat, annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 1986, document parlementaire n° 300.
[22] Voir nos développements dans Libertés et droits fondamentaux, Berger-Levrault, 2015, p. 364-365. La loi du 12 juillet 1983 organise un régime préventif des activités privées de sécurité et prévoit un mur de séparation entre les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection des personnes.
[23] Cette condamnation a également visé un groupement de droit privé voué originellement au soutien du Général De Gaulle et devenu ensuite le « service d’ordre » des partis gaullistes : le « Service d’action civique » (François Audigier, Histoire du S.A.C. : la Part d’ombre du Gaullisme, Stock, 2003). À la faveur d’événements criminels auxquels furent associés des membres du « Service d’action civique » en 1981 (la « tuerie d’Auriol »), une commission d’enquête sur les activités du service d’action civique (SAC) fut créée par l’Assemblée nationale le 17 décembre 1981. Ses travaux coururent jusqu’au 17 juin 1982. Moins de deux mois plus tard, le président de la République décidait la dissolution du Service d’action civique sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Le décret n° 82-670 du 3 août 1982 portant dissolution de l’association nommée « Service d’action civique » (SAC) justifiait cette dissolution en ces termes :
« (…) [Le] SAC est une organisation hiérarchisée, cloisonnée et occulte ;
(…) Sous couvert des objectifs de caractère civique, culturel et social mentionnés dans ses statuts, elle s’est livrée à l’occasion d’événements politiques ou de conflits sociaux à des actions illégales et notamment à des violences à l’égard des personnes ; que d’ailleurs plusieurs de ses membres ont été impliqués dans des affaires criminelles ;
(…) L’activité de police parallèle de l’association s’est également manifestée par la recherche de renseignements sur des personnes en raison de leur appartenance politique ou syndicale ».
[24] Le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage fut créé par un décret du 4 janvier 1946.
[25] L’intéressé fut « retrouvé » par la police à Paris, ligoté dans une voiture.
[26] François Mitterrand, Politique, Fayard, 1977, p. 288-291.
[27] Jean-Marc Berlière, « La naissance des Renseignements généraux », Historia, n° 585, septembre 1995, p. 60-65 ; Jean-Marc Berlière, Le monde des polices en France XIXe-XXe siècles, Éditions Complexe, 1996. Voir également nos développements in La gauche au pouvoir et les libertés publiques. 1981-1995, op. cit., p. 263-265 et dans Traité de droit de la police et de la sécurité (P. Mbongo, dir.), Lextenso, 2014, p. 159 et s.
[28] La légende noire des Renseignements généraux est faite de récits, plus ou moins romancés, des « fiches » faites par le service sur les « mœurs » de différents acteurs politiques (voire de personnalités en dehors de la politique) et susceptibles d’être « dégainées » par le pouvoir en place, notamment sous la forme de fuites dans la presse (Le Canard Enchaîné en particulier).
[29] Nous n’avons trouvé aucune archive, aucun article de presse, suggérant que cette hypothèse avait été envisagée. En revanche les ministres de l’Intérieur, à commencer par Gaston Defferre, se sont plutôt constamment attachés à rappeler les termes du décret définissant les missions des RG : La gauche au pouvoir et les libertés publiques. 1981-1995, op. cit., p. 266.
[30] Le pasteur Joseph Doucé, militant homosexuel, avait disparu en juillet 1990 dans la forêt de Rambouillet puis avait été retrouvé mort. L’enquête sur cette mort a révélé que l’intéressé faisait l’objet d’écoutes du Groupe des enquêtes réservées (GER), une structure des Renseignements généraux de la préfecture de police. Ajoutée au fait que certains policiers de cette structure avaient été mis en cause pour des violences et des voies de fait, cette information a entretenu l’hypothèse que la mort du pasteur Joseph Doucé avait été la conséquence d’une « bavure » des Renseignements généraux. Cette hypothèse ne fut cependant pas validée par l’enquête judiciaire. Yves Bertrand, ancien « patron » des Renseignements généraux, soutiendra plus tard que cette affaire avait injustement entaché la réputation de cette structure policière dont il estimait qu’elle avait eu de bonnes raisons de suivre les activités du pasteur Doucé (Yves Bertrand, Je ne sais rien… mais je dirai (presque) tout, Plon, 2007). L’affaire de l’« espionnage » du Conseil national du parti socialiste par les Renseignements généraux est pour sa part d’un tout autre ordre et a lieu sous un gouvernement de droite, Charles Pasqua étant ministre de l’Intérieur. L’affaire commence avec la « révélation » par Le Canard Enchaîné le 6 juillet 1994 de ce que le Conseil national du parti socialiste réuni le 19 juin précédent à la Cité des sciences de la Villette à Paris avait fait l’objet d’un « espionnage » d’un agent de la cellule « partis politiques » des Renseignements généraux de la préfecture de police. En réalité, le parti socialiste était informé de cette « couverture » de son Conseil national par les RG, puisque différentes facilités avaient mises au service de l’agent parv le parti. Cela n’a pas empêché à la chose d’être présentée comme un « nouveau Watergate » et de faire l’objet d’une tempête médiatique et politique.
[31] À toutes fins utiles, il convient de garder à l’esprit que la détention provisoire est une mesure privative de liberté décidée par des juges.
[32] Sur ce décret (qui est en réalité un acte de valeur législative) et sur la manière dont le Conseil d’état n’a eu de cesse de le « sauvegarder », voir nos développements dans Libertés et droits fondamentaux, op. cit., p. 570 et s.
[33] Loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
[34] On prendra la mesure de l’importance accordée à cette question par François Mitterrand aux longs développements qui lui sont consacrés dans Politique, Fayard, 1977, p. 300-305.
[35] C’est une histoire assez cocasse que celle de la création de la Commission Schmelck et de l’enterrement de son rapport (La gauche au pouvoir et les libertés publiques. 1981-1995, op. cit., p. 305-312).
[36] Sur cette ambiguïté et sur les nombreuses occurrences de ce thème dans le débat public français depuis les années 1970 jusqu’au rapport Léger (2009) en passant par le programme de Nicolas Sarkozy en vue de l’élection présidentielle de 2007 et son discours lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation le 7 janvier 2009, voir nos développements dans Traité de droit de la police et de la sécurité (dir.), Lextenso, 2014, p. 26-27.
[37] Par exemple, la loi du 9 juillet 1984 tendant à renforcer le droit des personnes en matière de placement en détention provisoire et d’exécution d’un mandat de justice.
[38] La mesure de cette contrainte extérieure, de son retentissement sur les mesures privatives de liberté avant jugement pénal, voire sur le procès pénal lui-même, ainsi que les linéaments d’une révision générale du code de procédure pénale avaient été précisément exposés en 1989 par la Commission « Justice pénale et droits de l’homme » (« Commission Delmas-Marty ») instituée le 19 octobre 1988 par Pierre Arpaillange, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La Commission Delmas-Marty remit au garde des Sceaux un rapport préliminaire en novembre 1989 et son rapport final (La mise en état des affaires pénales) fut connu en juin 1990.
[39] Le dédoublement du contrôle interne de la police nationale entre celui exercé par l’Inspection générale de la police nationale et à la préfecture de police à Paris par l’Inspection générale des services était déjà contesté à l’époque par certains réformistes libéraux de la police nationale. Mais ces critiques ne nourrirent pas de débats publics comme ceux qui précédèrent la suppression en 2013 de l’Inspection générale des services.
[40] De fait, le Conseil supérieur de l’activité de la police a été créé quelques jours avant des élections législatives annoncées comme étant favorables à la droite. Celle-ci jugea qu’il s’agissait en réalité d’une « entreprise politique » dirigée contre elle.
[41] Jacques Chevallier, « Le statut de la communication audiovisuelle », AJDA, 1982, n° 10, p. 555.
[42] Georges Vedel, La gestion des entreprises de presse. Rapport présenté au nom du Conseil économique et social, J.O. Avis et rapports du CES, n° 21, 1979.
[43] Voir notre réflexion « La liberté de la communication audiovisuelle. Invention et dévitalisation par la convergence numérique d’une catégorie juridique », in La liberté de la communication audiovisuelle au début du XXIe siècle (Pascal Mbongo, Michel Rasle, Carine Piccio, dir.), 2014, p. 9-21.
[44] Nadine Toussaint-Desmoulins, « Les entreprises de communication audiovisuelle. Concentration et équité concurrentielle », in La liberté de la communication audiovisuelle au début du XXIe siècle, op. cit., p. 43-56.
[45] Michel Rasle, Julie Niddam, « Les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles et de chansons », in La liberté de la communication audiovisuelle au début du XXIe siècle, op. cit., p. 111-126 ; Camille Brachet, « La culture à la télévision suppose-t-elle nécessairement des ‟émissions culturelles” », in La liberté de la communication audiovisuelle au début du XXIe siècle, op. cit., p. 97-109.
[46] La création de la chaîne de télévision Canal + en 1984 fut ainsi un « fait du prince ». Les chaînes de télévision La Cinq et TV6 naissent en 1986 à l’initiative de François Mitterrand par voie de concessions et au prix d’un « passage en force » juridique. La réattribution de La Cinq en 1987 par le gouvernement de Jacques Chirac à Robert Hersant et la substitution, toujours en 1987, de M6 à TV6 n’ont pas moins été imposées par le pouvoir politique.
[47] Il s’agit par exemple de la volonté et des intrigues du pouvoir politique pour faire choisir par l’autorité de régulation comme dirigeants des chaînes publiques les personnes ayant la faveur dudit pouvoir politique. La chronique de ces ingérences est riche de témoignages directs ou indirects d’acteurs politiques ou des médias : Agnès Chauveau, L’Audiovisuel en liberté ? : Histoire de la Haute Autorité, Paris, Presses de Sciences Po, 1997 ; Michèle Cotta, Cahiers secrets de la Ve République, tome II (1977-1986), Fayard, 2008 ‒ tome III (1986-1997), Fayard, 2009 ; Patrice Duhamel et Alain Duhamel, Cartes sur table, Plon, 2010 ; Emmanuel Berretta, Le hold-up de Sarkozy-Intrigues, lobbying et coups tordus dans les médias, Fayard, 2010.
[48] La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA, 1982), la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL, 1986), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA, 1989). Sur ces autorités et leur garantie de la liberté de la communication, voir notamment Emmanuel Derieux, « Régulation et liberté de la communication audiovisuelle », in La liberté de la communication audiovisuelle au début du XXIe siècle, op. cit., p. 127-140.
[49] Du nom du ministre de l’éducation nationale, Alain Savary, qui l’a porté.
[50] La gauche au pouvoir et les libertés publiques. 1981-1995, op. cit., p. 438-454.
[51] Ibid., p. 445-446.
[52] Dès les années 1970, l’acronyme SPULEN a servi de substitut langagier à la notion de « service public, unifié et laïque de l’éducation nationale ».
[53] Danièle Lochak, La Convention des Institutions Républicaines. François Mitterrand et le socialisme, PUF, 1972.
[54] La rédaction du projet de loi Savary a couru de 1982 à l’adoption du texte en Conseil des ministres le 18 avril 1984.
[55] Ponctuellement, ce sont des « amendements Laignel » déposés à l’Assemblée nationale ‒ André Laignel député socialiste, passait pour une figure de proue des « laïques » radicaux au parti socialiste : ce sont ces amendements, qui ne furent pas déjugés par le président du groupe socialiste Pierre Joxe ‒ ils reçurent son soutien, selon différentes autres sources ‒ qui mirent « le feu aux poudres » selon le langage de la presse de l’époque : ces amendements conditionnaient le financement par les communes des établissements privés à la titularisation de la moitié au moins de leurs enseignants. La « crise politique » ouverte par le projet Savary aura conduit à la démission du gouvernement de Pierre Mauroy le 17 juillet 1984, après que le président de la République a annoncé publiquement le retrait du texte de l’ordre du jour du parlement.
[56] Ces circonstances étaient néanmoins explicites dans l’allocution radiodiffusée et télévisée par laquelle le président de la République a annoncé, le 12 juillet 1984, aussi bien l’abandon du projet Savary que cette initiative constitutionnelle.
[57] Cette notion de « caractère propre » est un euphémisme servant précisément à désigner le caractère religieux de ces établissements et leur droit de conformer leurs activités à leurs convictions religieuses.
[58] Dans les années 1980 encore, le concept de « liberté de conscience » servait à désigner en France des objets que d’autres cultures politiques et juridiques subsumaient plutôt sous le concept de « liberté de religion ».
[59] Cons. const. n° 84-185 DC, 18 janvier 1985, Loi modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’état et les collectivités territoriales.
[60] Ibid.
[61] Cons. const. n° 93-329 DC, 13 janvier 1994, Loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales.
[62] Il nous semble en effet que même la loi de 1881 relative à la liberté de la presse est travaillée par un idéal « élitaire » qui, en réduisant constamment la liberté d’expression à la liberté de la presse, fait de cette liberté une prérogative des « catégories dirigeantes » ou de « la bourgeoisie » ‒ soit des catégories sociales « modérées » et donc hypothétiquement les moins portées à troubler l’ordre public ou à contester l’autorité de l’état ‒ plutôt qu’un attribut du citoyen-individu (sur cette question, voir notre ouvrage La liberté d’expression en France. Nouvelles questions, nouveaux débats, Mare et Martin, 2012, p. 21).
[63] Aussi, et sous bénéfice d’inventaire, aucun programme du parti socialiste d’avant l’alternance de 1981 ne contient par exemple un engagement en faveur de l’abrogation de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées (ce texte est désormais codifié dans le Code de la sécurité intérieure).
[64] Sur les débats relatifs à ces textes, nous nous permettons de renvoyer à nos développements dans La liberté d’expression en France. Nouvelles questions, nouveaux débats, Mare et Martin, 2012.
[65] La loi de 1949 précise que le ministre de l’Intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions. Sur ce texte, on se permet de renvoyer au chapitre VII (« L’impunité de l’écrivain et de l’artiste ») de notre ouvrage La liberté d’expression en France. Nouvelles questions, nouveaux débats, Mare et Martin, 2012, p. 203-237. Voir également de Thiérry Crépin et Thiérry Groensteen (dir.), On tue à chaque page ! La loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, éditions du Temps – Musée de la bande dessinée, 1999. Pour la recension des applications de la loi entre 1949 et 2007 (soit près de 5000 mesures d’interdiction dirigées contre des livres, des bandes dessinées, des revues, des journaux), voir de Bernard Joubert, Dictionnaire des livres et journaux interdits, éditions du Cercle de la librairie, 2007.
[66] Avec deux interdictions seulement, Gaston Defferre est le ministre de l’Intérieur qui aura le moins sollicité l’article 14 de la loi de 1949.
[67] Sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing déjà, le ministre de l’Intérieur ne prononçait plus systématiquement l’interdiction recommandée par la « Commission de surveillance » prévue par la loi. Cette autolimitation a été décidée après que l’applicabilité de la loi de 1949 à deux publications, Jack l’éventreur en vacances (une bande dessinée de Willem) et Absolu (« revue de charme éditée par le chanteur Claude François ») a suscité un débat public (Frédérique Roussel, « à poil la censure ! », Libération, 3 octobre 2007).
[68] L’interdiction maintenue en vigueur par la gauche et par la droite malgré sa contestation constante par le champ littéraire depuis 1962 fut celle de L’épi monstre de Nicolas Genka. Cette interdiction ne fut levée que par un arrêté du 25 juillet 2005 et après que le Conseil d’état a jugé illégale la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation formée par l’écrivain et enjoint au ministre de l’Intérieur d’abroger un arrêté qu’il considérait nouvellement comme illégal (CE, 27 juin 2005, Genka).
[69] Le décret disposait par ailleurs que l’inscription d’une œuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 entraîne l’interdiction de sa représentation à toutes les personnes mineures.
[70] Décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
[71] Dans une jurisprudence abondante relative à l’application de l’article 14 de la loi de 1881, l’arrêt Librairie Maspero (CE, 2 novembre 1973) du Conseil d’état se prêta à une attention particulière puisque le juge administratif accepta d’exercer nouvellement un contrôle de l’« erreur manifeste d’appréciation » sur des mesures administratives d’interdiction de publications étrangères.
[72] CEDH, 17 juillet 2001, Association Ekin c. France, n° 39288/98.
[73] CE, 7 février 2003, GISTI, n° 243634.
[74] François Mitterrand, Le Coup d’état permanent, Plon, 1964, réédition Union générale d’éditions, 1993, p. 203-204.
[75] TGI, Seine, 17e chambre correctionnelle, 1er avril 1963, Vicari.
[76] Nous avons rapporté cette histoire dans l’entrée « Injure, diffamation et offense », in Dictionnaire de culture juridique (Stéphane Rials et Denis Alland, dir.), P.U.F., octobre 2003, puis ses aspects plus contemporains dans un chapitre (« Du Crimen majestatis à l’affaire Hamé ») de La liberté d’expression en France. Nouvelles questions, nouveaux débats, Mare et Martin, 2012, p. 303-309.
[77] Le délit d’offense à chef de l’état n’a été abrogé que par une loi du 5 août 2013, une abrogation qui n’a d’ailleurs pas été « imposée » par la Cour européenne des droits de l’Homme, comme beaucoup (les promoteurs de la loi et un certain nombre de commentateurs en doctrine) ont pu le dire. En effet, dans éon c. France (13 mars 2013, n° 26118/10), la Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas invalidé le délit d’offense à chef de l’état mais a jugé, au regard des circonstances de l’espèce et de la peine prononcée, que la condamnation du prévenu (un militant politique) pour offense au chef de l’état était disproportionnée par rapport au but poursuivi. Les discours dirigés contre le président de la République ne bénéficient cependant pas d’une immunité totale depuis la loi du 5 août 2013: simplement relèvent-ils depuis des dispositions de la loi de 1881 relatives aux injures et aux diffamations envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent…
[78] Parti socialiste, Les acteurs de la démocratie, in Vendredi, n° 287, 10 juin 1996.
[79] Projet de loi constitutionnelle portant révision des articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception (Assemblée nationale, 30 mars 1990, doc. parl. n°1203) ‒ Projet de loi constitutionnelle portant révision de la constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VII, VIII, IX et X (dispositions modifiant le titre VII) ((Sénat, 10 mars 1993, doc. parl. n° 231).
Le concept de « droit au procès équitable », qui désigne depuis 1998 les nombreuses prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, est traduit dans la version anglaise de la Convention par Right to a fair trial au prix d’un paradoxe : fair trial renvoie plutôt littéralement à une idée d’honnêteté (*). En même temps, Due Process of Law, que la littérature juridique américaine associe quelquefois à la fairness(*), pouvait d’autant moins être retenu par les rédacteurs britanniques de la Convention que ce concept est très fortement enraciné dans la tradition juridique américaine. La première occurrence de l’expression Due Process of Law est datée d’un texte remontant à Edward III (1354). Toutefois, à la suite d’Edward Coke qui assimilait la notion de Law of the land contenue à l’article 39 de la Magna Carta à la common law et considérait que la common law impliquait le Due Process (*), la notion de Law of the Land a pu être interprétée comme étant synonyme de la notion de Due Process of Law : la Cour suprême elle-même a défendu cette synonymie au motif que les constitutions adoptées par les colonies britanniques libérées reprenaient à leur compte les principes posés par l’article 39 de la Magna Carta (*). Les raisons pour lesquelles la notion de Due Process of Law s’est substituée en 1791 à celle de Law of the Land restent encore obscures à l’historiographie de la Constitution des Etats-Unis (*). La plupart des Constitutions des Etats se sont néanmoins alignées sur l’expression Due Process et dans celles dans lesquelles subsiste la notion de Law of the Land, celle-ci est interprétée comme synonyme de Due Process of Law (*).
Les tribunaux californiens ont interdit la discrimination raciale dans la sélection des jurés depuis 1978, huit ans avant que la Cour suprême des États-Unis parvienne à la même conclusion en droit constitutionnel américain. Mais les avocats de la défense, rejoints par la NAACP, affirment que certains procureurs du comté de San Bernardino ont utilisé la « stratégie OJ » comme une échappatoire à peine voilée à cette interdiction en écartant des Noirs des jurys sans utiliser de critères ouvertement raciaux. La « stratégie OJ » : la première étape consiste à demander aux candidats jurés ce qu’ils pensent de l’acquittement, en 1995, de l’ancienne star afro-américaine du football américain OJ Simpson, après le meurtre de son ex-femme et de son amie, toutes deux blanches. L’étape suivante consiste pour les procureurs à renvoyer les jurés noirs qui ont approuvé le verdict, tout en offrant une explication non raciale qui satisfasse les tribunaux.
Cette stratégie est attaquée devant différentes juridictions.
Note du 1er août 2018 de la directrice de la PJJ relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en danger de radicalisation violente.
La répétition d’actes de terrorisme islamiste (1) en France, et dans de très nombreux autres pays, soulève la problématique de la radicalisation violente, menace endogène et exogène qui implique aussi, à la marge, des mineurs. Concept employé pour caractériser des mouvements politiques ou sociaux remettant en cause un ordre établi par des voies non pacifiques, la radicalisation violente ne saurait être réduite au seul terrorisme. Elle peut se définir comme un «processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux : qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel » (2).
La radicalisation violente recouvre donc trois caractéristiques cumulatives :
– Un processus progressif et incrémentieI (3),
– L’adhésion à une idéologie extrémiste,
– L’adoption de la violence comme mode d’action légitime (4).
Depuis 2015, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ont été conduits, dans un contexte particulièrement éprouvant tant par l’ampleur des actes de terrorisme que par les conséquences qu’ils ont eu sur la vie quotidienne de l’ensemble de la population, à prendre en charge des adolescents, filles et garçons, impliqués dans des réseaux responsables d’attentats ou qui en ont fait l’apologie. Par ailleurs, ils sont depuis toujours investis dans la prise en charge de mineurs confrontés à d’autres formes de violences radicales, telles que les engagements nationalistes et les extrémismes politiques.
Ces propos et ces actes de mineurs ou jeunes majeurs viennent non seulement attaquer les lois et les principes de la République, mais ils sont venus toucher les professionnels au cœur même de leurs valeurs éducatives en nourrissant des représentations et des craintes auxquelles ils n’étaient pas préparés. La présente note vise à apporter aux professionnels des secteurs public et associatif habilité de la PJJ, confrontés à un phénomène d’une grande complexité, à un public varié et à des causes multifactorielles, des éléments de doctrine venant étayer la prise en charge et prendre en compte leurs préoccupations, dont celles liées à la violence(5) intrinsèque au sujet (6) .
L’on ne peut pas vouloir seulement un quart, ou une moitié du Premier Amendement de la Constitution américaine (en ce qu’il se rapporte à la liberté d’expression) car s’il n’y a pas aux Etats-Unis (c’est souvent vers eux qu’on se tourne dans ce débat) une police juridictionnelle de la littérature comme il en existe dans tous les pays européens (et même dans le monde entier) c’est parce que le Premier Amendement s’oppose à la plupart des polices de discours (ou ne les accepte que dans des limites très étroites : diffamation, atteinte à la vie privée) qui sont le creuset des affaires dont les juges sont saisis en France (en particulier). Or comme le montre l’affaire de l’admission douanière d’Ulysse de James Joyce, lorsque les juges fédéraux américains sont saisis de la police de l’obscénité (celle-ci n’est pas protégée par le Premier Amendement), ils font eux aussi un travail « de critique littéraire et artistique », autrement dit un travail sémiologique, comme les juges français. Aussi, même en admettant que c’est une « linguistique sauvage » ou une « esthétique sauvage » que les juges pratiquent dans ce contexte, cela ne fait pas moins une grande différence avec le procureur Pinard face à Flaubert : ce travail sémiologique est une contrainte argumentative qui pèse sur eux (le procureur Pinard et les juges du XIXe siècle n’en avaient pratiquement aucune) dès lors qu’ils sont saisis d’affaires rentrant dans le champ de leur compétence… en vertu de la loi.
I. Cadrage général
Dès lors que l’on a un ordre juridique – comme c’est le cas en France et partout en Europe – qui prévoit des polices de discours visant les atteintes à la vie privée, les atteintes à la présomption d’innocence, les injures et les diffamations, les injures et les diffamations sexistes, racistes, homophobes ou handiphobes, les provocations ou les incitations à la commission de crimes, les apologies de crimes, la négation des crimes contre l’humanité jugés à Nuremberg, etc. l’alternative qui vous est offerte s’agissant des œuvres littéraires est la suivante :
1. Premier choix possible du législateur (le droit positif). Décider, comme le fait le droit en vigueur, de ne pas accorder de statut particulier, d’immunité particulière aux « œuvres littéraires » ou aux « œuvres de fiction » au sein des nombreuses polices des discours prévues par le droit français (sur ces polices, que l’on réduit à tort à quelques articles du code pénal, du code civil et de la loi de 1881, voir le chapitre “Echographie des abus de la liberté d’expression en droit français” dans notre ouvrage La liberté d’expression en France. Nouvelles questions, nouveaux débats, 2012).
Ici la loi fait l’hypothèse qu’un ouvrage labellisé roman, nouvelle ou fiction peut très bien faire le lit de « mauvais penchants » ; que, pour ainsi dire, on peut être écrivain (et même un « authentique écrivain ») et ne pas être « progressiste », et être haineux, voire … génocidaire, y compris dans son oeuvre.
La loi s’en remet donc aux juges pour apprécier, somme toute, les intentions de l’auteur (puisque nous sommes dans le cadre de délits intentionnels), non pas à la faveur d’une introspection dans le cerveau de l’auteur, mais sur la base d’une sorte d’analyse sémiologique du texte litigieux. Dans notre ouvrage précité sur La liberté d’expression en France nous avons rendu compte de ce que prises dans leur ensemble, et sur la période allant de l’année 2000, les décisions des juges sont :
– plus « libérales » que répressives ; s’il y a plus de procès, ce n’est pas la faute des juges et ce qui compte au bout du compte c’est ce qu’ils décident.
L’erreur intellectuelle qui traverse la presse sur ce point (la thèse d’une « augmentation des condamnations » y prédomine) consiste à ne pas rapporter (en bonne rigueur statistique) les jugements sur une période donnée au nombre d’actions initiées devant les juges et à comparer par rapport à des périodes de référence. Au demeurant, l’argumentation tirée de l’« augmentation des condamnations » fait peu de cas de ce que le Conseil d’Etat n’est plus guère sollicité puisque l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est pratiquement en sommeil (cf. La liberté d’expression, op. cit., p. 64-66, p. 217-227 ; « La révision de la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse », Légipresse, juillet-août 2011, p. 436-439). Enfin, une évaluation pertinente de ce que décident les juges demande encore à tenir compte du nombre considérable d’oeuvres auto-fictionnelles désormais éditées annuellement et à les rapporter au nombre d’actions formées devant les juges et à la nature des décisions rendues par les tribunaux.
– plus « compréhensives » lorsqu’il s’agit d’écrivains installés ou reconnus dans le champ littéraire (ex. : Camille Laurens) que d’écrivains dont les juges peuvent soupçonner (à tort ou à raison) que le défaut de notoriété peut les avoir porté à commettre des textes « provocateurs » ou particulièrement « transgressifs » (ex. : Pogrom) ;
– plus élaborées dans leur argumentation lorsque l’affaire est jugée à Paris ou à Versailles (autrement dit par des juges socialisés à ce type de contentieux) qu’en province ;
– plus « honnêtes » dans leur traitement sémiologique des ouvrages litigieux que ne le suggèrent les critiques dont elles font généralement l’objet. « Honnêtes » s’entend ici de cette idée que le juge n’étant pas supposé faire oeuvre de théorie littéraire ou esthétique – pas plus d’ailleurs que ne le font les avocats des parties (pour dire la vérité, les figures d’autorité littéraire ou sémiologique souvent convoquées dans les écritures des plaideurs sont presque toujours les mêmes) – le travail analytique qu’il fait en application de la loi ne se caractérise généralement pas par des absurdités folles. On y trouve certes des contradictions, des paralogismes, des anachronismes – nous en avons chroniqué quelques-uns dans notre ouvrage ainsi que dans les deux commentaires que nous avons commis au Dalloz (Recueil Dalloz, 7 mars 2013, p. 569 & Dalloz Actualité du 4 avril 2013) sur Belle et Bête de Marcela Iacub – comme on en trouve dans les écritures soumises aux juges par les parties.
2. Deuxième choix possible du législateur. Décider que les « oeuvres littéraires » (ou les « oeuvres de création » ou les « oeuvres de fiction ») échappent aux polices des discours prévues par le droit français.
C’est séduisant mais vain (et même « dangereux » du point de vue de la conception européenne des abus de la liberté d’expression) : quel sera le critère juridique de reconnaissance d’une « oeuvre littéraire » ou d’une « oeuvre de création », voire d’une « oeuvre de fiction » ? C’est avec ironie que l’on a lu plus d’un commentaire – d’écrivain(s) ou de critique(s) littéraire(s), de journalistes, de juristes, etc. – décidant souverainement de ce que Belle et Bête de Marcela Iacub n’était pas une « oeuvre littéraire », une « oeuvre de fiction », etc.
Cette solution ne ferait donc pas moins intervenir les juges que la solution actuelle, surtout si venaient à proliférer des essais déguisés en « romans », parce que recouverts en couverture de la mention « roman » afin de les faire échapper aux incriminations prévues par les textes. Puisse le lecteur de ces lignes qui voudra suggérer une définition « objective » du « roman » ou d’une « oeuvre de fiction » avoir la modestie de considérer qu’aucun définition disponible sur le marché des idées ne fait consensus et que chaque auteur (ou presque) en a une (cf. Assises du roman organisées par Le Monde et la Villa Gillet, Roman et réalité, Christian Bourgois éditeur, 2007 : on y prêtera spécialement attention au texte de Christine Angot, p. 333-342, dont Les Petits a été condamné pour atteinte à la vie privée).
II. L’affaire United States v. One Book Called “Ulysses” (extrait de La liberté d’expression en France. Nouvelles questions et nouveaux débats, 2012).
(…) C’est (…) dans le cadre de cette discussion juridique américaine sur l’obscénité – en ce qu’elle touche à la liberté d’expression en général et à la liberté d’expression littéraire et artistique en particulier – qu’il convient de situer l’affaire United States v. One Book Called « Ulysses » puisqu’il fallait au juge dire si Ulysse de James Joyce était justiciable des dispositions du Tariff Act de 1930 prohibant l’importation aux Etats-Unis de publications obscènes. (…).
Dans ses mémoires, Sylvia Beach, l’éditrice parisienne de Joyce a plaisamment raconté sa rencontre avec l’écrivain, l’adoption de celui-ci par beaucoup de figures du monde parisien des Arts et des Lettres, le « bouclage » parisien d’Ulysse et même l’économie domestique de Joyce . Sylvia Beach fait également prendre la mesure des risques juridiques et financiers qui conduisirent Miss Harriet Weaver à interrompre sa publication de Joyce en Angleterre dans la revue dont elle était éditrice (The Egoist), ainsi d’ailleurs que les saisies récurrentes dont The Little Review – éditée quant à elle à New York par Margaret Anderson et Jane Heap et où eut lieu la primo-publication américaine d’Ulysse sous forme feuilletonesque – a fait l’objet à l’initiative de John S. Sumner de la « Société pour la Répression du Vice ». C’est donc à l’aide notamment de souscriptions formées par les acteurs du milieu culturel parisien – les pages consacrées par Sylvia Beach à la justification par George Bernard Shaw de son refus de souscription sont parmi les plus savoureuses – qu’Ulysse fut définitivement édité en 1922 par Shakespeare and Company, la librairie tenue à l’Odéon par Sylvia Beach. La nouvelle vie américaine d’Ulysse ne fut cependant pas moins épique jusqu’à l’interception en 1932 par la douane américaine d’un exemplaire adressé à son éditeur Outre-Atlantique, Random House. Cette interception fut au demeurant provoquée par l’éditeur américain lui-même, qui voulait ainsi provoquer un précédent judiciaire libéral. L’ordre douanier de bannissement d’Ulysse du territoire américain fut donc porté devant une Cour fédérale du District New York-Sud composée en l’occurrence du seul juge James Woolsey, puisque les parties au litige ont préféré l’office d’un juge à la réunion d’un Jury, ce dont le juge Woolsey ne manqua d’ailleurs pas de se féliciter eu égard à la longueur et à la complexité de l’œuvre de Joyce.
Comme le juge Woolsey s’appropriait la doctrine selon laquelle les publications obscènes n’étaient pas protégées par le premier amendement, il ne lui restait plus qu’à dire si Ulysse était obscène ou non. C’est à cet exercice que s’attache sa décision United States v. One Book Called « Ulysses » du 6 décembre 1933, une décision qui compte parmi les « grandes décisions » du droit des Etats-Unis et dont la qualité argumentative vaut à son auteur d’être inscrit dans la même lignée qu’Oliver Wendell Holmes. Le travail analytique du juge Woolsey a d’autant plus été remarqué que les juges d’appel (par deux voix contre une) ont confirmé sa décision en faveur de Random House (et donc de Joyce) en se fondant sur une argumentation moins élaborée (Cour d’appel fédérale pour le 2e Circuit, United States v. One Book Entitled « Ulysses », 1934). Or si l’on y prête vraiment attention, la décision rendue par le juge Woolsey est ambivalente. Son libéralisme procède en effet de deux opérations intellectuelles : d’une part une évaluation esthétique de l’ouvrage de Joyce, ce faisant le juge s’arroge une compétence spécifique de critique littéraire ; d’autre part une imputation à l’ouvrage de propriétés d’avant-gardisme, ce qui est une manière pour le juge lui-même de s’inscrire dans l’avant-garde, ainsi d’ailleurs que les amis dont il a sollicité l’avis en postulant qu’ils sont cet homme sensuel moyen dont la sensibilité est déterminante pour éprouver l’obscénité.
C’est précisément parce que la conclusion libérale du juge Woolsey s’est appuyée sur un jugement esthétique que son libéralisme est réversible, du moins si l’on accepte l’idée que tout jugement esthétique est lui-même réversible. On peut le dire autrement, le protocole argumentatif du juge Woolsey pour Ulysse et du procureur Pinard pour Madame Bovary est au fond le même ; ce qui distingue les deux magistrats c’est que l’un (le juge Woolsey) était un avant-gardiste (ou voulait apparaître comme tel) tandis que l’autre (le Procureur Pinard) semblait ne pas concevoir qu’il puisse y avoir des « révolutions » esthétiques et/ou formelles.
(…)
III. L’opinion (jugement) du juge James Woolsey dans United States v. One Book Called “Ulysses” (1933), extrait de La liberté d’expression en France. Nouvelles questions et nouveaux débats, 2012, p. 327-330).
« I. (…)
II. J’ai lu Ulysse d’abord dans sa totalité puis j’ai lu les passages contre lesquels l’État a, à plusieurs reprises, formé des récriminations. En fait, pendant plusieurs semaines, mon temps libre a été dévolu à réfléchir à la décision que m’impose la présente affaire.
Ulysse n’est pas un livre facile à lire ou à comprendre. Mais on a beaucoup écrit à son sujet, et afin d’en approcher correctement la substance il est souhaitable de lire un certain nombre d’autres ouvrages qui sont désormais ses satellites. L’analyse d’Ulysse est, dans cette mesure, une tâche ardue.
III. Toutefois, le prestige d’Ulysse dans le monde des lettres justifie que j’aie pris un temps suffisamment important, aussi bien pour satisfaire ma curiosité que pour comprendre l’intention qui a animé l’écriture du livre, puisque, en effet, dans toute affaire dans laquelle un livre est dénoncé en tant qu’il est obscène, l’on doit d’abord établir si l’intention dans laquelle le livre a été écrit était, selon l’expression convenue, pornographique – c’est-à-dire écrit avec la volonté manifeste d’exploiter l’obscénité.
Si l’on arrive à cette conclusion que le livre est pornographique, l’enquête prend fin et la saisie/confiscation ne peut pas ne pas suivre. Malgré la franchise inhabituelle caractéristique d’Ulysse, je n’y ai cependant pas trouvé l’expression d’une concupiscence du sensualiste. Dans cette mesure je soutiens que le livre n’est pas pornographique.
IV. En écrivant Ulysse, Joyce cherchait à faire une tentative sérieuse de création, sinon d’un genre littéraire nouveau, du moins d’un genre romanesque complètement inédit. Ses personnages sont des personnes issues des couches inférieures de la classe moyenne et vivant à Dublin, et il cherche à dépeindre non seulement leurs actions en un certain jour de juin 1904 – alors que ces personnes vont en ville vaquer à leurs occupations habituelles – mais également leurs pensées. Joyce a essayé – il me semble, avec un succès sidérant – de montrer comment l’écran de la conscience, avec ses perpétuelles et instables impressions kaléidoscopiques, charrie, comme si elles étaient sur un palimpseste en plastique, non seulement ce sur quoi se porte l’observation qu’a chaque homme des choses courantes qui le concernent, mais également, dans une zone obscure, des résidus d’impressions passées, dont certaines sont récentes et dont d’autres émergent d’associations venues du subconscient. Joyce montre comment chacune de ces impressions affecte la vie et les comportements du personnage qu’il est en train de décrire.
Ce qu’il cherche à obtenir n’est pas si différent du résultat d’une double ou, si la chose est possible, d’une multiple exposition sur une pellicule de cinéma qui donnerait un premier plan limpide avec un arrière plan visible mais quelque peu flou à des degrés divers. Cette volonté de produire par les mots un effet qui, de toute évidence, ressort davantage du graphisme est pour beaucoup, me semble-t-il, dans l’obscurité à laquelle se heurte le lecteur d’Ulyssse. Et cela explique aussi un autre aspect du livre, que je dois davantage considérer, à savoir la sincérité de Joyce et son effort honnête de montrer exactement comment les esprits de ses personnages opèrent.
Si Joyce n’avait pas cherché à être honnête en développant la technique qu’il a adoptée dans Ulysse le résultat en aurait été psychologiquement biaisé et n’eût pas été fidèle à la technique qu’il avait choisie. Pareille attitude eût été artistiquement inexcusable.
C’est parce que Joyce a été loyal envers sa technique et n’a pas eu peur de ses implications nécessaires mais a honnêtement essayé de raconter parfaitement [précisément] ce que ses personnages pensent, qu’il a été l’objet de tant d’attaques et que son propos a si souvent été mal compris et mal interprété. Sa tentative sincère et honnête d’atteindre son objectif a exigé de lui l’usage de certains mots qui sont certes généralement considérés comme étant des mots orduriers et fait que beaucoup considèrent qu’il y a une prégnance trop forte du sexe dans l’esprit de ses personnages.
Les mots considérés comme grossiers sont des mots de l’ancien saxon connus de la plupart des hommes, et je suppose, de beaucoup de femmes, et ce sont des mots qui seraient utilisés naturellement et habituellement, je crois, par le genre de personnes dont Joyce cherche à décrire la vie, physique et mentale. Pour ce qui est de la récurrence du thème du sexe dans les pensées des personnages, l’on ne doit pas perdre de vue que le lieu dont il s’agit est celte et que la saison dont il s’agit est le printemps.
La question de savoir si l’on aime ou pas la technique éprouvée par Joyce est une question de goût pour laquelle il est vain d’exprimer un désagrément ou de débattre, autant qu’il est absurde de vouloir soumettre la technique de Joyce à des standards relevant de techniques qui ne sont pas les siennes. Par conséquent, je tiens pour acquis qu’Ulysse est un livre sincère et honnête et que les critiques à son encontre méconnaissent complètement son projet.
V. Au demeurant, Ulysse est un incroyable tour de force lorsqu’on prend en compte la réussite qu’il représente au regard de l’objectif si difficile que Joyce s’était lui-même imposé. Comme je l’ai dit, Ulysse n’est pas un livre facile à lire. Il est tour à tour brillant et insipide, intelligible et inaccessible. Différents passages me semblent répugnants, mais malgré son contenu, comme je l’ai dit plus haut, ses nombreux mots habituellement considérés comme orduriers, je n’ai rien trouvé qui puisse être perçu comme étant grossier pour l’amour du grossier. Chacun des mots du livre contribue, telle une mosaïque, au détail d’une image que Joyce cherche à construire pour ses lecteurs.
C’est un choix personnel que de ne pas vouloir être assimilé aux personnes décrites par Joyce. Et afin d’éviter tout contact indirect avec ce type de personnes, certains peuvent souhaiter ne pas lire Ulysse ; ce qui est tout à fait compréhensible. Mais lorsqu’un véritable esthète des mots, ce que Joyce est indubitablement, cherche à dépeindre une image véridique de la classe moyenne inférieure d’une ville d’Europe, devrait-il être impossible au public américain de voir légalement cette image ? Afin de répondre à cette question, il n’est pas suffisant de considérer simplement, comme j’ai pu l’établir précédemment, que Joyce n’a pas écrit Ulysse avec ce qui est communément appelé une intention pornographique. Je dois m’efforcer d’appliquer à ce livre un standard plus objectif afin de déterminer son effet, sans considération de l’intention avec laquelle il a été écrit.
VI. Le texte sur le fondement duquel des récriminations sont adressées au livre, en ce qui nous concerne ici, s’oppose seulement à l’importation aux Etats-Unis de tout « livre obscène » en provenance de quelque pays étranger que ce soit. Section 305 du Tariff Act de 1930, titre 19 du code des États-Unis, Section 1305. Ce texte n’oppose pas à l’encontre des livres le spectre des adjectifs infamants communément éprouvés dans les lois concernant les affaires de ce genre. Aussi ne me faut-il dire que si Ulysse est obscène en m’en tenant à la définition légale de ce terme. Tel qu’il est légalement défini par les tribunaux, l’obscène est ce qui tend à déchaîner les pulsions sexuelles ou à conduire à d’impures et luxuriantes pensées sexuelles (…).
Le fait de savoir si tel ou tel livre peut encourager de telles pulsions ou pensées doit être éprouvé par la cour au regard des effets du livre sur une personne ayant des instincts sexuels ordinaires – ce que les français appelleraient l’homme moyen sensuel ; des instincts sexuels ordinaires dont le statut dans ce type d’affaires est comparable à celui de « l’homme raisonnable » en droit civil et à celui de « l’homme éclairé » en propriété intellectuelle.
Le risque qu’implique l’utilisation d’un tel standard résulte de la tendance naturelle de celui qui est chargé d’apprécier les faits, aussi juste qu’il veuille être, à soumettre excessivement son jugement à ses propres idiosyncrasies. J’ai essayé ici d’éviter cela et, dans la mesure du possible, de rendre mon référent en ceci plus objectif qu’il n’aurait pu l’être autrement, en adoptant la démarche suivante :
Après que j’ai établi ma décision en considérant l’aspect d’Ulysse, j’ai vérifié mes impressions avec deux de mes amis qui, à mes yeux, correspondent au profil exigé par mon modèle.
Ces assesseurs littéraires – c’est ainsi qu’à proprement parler je devrais les nommer – furent sollicités séparément et ne surent jamais que je les consultais chacun pour sa part. Ce sont des hommes dont j’estime au plus haut point les vues sur la littérature et sur la vie. Ils avaient tous deux lu Ulysse et, évidemment, étaient totalement étrangers à la présente affaire. Sans leur laisser connaître, ni à l’un ni l’autre, ma propre opinion sur la décision que je devrais rendre, je leur ai soumis la définition légale du mot obscène et leur ai demandé à chacun si, selon son opinion, Ulysse entre dans le cadre de cette définition.
Il est remarquable que chacun des deux ait eu la même opinion que moi : Ulysse dans sa totalité, doit être lu comme une œuvre expérimentale qui ne manifeste aucune tendance à provoquer des pulsions sexuelles ou des pensées luxurieuses, l’effet certain qu’il eut sur eux fut seulement celui d’une sorte de tragique et puissant commentaire sur la vie intime des hommes et des femmes.
C’est uniquement au regard d’une personne ordinaire qu’il faut rapporter la prescription de la loi. Un test comme celui que je viens de décrire est le seul test approprié pour mesurer l’obscénité éventuelle d’un livre comme Ulysse, lequel est une tentative sincère et sérieuse de concevoir une nouvelle méthode littéraire d’observation et de description de l’humanité. Je suis tout à fait conscient de ce que certaines de ses scènes font d’Ulysse un courant qu’il est impossible à des âmes sensibles, quoique normales, d’emprunter. Mais tout bien considéré, et après longue réflexion, mon opinion est que, bien que par nombre de ses développements l’effet d’Ulysse sur le lecteur soit indubitablement et pour le moins émétique, nulle part en revanche il ne cherche à être aphrodisiaque. Ulysse devrait donc être admis aux Etats Unis. »
Traduit de l’anglais américain par Pascal Mbongo/Tous droits réservés/Les traductions sont protégées par le code de la propriété intellectuelle
Tags : Liberté d’expression – Littérature – Justice – Censure – Esthétique – Linguistique – Autofiction – Ulysse – Madame Bovary – James Woolsey – Joseph Pinard – Christine Angot – Camille Laurens – Marcela Iacub – Nicolas Genka – Rose Bonbon – Jacques Chessex – Alain Robbe-Grillet – Mathieu Lindon – Nathalie Heinich.
“My government will bring forward proposals for a British Bill of Rights”. Cette phrase est extraite du discours prononcé par la Reine d’Angleterre devant le parlement britannique le 27 mai 2015 en ouverture de la nouvelle législature[1].
I.
La portée politique de cette phrase a été explicitée par le Premier ministre David Cameron dans son introduction au bréviaire explicatif du discours de la Reine, soit un document publié par le Ministère de la Justice : il s’agit, avec les propositions britanniques sur l’Union européenne et le référendum sur le maintien ou non dans l’Union, de donner au Royaume-Uni « plus de contrôle sur ses propres affaires ». De manière sans doute moins évidente, le Premier ministre David Cameron a présenté cette volonté « souverainiste » (souveraineté de l’état britannique et souveraineté du parlement britannique) comme étant l’interface de la politique de « sécurité » que son Gouvernement entend mener (“we will keep peope safe”), avec l’annonce de trois grands textes législatifs : une loi sur l’extrémisme (Extremism Bill) ; une loi sur les « pouvoirs d’enquête » (Investigatory Powers Bill) ; une loi sur les services de police et la justice pénale (Policing and Criminal Justice Bill).
II.
Le parti conservateur britannique fait preuve d’une très grande constance, non seulement à critiquer la Cour européenne des droits de l’Homme mais à vouloir soustraire le Royaume-Uni de la tutelle de la Cour. Cette ambition était déjà inscrite, en effet, au programme du parti conservateur en vue des élections législatives de 2010, mais sa mise en œuvre avait été empêchée par leurs partenaires de coalition, les libéraux-démocrates. Cette fois-ci, le parti conservateur, avec une majorité de douze sièges, est supposé (on y revient plus loin) pouvoir mettre en œuvre son engagement, avec comme maître d’œuvre le nouveau ministre de la Justice, Michael Gove, dont la sensibilité politique personnelle est assez distante de celle promue en matière de droits fondamentaux par l’Union européenne ou par le Conseil de l’Europe (le ministre britannique de la Justice … défend la peine de mort dans son principe).
Le procès fait à la Cour européenne des droits de l’Homme par les Conservateurs britanniques n’est ni original, ni absurde. Il n’est pas original puisque les arguments en sont partagés par tous les « souverainistes » en Europe et par de très nombreux conservateurs européens (très au-delà des conservateurs hongrois[2]) ‒ pour ne pas même parler des partis dits « populistes ». Même en France, il arrive régulièrement que des propositions de limitation du pouvoir de la Cour soient portées par des parlementaires d’un « parti de gouvernement ».
Ces critiques désignent ce que les juristes sont convenus d’appeler le « dynamisme interprétatif de la Cour », sa conception de la Convention européenne des droits de l’Homme comme un « instrument vivant ». Cette conception a comme conséquence honnie par les Conservateurs britanniques « d’étendre les droits garantis par la Convention à de nouveaux domaines (…) bien au-delà de ce que les rédacteurs de la Convention avaient à l’esprit ». Curieusement, ce ne sont cependant pas toutes les décisions de condamnation du Royaume-Uni par la Cour européenne des droits de l’Homme qui exaspèrent les Conservateurs britanniques. Ce sont certaines décisions seulement, dont la liste s’allonge néanmoins au fil des ans, qui leur servent de marottes. Il n’est pas moins vrai que ces décisions portent pour beaucoup sur les institutions et les politiques de sécurité : le droit de vote des prisonniers, le droit à l’insémination artificielle des prisonniers, l’impossibilité d’éloigner certains étrangers du territoire d’un état membre, même s’ils y ont commis des crimes graves…
Ce en quoi le procès fait à la Cour de Strasbourg par les Conservateurs britanniques n’est pas absurde, c’est dans cette idée que dans des cas comme ceux qui viennent d’être cités, la Cour se substitue aux acteurs politiques investis de la légitimité du suffrage et tenus de rendre des comptes aux électeurs. Or cette substitution est factuellement incontestable. C’est en cela que la critique conservatrice n’est pas absurde. Elle l’est d’autant moins que la Cour elle-même conçoit qu’il existe des questions sur lesquelles la souveraineté des organes élus des états est idéale. C’est ce que la Cour est convenue d’appeler la « marge nationale d’appréciation ». On laisse ici de côté la question très savante de savoir si cette « marge nationale d’appréciation » est une fiction ou non (ainsi que la question de savoir si la Cour élargit ou réduit tendanciellement cette « marge nationale d’appréciation » laissée aux états). Ce qui nous semble assez remarquable c’est que les Conservateurs britanniques raisonnent au fond comme la Cour : les uns et les autres distinguent ce qui serait un territoire du droit et ce qui serait un territoire du politique. Dans les deux cas, l’on présuppose que le droit ne relève que d’une forme de technique, lorsque le politique seul brasserait des valeurs. Il va sans dire que ce présupposé (et même cette idéologie juridique) est plus que paradoxal(e), s’agissant des… droits de l’Homme.
III.
Il reste à envisager la portée juridique de la réforme envisagée du système britannique de protection des droits de l’Homme. L’on est ici en plein clair-obscur. Dans le bréviaire explicatif précité du discours de la Reine, il est simplement écrit : « Le Gouvernement présentera des propositions en vue de la substitution d’une Déclaration des droits (Bill of Rights) au Human Rights Act. Cela changera et modernisera notre cadre juridique relatif aux droits de l’Homme et ramènera du bon sens dans l’application des textes relatifs aux droits de l’Homme. Cela protègera les droits existants ‒ qui sont une dimension essentielle d’une société moderne, démocratique ‒ tout en prévenant mieux les abus du système et la mauvaise utilisation des textes relatifs aux droits de l’Homme[3] ».
Il est acquis que le Gouvernement conservateur n’envisage pas de dénoncer la Convention européenne des droits de l’Homme. Afin de ne faire de la Cour européenne des droits de l’Homme qu’une « instance consultative » (sic) pour les juridictions britanniques (et en particulier la Cour suprême) et pour le parlement de Westminster, il fera uniquement abroger le Human Rights Act (texte adopté sous majorité travailliste en 1998), soit le texte « constitutionnel » qui, formellement, définit l’obligation pour les juridictions britanniques de considérer que les décisions de la Cour ont valeur obligatoire à leur égard. Cette abrogation suffira-t-elle ? Rien n’est moins sûr puisque le Royaume-Uni resterait obligé internationalement par l’article 46 de la Convention et que rien ne dit que la Cour suprême voudra reprendre à son compte l’argumentation « souverainiste » des juges britanniques qui a poussé les travaillistes à faire adopter le Human Rights Act.
Il est également acquis que les Conservateurs voudront remplacer l’Human Rights Act par une déclaration des droits (Bill of Rights) qui comprendrait la Convention européenne des droits de l’Homme telle qu’elle était en 1950. Au demeurant, le Gouvernement Cameron dit ne pas vouloir consacrer de « nouveaux droits ». En même temps, il assure vouloir « clarifier » dans la nouvelle loi les droits énoncés dans la Convention des origines, de manière à mieux y articuler les « droits » et les « responsabilités » (autrement dit les « limites des droits »). On voit ce que veulent les Conservateurs britanniques : empêcher que la Cour suprême ‒ après que celle-ci aurait, par hypothèse, admis nouvellement la souveraineté des juridictions britanniques ‒ ne développe une jurisprudence mimétique de celle de la Cour de Strasbourg ou « inspirée » par elle.
IV.
Le parlement britannique adoptera-t-il le projet de loi Cameron-Gove ? En théorie oui, puisqu’il a douze sièges de majorité. En même temps, et de ce que l’on comprend, l’insistance du Premier ministre Cameron à dire que « le mandat des électeurs est clair et sans équivoque » s’agissant des institutions européennes ‒ « toutes les institutions européennes » ‒ est un appel à une discipline de vote des députés conservateurs, et même plus précisément de certains « députés du rang » (backbencher(s)) qui, à la manière très paradoxale du député David Davis ‒ eurosceptique et critique notoire de la Cour de Strasbourg ‒, ont exprimé leurs « doutes ».
Quant à savoir si le départ britannique du système européen des droits de l’Homme ne désinhiberait pas d’autres états, la réponse dominante dans les cercles politiques, médiatiques et académiques est celle qui dit répétitivement que « l’Europe peut se passer des Britanniques » et, incidemment, que l’« Europe des droits de l’Homme » peut se passer de celui des états qui a préséance historique en la matière (même en matière de droits sociaux : ) et de celle des sociétés européennes dont la culture libérale a été beaucoup moins prise en défaut que les autres (la question est toujours discutée : pourquoi la société britannique est-elle en Europe, depuis les Lumières, la seule – avec la société suisse – à n’avoir connu ni « dictature », ni « autoritarisme », ni « totalitarisme » ?). Wait and See!
2015
——–
[1] https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-2015
[2]http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/05/21/les-provocations-de-viktor-orban-genent-les-conservateurs-europeens_4637795_3214.html
[3] « ‘My Government will bring forward proposals for a British Bill of Rights’. The Government will bring forward proposals for a Bill of Rights to replace the Human Rights Act. This would reform and modernise our human rights legal framework and restore common sense to the application of human rights laws. It would also protect existing rights, which are an essential part of a modern, democratic society, and better protect against abuse of the system and misuse of human rights laws ».
La Speedy Trial Clause interdit-elle de juger une personne longuement détenue à l’étranger par la CIA alors que sa mise en cause judiciaire était en cours aux États-Unis ? C’est l’une des trois questions auxquelles la cour fédérale d’appel pour le 2e circuit a répondu par la négative le 24 octobre 2013 dans un arrêt United States of America v. Ahmed Khalfan Ghailani (ci-après : United States v. Ghailani) relatif à une affaire de terrorisme et à un « ennemi combattant ».
Homme orchestre des attentats à la bombe d’Al Qaeda contre les ambassades américaines de Nairobi (Kenya) et de Dar es Salaam (Tanzanie) le 7 août 1998, Ahmed Khalfan Ghailani avait quitté Dar es Salaam vingt-quatre heures plus tôt à destination du Pakistan et ce en compagnie d’autres dirigeants d’Al Qaeda. Après que la plupart des organisateurs avaient été arrêtés, ils furent mis en accusation en 1998 par des procureurs fédéraux, Ahmed Khalfan Ghailani compris, bien qu’il fût en fuite. Ce n’est que le 25 juillet 2004 qu’il fut arrêté. Détenu en dehors des États-Unis pendant deux ans par la CIA, il ne fut transféré à Guantanamo qu’en 2006. Ahmed Khalfan Ghailani fut condamné le 25 janvier 2011 par la cour fédérale pour le district sud de New York à une peine de prison à vie pour les attentats de 1998, une condamnation que confirme précisément la cour fédérale d’appel pour le 2e circuit en écartant les motifs d’appel tirés notamment d’une violation de la Speedy Trial Clause et du caractère inhumain de la prison à vie.
La première formulation moderne et constitutionnelle du droit d’être jugé dans un délai raisonnable date, en effet, du VIe amendement de la Constitution des États-Unis (1791) en tant qu’il dispose que dans toutes les poursuites pénales, l’accusé devra notamment bénéficier du droit d’être jugé rapidement (the right to a speedy trial). « Amorphe », « glissant », « nécessairement relatif » selon les mots de la Cour suprême (Barker v. Wingo, 407 U.S. 514, 522 [1972] ; Vermont v. Brillon, 556 U.S. 81, 89 [2009]), ce droit l’est d’autant plus qu’il a constamment été soutenu qu’il participe autant d’un intérêt du mis en cause en matière pénale que d’un intérêt social, ces deux intérêts étant susceptibles d’entrer en conflit. Du point de vue du mis en cause, la Speedy Trial Clause est ainsi vouée à « empêcher l’incarcération injustifiée et oppressive avant le procès, [à] minimiser l’anxiété et la préoccupation induites par une mise en cause publique et [à] limiter la détérioration de la capacité d’un accusé à se défendre » (United States v. Loud Hawk, 474 U.S. 302, 312 [1986]). La société pour sa part gagne à voir des mis en cause être rapidement jugés afin d’empêcher un arriéré d’affaires susceptible ou bien de permettre à de « dangereux criminels » de rester sans surveillance durant de longues périodes de libération sous caution, ou bien de retarder la réinsertion des mis en cause, ou bien de gêner de quelque manière la justice pénale (dixit l’arrêt commenté ; Barker v. Wingo, 407 U.S. 519 [1972]).
La nécessité de concilier l’intérêt du mis en cause et celui de la société (Beavers v. Haubert, 198 U.S. 77, 86 [1905] ; United States v. Ewell, 383 U.S. 116, 120 [1966]) aura donc déterminé les quatre critères définis par la Cour suprême comme devant être pris en compte dans l’évaluation d’un délai raisonnable de jugement, soit : la longueur du retard ; les raisons du retard ; le fait pour le mis en cause de s’être formalisé ou non du retard lors de la période antérieure au procès ; l’existence d’un préjudice découlant pour le mis en cause du fait de n’avoir pas été jugé plus vite (United States v. Cain, 671 F.3d 271 (2012) : “(1) the length of the delay; (2) the reasons for the delay; (3) whether the defendant asserted his right in the run-up to the trial; and (4) whether the defendant was prejudiced by the failure to bring the case to trial more quickly.”).
Comme le rappelle la cour fédérale d’appel pour le 2e circuit dans l’arrêt commenté, le premier critère est une question de seuil puisque « par définition, un défendeur ne peut pas se plaindre de ce que le gouvernement l’a privé d’un procès rapide si, en fait, la poursuite s’est faite avec la promptitude usuelle ». Dans cette mesure, les autres critères ne devraient être envisagés que si le mis en cause peut établir que « l’intervalle entre l’accusation et le procès a dépassé le seuil distinguant un retard ordinaire d’un retard ‟présomptivement préjudiciable” ». Rien n’est cependant moins défini que ce qui est presumptively prejudicial (United States v. Vassell, 970 F.2d 1162, 1164 [2d Cir. 1992]) même si l’arrêt rapporte l’inclination de différentes juridictions fédérales à considérer qu’au delà d’un an entre la mise en accusation et le procès, il y a à se poser des questions. Quant au quatrième critère – celui tiré du préjudice pour le mis en cause −, pour être régulièrement éprouvé par les juges, dont ceux de la Cour suprême (Doggett v. United States, 505 U.S. 647, 654 [1992] ; Reed v. Farley, 512 U.S. 339 [1994]), il est relativement fébrile dans la jurisprudence fédérale. Certains juges sont en effet enclins à considérer que la Speedy Trial Clause « est faite pour minimiser la possibilité de longue incarcération avant le procès, pour réduire la restriction de liberté imposée à un accusé libéré sous caution – une restriction qui, pour être limitée n’en est pas moins substantielle – pour abréger la perturbation de vie causée par l’arrestation et le poids de poursuites pénales non résolues » (opinion du Chief Justice Warren E. Burger, United States v. MacDonald, 456 U.S. 1 (1982), au point 8). Dans cette perspective, le préjudice découlant pour le mis en cause d’un long écoulement de temps avant le procès ressortirait plutôt des dispositions constitutionnelles relatives au Due Process et des dispositions législatives relatives aux délais de prescription des infractions ou des poursuites.
Somme toute, la Speedy Trial Clause génère beaucoup moins de contentieux que d’autres provisions de « droit processuel » du Ve et du VIe amendement. L’explication tient à l’existence de lois fédérales − spécialement le Speedy Trial Act (1974) − qui inscrivent les étapes successives de la procédure pénale fédérale dans des délais précis et souvent sanctionnables par des nullités.
———-
(*) Voir notre étude : « Procès équitable et Due Process of Law », in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 44, 2014.
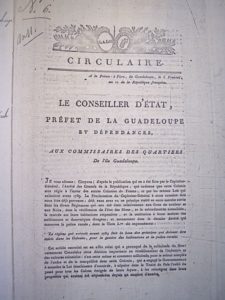
Des esclaves dangereux pour la tranquillité des colons. Les archives de notre justice pénale regorgent des procès ayant eu cet objet, spécialement dans la période qui a séparé l’abolition de l’esclavage en métropole et son abolition dans les colonies (1848). Il en a déjà été question ici avec l’affaire du colon Prus. Il en est nouvellement question avec l’affaire Douillard-Mahaudière.
I. Verbatim de l’affaire à la Gazette des tribunaux du 17 février 1841.
« M. Douillard-Mahaudière, propriétaire, demeurant à l’Anse-Bertrand, avait perdu successivement sa femme, 3 nègres, 1 négresse, et 281 têtes de bétail.
« Il attribua ses pertes à l’empoisonnement.
« Ses soupçons se portèrent sur Lucile, une de ses esclaves, parce qu’il avait consulté un devin, et qu’une autre esclave avait révélé la culpabilité dans l’œuvre du magnétisme.
«Fort de ces preuves, Douillard-Mahaudière, la fit jeter vivante dans une espèce de tombeau, présentant une grande ressemblance avec le tumulus antique.
« Il lui signifia qu’elle n’en sortirait que morte.
« Le cachot que Lucile était condamnée à ne plus quitter était entièrement privé d’air et de lumière ; elle ne pouvait s’y tenir que le corps courbé en deux ; elle couchait sur un plancher nu, superposé à la terre, au milieu des insectes dévorants des tropiques.
« On l’avait attachée, par ordre de son maître, à une barre de fer où se trouvaient deux jambières. Sa jambe et sa main gauche furent enfermées dans la même jambière ; sa main droite, placée dans un anneau mobile : elle passa une année entière dans cette cruelle position. Son embonpoint fit place à une affreuse maigreur, qui lui permit de retirer sa main gauche de la jambière; mais elle fit de vains efforts pour en retirer sa jambe.
« Un jour cependant, ayant senti une bête à mille pieds lui dévorer les chairs, elle parvint, excitée par la douleur, à se dégager en arrachant la pierre à laquelle sa chaîne était scellée. Découverte le lendemain, elle fut, par l’ordre de son maître, enferrée de nouveau.
« Le poids de son corps, reposant toujours sur les mêmes parties, elle était obligée de se servir de son bras droit comme point d’appui.
« On entrait une fois par jour, dans son cachot, à des heures inégales, pour lui apporter une petite quantité de farine de manioc, et de morue, qui représentait à peu près la moitié de la ration ordinaire d’un seul repas des nègres. L’infortunée serait morte d’inanition, sans l’humanité d’un nommé Lapierre et de Félicité, sa fille, qui, en apportant du linge blanc à sa mère, y cachait des aliments. Pendant seize mois, elle fut soumise à une privation non moins cruelle ; on lui donnait une ration d’eau si faible, qu’elle ne pouvait étancher sa soif.
« La justice fut informée qu’une esclave périssait dans le cachot de l’habitation Douillard-Mahaudière ; elle y fit une descente : les faits furent constatés, et des poursuites commencèrent.
« Néanmoins, elles furent suspendues et n’auraient pas été continuées, si le colon avait consenti à la déportation de son esclave ; mais il s’y refusa, pensant n’avoir usé que de son droit. »
Pour imprimer à ce récit fabuleux, qui nous reporterait à la barbarie du moyen âge, un caractère d’authenticité, le correspondant particulier de la Gazette des Tribunaux l’a étayé d’un acte d’accusation, d’un interrogatoire de l’accusé, et de dépositions de témoins. En regard des faits et de la procédure ainsi présentés, il a placé le verdict d’acquittement de la Cour d’assises de la Pointe-à-Pitre, l’ovation de l’accusé et de son avocat, portés en triomphes par les colons.
« La Cour se retire d’abord pour poser les questions et les résoudre. Elle revient ensuite avec un verdict d’acquittement. Les colons en masse se précipitent vers M. Grandpré, dont ils pressent avec effusion la main. Douillard-Mahaudière est enlevé du banc des accusés et transporté jusqu’à l’hôtel des Bains, situé en face le Palais de Justice. Bientôt après, il monte dans son cabriolet et parcourt les rues de la Pointe-à-Pitre. Ses amis se portent en foule devant la maison du défenseur, et là crient avec enthousiasme : Vive Grandpré ! »
À la tête de ces messieurs on remarquait un conseiller colonial et vice-président de cette assemblée » (Gazette des Tribunaux du 17 février.)
II. La défense rétrospective de Douillard-Mahaudière (et des colons esclavagistes) par Adolphe Jollivet, député.
Le but de mon Précis est d’établir que tous les faits imputés à M. Douillard-Mahaudière sont faux, à l’exception de la détention de Lucile, dont j’expliquerai la cause et la durée.
Que le correspondant particulier de la Gazette des Tribunaux a tronqué l’acte d’accusation ; qu’il a dénaturé l’interrogatoire ; qu’il a altéré les dépositions ; qu’il en a supprimé treize en entier, parce qu’elles étaient favorables à l’accusé (1). Ce n’est pas dans des correspondances particulières, que j’irai chercher mes preuves ; je les trouverai exclusivement dans un acte authentique, dans le procès-verbal des séances de la Cour d’assises, signé par le président et parle greffier,| et dont j’ai pris connaissance au ministère de la marine.
Il est vrai que M. Douillard-Mahaudière a fait détenir, pendant 22 mois, son esclave Lucile. Personne ne le conteste, mais il faut qu’on connaisse les causes de cette détention prolongée. M. Douillard avait perdu sa femme ; sa mort fut généralement attribuée au poison. Il perdit depuis entre 1837 et 38, trois noirs et une négresse. Il perdit également 63 boeufs, 38 mulets, 30 vaches et génisses, 160 moutons. Il fut constaté que ces pertes avaient pour cause le poison. Plusieurs circonstances attirèrent les soupçons sur Lucile, que M. Douillard venait de refuser d’affranchir. On va juger si ces soupçons étaient fondés.
Le 9e témoin entendu devant la Cour d’assises, Philippe, a déposé :
« Que Lucile avait cherché à l’accuser d’empoisonnement; qu’elle lui avait dit plusieurs fois que toute petite qu’elle était, elle était capable de faire périr quelqu’un à qui elle en voulait; que tout le monde sur l’habitation la regardait comme sorcière et prophète (synonymes d’empoisonneuse), et qu’il a toujours pensé que Lucile est une empoisonneuse. »
Les 15e, 16e, 17e, 18e et 19e témoins, Adrienne, Marie-Thérèse, Annette, Madeleine et Andrèze, déposent que «pendant que Lucile était au cachot, l’habitation n’a fait aucune perte; que Lucile était détestée par l’atelier à cause de sa mauvaise langue, et que tout le monde disait que c’était une empoisonneuse. »
Le correspondant particulier de la Gazette des Tribunaux a supprimé en entier les dépositions de ces cinq témoins ; il ne lui convenait pas qu’on sût que Lucile passait aux yeux de tous pour une empoisonneuse.
Il ne lui convenait pas qu’on sût que les empoisonnements ont continué tant que Lucile a été libre ;
Qu’ils ont cessé dès qu’elle a été détenue.
Le 32e témoin, M. Barbotteau, propriétaire, a déposé « que M. Douillard-Mahaudière perdait beaucoup de bestiaux, et que ces pertes n’ont cessé que depuis l’incarcération de Lucile. »
Pour infirmer son témoignage, le correspondant particulier imagine de le faire parent de l’accusé, ce que ne constate pas et ce qu’eût constaté le procès-verbal d’audience, si cette parenté eût été réelle.
Le 23e témoin, madame veuve Théophile, rentière, dépose « que pendant qu’elle donnait des soins à la dame Douillard-Mahaudière, gravement malade au Port-Louis, elle a vu venir Lucile deux ou trois fois chez sa maîtresse, mais que celle-ci paraissait la recevoir avec répugnance. Le témoin ignore la cause de la maladie de la dame Douillard ; seulement elle a entendu dire dans le public qu’elle est morte empoisonnée ; mais on ne lui a jamais dit que ce fût par suite du poison que lui avait donné Lucile.
« Lucile interpellée déclare d’abord qu’elle n’est point allée au Port-Louis pendant la maladie de la dame Douillard-Mahaudière ; ensuite elle dit qu’elle y est allée deux fois ; elle sait aussi que lorsque sa maîtresse est morte, les domestiques de la maison, et notamment Annette, l’ont accusée de l’avoir empoisonnée, mais que tout cela est faux. »
L’opinion générale que Mad. Douillard-Mahaudière était morte empoisonnée, la répugnance que son approche causait à Mad. Douillard, les tergiversations de Lucile, sa dénégation d’avoir approché de sa maîtresse malade, l’aveu qu’elle en fait ensuite, les accusations de tous les domestiques portées contre Lucile…..
Voilà ce qui résulte de la déposition de Mad. veuve Théophile et des réponses de Lucile.
Le correspondant a supprimé en entier la déposition de Mad. veuve Théophile, et des réponses de Lucile.
Le 24e témoin, Cherat-Franville, propriétaire à l’Anse-Bertrand, dépose « qu’il a assisté aux derniers moments de la dame Douillard-Mahaudière ; tout le monde disait alors que Lucile avait empoisonné sa maîtresse. La dame Douillard en était convaincue ; on le disait à M. Douillard-Mahaudière, qui ne voulait pas croire au poison. » Le correspondant a supprimé cette déposition.
Le 25e témoin, M. Boisaubin, négociant à la Pointe-à-Pitre (ancien membre du conseil privé) dépose « qu’en 1837, les habitations Bonne-Veine et Douillard-Mahaudière, qui sont limitrophes, étaient dans l’état le plus prospère, mais cette prospérité fut de courte durée, grâce à une société d’empoissonneurs qui vint tenir ses séances à Bonne-Veine.
« Qu’un nègre nommé Pierre, traduit devant la Cour d’assises de la Pointe-à-Pitre, avait été condamné pour cause d’empoisonnement ; que ce nègre, après la condamnation, livra à la justice la liste de ses complices, liste qui fut envoyée par le gouverneur à tous les chefs de division de la colonie; qu’en tête de cette liste figuraient les noms du nègre Louis et de la mulâtresse Lucile; que le nègre Louis fut surpris un jour cherchant à empoisonner un bœuf, mais qu’au moment où il allait faire des révélations, il mourut lui-même dans la même journée, victime du poison ; que des quatre nègres qui avaient arrêté Louis, deux moururent deux ou trois jours après. »
C’est la révélation de Pierre, complice de Lucile ; c’est cette liste sur laquelle figurait son nom, liste adressée par le gouverneur à tous les commandants de quartiers, qui ont amené Douillard-Mahaudière à penser que Lucile était coupable, Douillard-Mahaudière , qui jusque-là (M. Cherat Franville le déclare) ne voulait pas croire au poison, ne pouvait pas se résoudre à accuser Lucile, quoique tout le monde l’accusât.
À la révélation judiciaire faite par un complice, à la dénonciation officielle du gouverneur, qui certes étaient de nature à agir sur la conviction d’un homme sensé…. le correspondant particulier substitue les révélations d’un devin que M. Douillard- Mahaudière aurait consulté, et des visions magnétiques !
N’est-ce pas là, je le demande, une odieuse plaisanterie ?
L’excusera-t-on parce qu’elle est faite aux dépens d’un colon ?
Comprendra-t-on qu’il se soit rencontré un homme assez pervers pour l’inventer ?
Un journal assez facile pour la publier ?
Dés lecteurs assez simples pour la croire ?
Le correspondant ne s’arrête pas là dans ses inventions— il invente des dépositions.
Déposition du docteur Souques, suivant la Gazelle des Tribunaux :
« Madame Douillard était atteinte d’une maladie organique à laquelle elle a succombé ; elle ne voulait prendre aucun remède ; elle avait une idée fixe, c’était que Lucile l’avait frappée de quelque maléfice. Elle est morte persuadée qu’elle était empoisonnée ; mais le docteur Souques n’a rien observé qui justifiât cette idée qui était chez elle une monomanie. »
La déposition du docteur Souques recueillie par le greffier ne dit pas un mot de ce qu’on lit dans la Gazette.
La variante valait la peine qu’on l’inventât puisqu’elle absolvait Lucile de l’empoisonnement de sa maîtresse morte d’une maladie organique, sans aucun symptôme d’empoisonnement.
On ne prévoyait pas que le ministre de la marine recevrait le procès-verbal authentique des débats de la Cour d’assises, — et que la comparaison de la déposition de la Gazette avec la déposition recueillie par le greffier, constaterait des altérations, des additions criminelles.
On connaît maintenant la gravité des motifs qui ont déterminé M. Douillard à faire détenir Lucile.
Il me reste à dire les raisons qui ont prolongé sa détention.
Douillard n’avait d’autres indices contre Lucile que la révélation de Pierre, condamné pour empoisonnement, la liste sur laquelle le nom de Lucile était inscrit, et l’opinion générale de l’atelier.
Quelque idée qu’on se fasse ici de la justice coloniale, ces indices auraient paru insuffisants pour déterminer une condamnation, même contre une esclave. Lucile déférée aux tribunaux eût été acquittée.
Cependant Douillard-Mahaudière, voyait sans pouvoir l’empêcher, le poison exercer chaque jour, et depuis deux ans, ses ravages sur son habitation.
Quiconque a vécu dans les colonies, sait que les poisons végétaux y abondent ; que les noirs les emploient sans scrupule ; que ces poisons ne laissent après eux aucune trace ; et que la certitude de périr par le poison, intimide les témoins, assure l’impunité.
Exposé dans sa fortune, dans sa famille, dans la personne de ses enfants, sans que les tribunaux pussent lui venir en aide, que devait faire Douillard-Mahaudière?
Un journal (Le Courrier Français du 22 février) lé dit : il fallait qu’il demandât la déportation de Lucile au gouverneur.
Et c’est précisément ce qu’il a fait.
Le 30e témoin, M. Joseph Papin, dépose « que M. le procureur du roi lui a dit à l’Anse-Bertrand qu’il avait promis à l’accusé de faire déporter Lucile. »
Le 22e témoin, M. Ferry, négociant, dépose « qu’il avait été chargé de voir M. le procureur du roi, de la part de M. Douillard-Mahaudière, pour lui rappeler la promesse qu’il lui avait faite de déporter Lucile. »
Enfin, le procureur du roi lui-même, et sa déclaration a été recueillie par la Gazette des Tribunaux des 15 et 16 février, dit ; « Je n’ai pu promettre à l’accusé de faire déporter Lucile, parce que ce droit ne m’appartient pas. C’est une mesure de haute police réservée au gouverneur; j’ai seulement dit à Mahaudière :
« Si vos soupçons contre Lucile se vérifient, je promets d’appuyer votre demande en déportation. »
Douillard-Mahaudière, a, comme le prouve le témoignage de M. Ferry, fait rappeler au procureur du roi sa promesse, sinon de déporter, du moins de faire déporter Lucile par le gouverneur. Il a employé d’autres intermédiaires auprès du gouverneur, mais n’en a jamais reçu que des réponses évasives. Pouvait-il, en attendant la déportation qu’il sollicitait avec persévérance, mettre en liberté celle qu’il avait lieu de croire l’auteur de la mort de sa femme, de ses esclaves, la cause de sa ruine ?
Veut-on savoir le motif qui a empêché le gouverneur d’accorder la déportation? Ce n’est pas l’absence de pouvoirs :
Ils sont écrits dans l’ordonnance du 9 février 1827, article 75, qui permet « aux gouverneurs des Antilles, de Cayenne et de Bourbon, d’envoyer au Sénégal les « esclaves reconnus dangereux pour la tranquillité des « colonies. »
Si le gouverneur de la Guadeloupe n’a pas usé de ses pouvoirs, s’il a refusé la déportation de Lucile, c’est qu’il a craint la presse, la tribune métropolitaine. Il a craint qu’on ne représentât toute déportation comme un acte arbitraire, tyrannique, alors même qu’elle rétablirait la sécurité dans la colonie, ou que, comme celle de Lucile, elle assurerait le salut d’une habitation.
J’ai dit les causes qui ont prolongé la détention de Lucile, détention connue de l’autorité locale, du maire, témoin entendu dans le procès, et qui a déclaré l’avoir approuvée, également connue du procureur du roi et du gouverneur, puisque M. Douillard-Mahaudière leur avait démandé de la convertir en déportation.
Si la justice a été informée qu’une esclave périssait dans le cachot de l’habitation Douillard-Mahaudière (expressions du correspondant), c’est donc Douillard-Mahaudière lui-même qui l’a fait connaître à la justice. Voyons enfin ce qu’était ce fameux cachot qu’on a comparé à un tombeau destiné à engloutir des victimes vivantes.
Ce n’est pas sans raison que le correspondant de la Gazette a toujours employé l’expression de cachot, qui, chez nous, dans son acception usuelle veut dire prison souterraine: et simple prison ou salle disciplinaire aux colonies.
Il n’y a point de prison souterraine sur les habitations des colons, et la prison de l’habitation Douillard était comme toutes les autres, au niveau du sol.
Le premier témoin, le docteur Souque dépose, que « le cachot de l’habitation Douillard-Mahaudière est « établi dans de bonnes conditions, et qu’il ressemble « à ceux de toutes les autres habitations. »
Le 31e témoin, M. Clavier, dépose « que le cachot de M. Douillard-Mahaudière est infiniment meilleur que celui de Fleur-d’Epée où l’on enferme de braves soldats.
Le juge d’instruction appelé à l’audience en vertu du pouvoir discrétionnaire, déclare que l’air pénétrait dans le cachot qui ne fermait pas hermétiquement.
L’acte d’accusation même reconnaît que le cachot était éclairé par une ouverture haute de 83 centimètres, large de 50 centimètres.
Maintenant croira-t-on que le correspondant ait eu la hardiesse de fabriquer un interrogatoire, et de mettre dans la bouche du président de la Cour d’assises ces paroles : Douillard-Mahaudière « votre cachot est affreux ; pas d’air, pas de soupiraux; c’est une tombe destinée à ensevelir des personnes vivantes !
Le 4e témoin, Albert, commandeur de l’habitation, dépose « que c’est lui qui a enferré Lucile, mais que la main gauche était à côté de la jambe gauche dans un anneau séparé et non au-dessus. »
Le témoin ajoute « que si son maître lui avait donné l’ordre de gêner la main gauche de Lucile, c’était pour l’empêcher de s’étrangler, mais que lui, Albert, qui connaissait bien Lucile, savait que ce n’était pas au monde à s’étrangler; aussi lorsque huit jours après il revint au cachot voir Lucile par ordre de son maître, il la trouva libre de ses fers, et ne fit rien pour l’enferrer de nouveau.
« Tous les huit jours son maître l’envoyait au cachot pour savoir comment Lucile y était, et il lui répondait : bien! La seconde porte du cachot n’était jamais fermée, et au-dessous de celle qu’on fermait on faisait passer à Lucile du linge et des aliments. Lucile avait un réchaud; elle faisait sa cuisine; elle avait deux draps et un traversin fait avec de la bagasse; elle couchait sur un plancher en madriers.
« Chaque fois que le témoin est entré, il l’a trouvée cousant et faisant du linge ; enfin elle n’a pas gardé ses fers plu® de huit jours et elle a constamment reçu les aliments et l’eau nécessaires à sa subsistance. »
Lucile confrontée avec le témoin et interpellée de s’expliquer sur chacun des faits qu’Albert venait de déclarer, répond que ces faits sont vrais.
Le correspondant altère la déposition du commandeur Albert.
Albert a dit que son maître l’envoyait au cachot pour savoir comment Lucile y était.
Il transforme cet acte d’humanité en un acte de sévérité, fort habilement, par l’addition d’un seul mot; voici sa version :
Mon maître m’envoyait au cachot pour savoir comment Lucile y était ferrée !
Quant aux aveux si importants de Lucile, qui renversent de fond en comble l’odieux échafaudage de l’accusation; qui démentent les descriptions mélodramatiques du tumulus, de l’affreux cachot sans air, sans soupiraux; l’enchaînement pendant une année entière ; l’histoire de la bête à mille pieds ; la privation d’eau et de nourriture : le correspondant de la Gazette a cru devoir les passer sous silence.
Le 14e témoin, Lapierre, propriétaire, dépose « que Célina, fille de Lucile, lui a dit qu’elle était chargée de vendre du fil, des bretelles et des chemises que sa mère faisait dans son cachot.
Lucile interpellée avoue ce fait, et convient qu’elle voyait assez clair dans son cachot pour y travailler, mais seulement lorsqu’il n’était fermé que par une seule porte.
Déposition de M. Lapierre ; aveux de Lucile supprimés par le correspondant.
Le 10e témoin. Petit François, dépose « qu’il a été chargé d’apporter la nourriture à Lucile; que celle-ci n’avait plus de fers aux mains, le second ou le troisième jour; qu’elle faisait sa cuisine dans son cachot, et qu’elle y travaillait à la couture.
La déposition de Petit-François est supprimée par le correspondant de la Gazette.
Le 11e témoin, Alfred, dépose « qu’il a été chargé de porter à Lucile sa nourriture, et que lorsqu’elle était dégoûtée de sa nourriture ordinaire, il lui portait de temps à autre du pain, du bouilli, du poisson mariné, et du vin; que ces douceurs provenaient tantôt de la libéralité de son maître, tantôt de celle de la ménagère de la maison; que Lucile recevait aussi des aliments de ses enfants par le dessus de la porte du cachot, où la main et le bras pouvaient facilement passer. »
Lucile interpellée de s’expliquer, dit que ces faits sont vrais; mais elle soutient que les douceurs qu’elle recevait dans son cachot, ne lui étaient point apportées par Alfred, mais par sa fille Félicité.
Le correspondant de la Gazette des Tribunaux a altéré une partie de la déposition d’Alfred et supprimé en entier les aveux de Lucile.
Mais s’il supprime les dépositions favorables à M. Douillard-Mahaudière, en revanche il crée des interpellations et des réponses dans le but de l’incriminer. Il suppose que M. l’assesseur Corneille aurait demandé au témoin Saint-Germain :
– Peut-on rester debout dans le cachot ? Vous par exemple ?
– Réponse. Non.
– Demande. Et Lucile?
– Réponse. Non plus, elle ne pouvait y rester que courbée.
– M. le Président. Greffier, prenez note de cette déclaration du témoin.
Demandes de l’assesseur, réponses du témoin, injonction du président au greffier ; tout cela est faux, et la fausseté est établie par le procès-verbal officiel des séances tenu par le greffier, signé par le président, et qui garde sur cet incident imaginaire le silence le plus complet.
L’interrogatoire est caricaturé de la manière la plus indigne, pour déverser à la fois le ridicule et l’odieux sur M. Douillard-Mahaudière.
On lui fait demander par le président s’il avait assigné un terme à la sépulture de cet être humain.
Réponse. Aucun.
Demande. Vous êtes-vous informé de Lucile pendant sa détention ? , Réponse. Jamais.
Demande. La visitiez-vous?
Réponse. Je ne l’aurais visitée que pour lui tirer un coup de pistolet.
Demande. Ne reconnaissez-vous pas que votre cachot était affreux ? Ne frémissez-vous pas à l’idée que, par votre ordre, une créature humaine y a été engloutie vivante?
Réponse. (L’accusé agile son éventail, et se fait verser de l’eau sur la tête.)
Demande. Vous ne voulez donc pas répondre?
L’’accusé vivement et comme se réveillant: Oui ! oui ! (hilarité.) »
N’est-il pas évident que ce prétendu interrogatoire, dont on ne trouve aucune trace dans le procès-verbal officiel, a été fabriqué dans le but de représenter M. Douillard-Mahaudière comme un monstre chez qui l’imbécillité le dispute à la cruauté ?
Douillard un homme cruel.
Tous les témoins ont fait l’éloge de son caractère humain et généreux.
Je n’en citerai que deux.
«M. Nicolai, curé de la paroisse de l’Anse-Bertrand, 2e témoin, « rend hommage à sa bonne réputation et à sa charité envers les habitants malheureux du PortLouis ; c’est, dit-il, le père de ses esclaves et la providence du malheureux de son quartier. »
13e témoin. Félicité, fille de Lucile, « déclare qu’elle et toute sa famille ont été comblées de bienfaits par M. Douillard-Mahaudière. »
Tel est le caractère de l’homme qui a été odieusement diffamé par un compte-rendu infidèle !
Et dans l’intérêt d’une malheureuse que la voix publique, les révélations judiciaires d’un complice, la dénonciation officielle du gouverneur accusent d’empoisonnement !
Est-ce dans un but philanthropique, par compassion pour une pauvre esclave, qu’on a tronqué l’acte d’accusation, caricaturé l’interrogatoire, falsifié, supprimé, inventé des dépositions ; qu’on a représenté les colons comme des maîtres cruels, jetant leurs esclaves dans des cachots, sur les soupçons les plus frivoles, les torturant à plaisir, s’arrogeant sur eux un droit de vie et de mort?
Assurément, non.
Mais on espère arriver de la sorte plus facilement et plus promptement à l’abolition de l’esclavage.
Ce sont là d’indignes calculs, d’odieux moyens.
Je dirai aux abolitionnistes : « Vous voulez dépouiller les colons de la propriété qu’ils ont reçue de leurs pères, que leur ont garantie nos lois !
« Attaquez-la, mais franchement, mais ouvertement, et ne soyez pas étonnés qu’ils se défendent ; mais n’encouragez pas les délations et les correspondances anonymes qui travestissent et calomnient les mœurs coloniales.
Ce n’est pas là, ce n’est pas dans les séances des Cours d’assises qu’on étudie les mœurs d’un pays. étudiez-les dans les récits des négociants, des officiers de marine, des fonctionnaires publics européens qui ont visité les colonies ; ils vous diront tous que les Créoles sont généreux, hospitaliers, pleins de douceur el de bonté pour leurs esclaves; que toutes les rigueurs de l’ancienne législation ont disparu. Que loin d’abuser de leur autorité* ils usent rarement des armes que les lois leur ont données pour la maintenir.
Écoutez les témoignages publics que leur donne le représentant de la métropole près la colonie à laquelle appartient M. Douillard-Mahaudière ;
Il connaît les colons, il a vécu longtemps au milieu d’eux, et sans partager toutes leurs idées, il sait du moins leur rendre justice.
Lisez le discours que M. Jubelin, gouverneur de la Guadeloupe, a prononcé, le 5 janvier dernier, lors de la clôture du conseil colonial :
« En ce qui touche des matières qui intéressent plus profondément les destinées du pays (la question d’émancipation des esclaves), les communications qui vous ont été faites et les documents placés sous vos yeux avaient nettement fixé l’état de la question. L’initiative prise par le gouvernement est d’ailleurs un fait dont personne ne peut méconnaître la signification et la portée. Je désire que les résolutions du Conseil répondent aux exigences de la situation; mais en respectant vos convictions, je persévère dans celles qui ont inspiré mes actes et mon langage.
À chacun son devoir ; le mien était de vous avertir ; je l’ai rempli.
Et mon dévouement à la cause coloniale est d’une date assez ancienne pour ne laisser aucun doute sur la sincérité de mes avertissements, ici comme ailleurs.
« Quoi qu’il en soit, je me plais à reconnaître que vos délibérations ont été généralement aussi calmes que leur objet était grave; d’un autre côté, l’ordre, la paix et le travail n’ont été troublés sur aucun point de la colonie. Votre retour au milieu de vos ateliers continuera à maintenir un état de choses qui honore le pays, et où se révèlent à la fois l’humanité des planteurs et le bien-être du reste de la population. »
Paris, 3 mars 1841.
JOLLIVET, Délégué de la Martinique.
(1) Les dépositions supprimées sont celles des témoins Lapierre, Fapin, Blancourt, Petit François, Adrienne, Marie-Thérèse, Annette, Madeleine, Andrèzc, veuve Théophile, Cherat Franville, Guéry et Michelon.
Adolphe Jollivet, Précis de l’affaire Douillard-Mahaudière, adressé à la Chambre des Députés, 1841.
Première image : Circulaire du préfet colonial de la Guadeloupe du 6 prairial an XI (26 mai 1803) pris en application de l’arrêté consulaire de Bonaparte rétablissant l’esclavage à la Guadeloupe (16 juillet 1802).