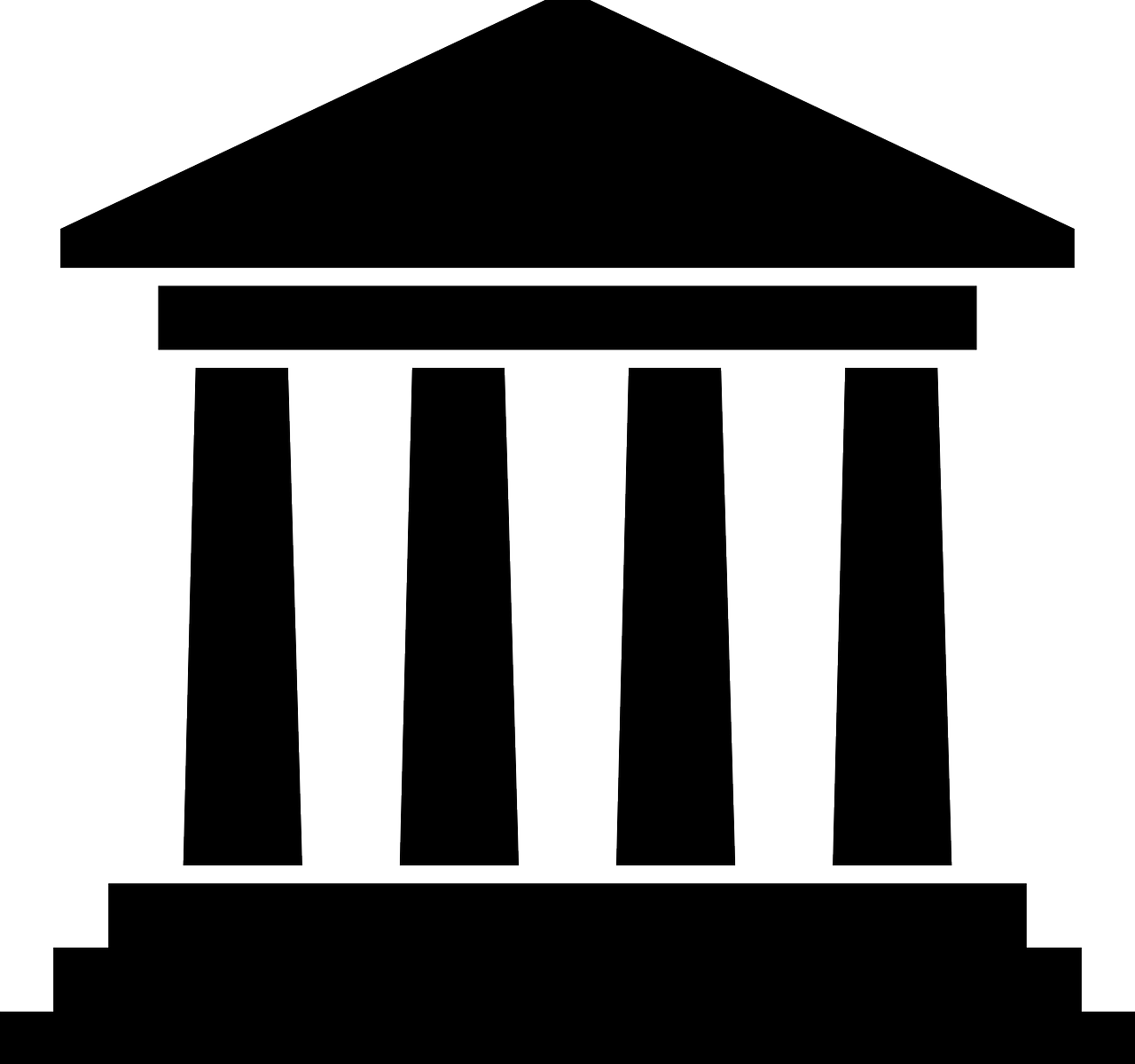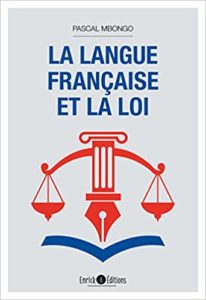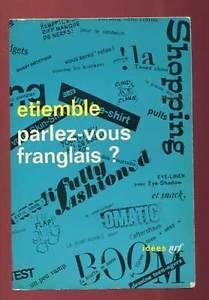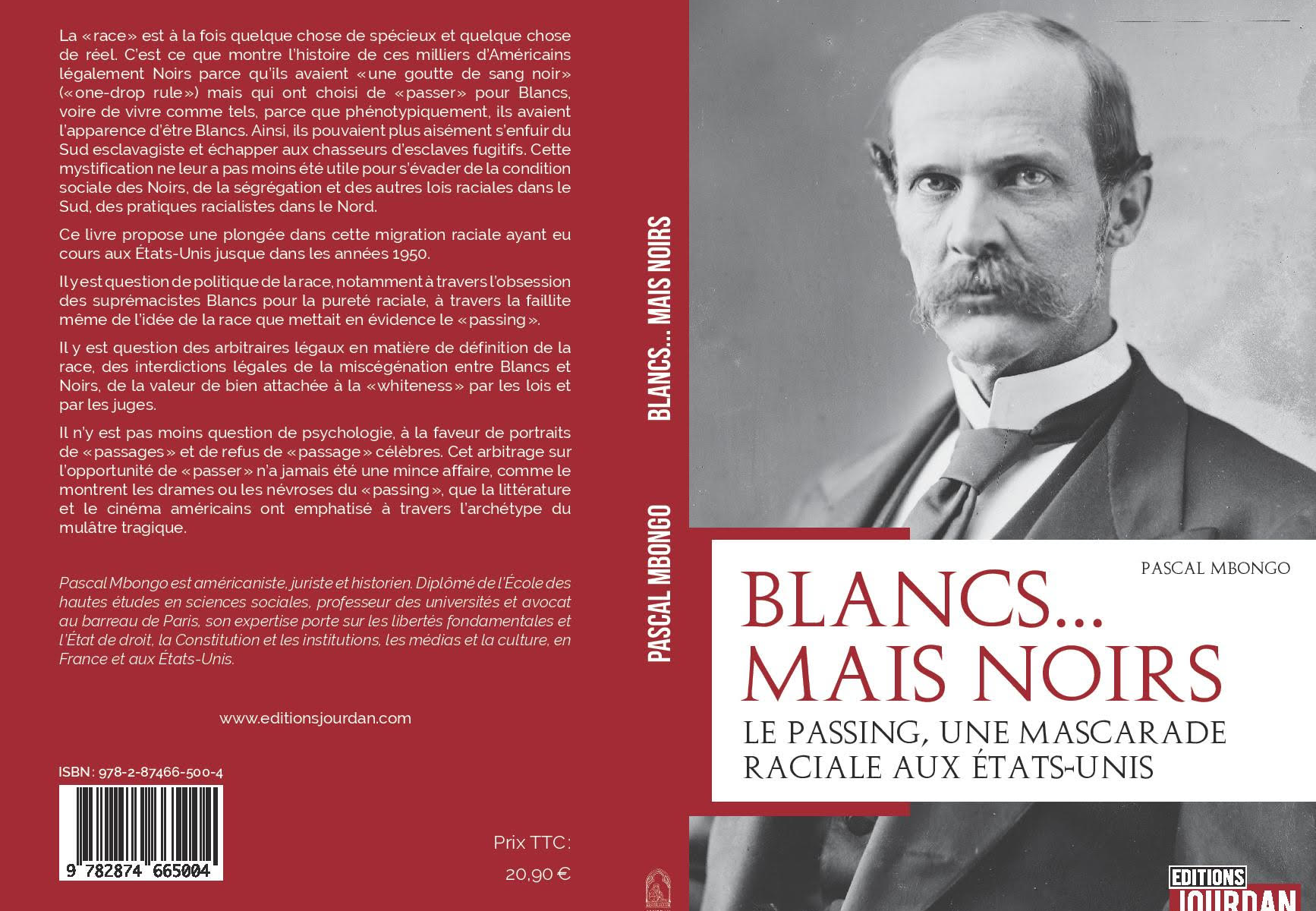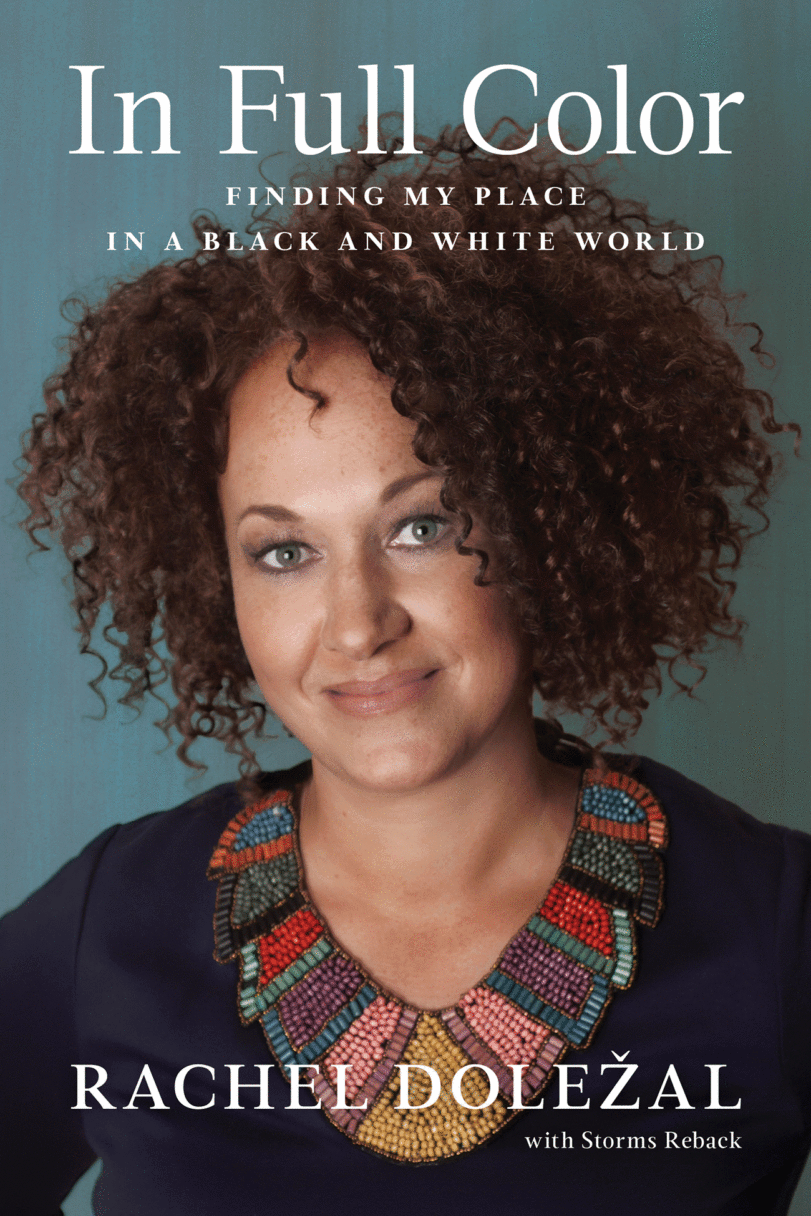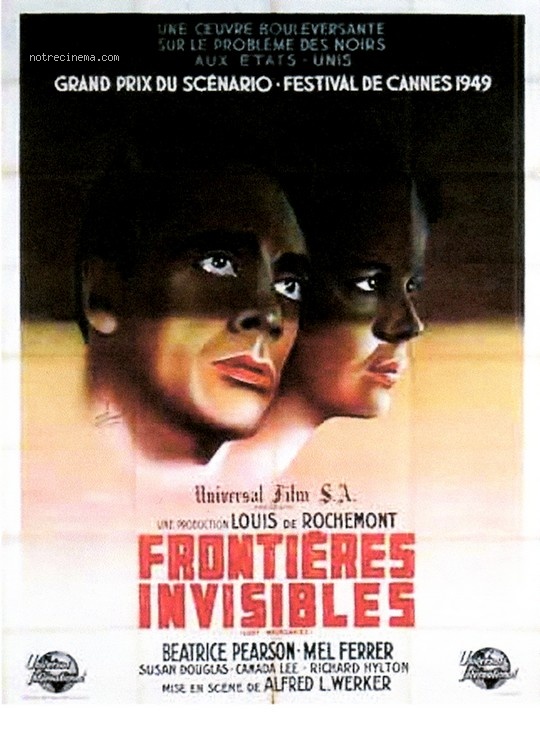[Mlle J. Chauvin vient d’être admise à prêter serment pour exercer la profession d’avocat. C’est un événement sans précédent dans les fastes du barreau. Mlle Chauvin a d’ailleurs réclamé avec énergie ce qu’elle regarde comme un droit. On ne lira pas sans curiosité les pages suivantes, où elle expose ses revendications. Pour de plus amples détails, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage qu’elle a publié chez A. Giard et E. Brière, intitulé : Les Professions accessibles aux femmes.]
La femme avocat
« Recherchant si la mise en pratique de l’admission des femmes à l’exercice de la profession d’avocat ne présenterait pas de graves inconvénients, si des obstacles insurmontables viendraient pas entraver la réalisation de l’idée du progrès en cette matière, on se trouve en présence d’un certain nombre d’objections, dont les plus importantes concernent la qualité de femme mariée, la nécessité où se trouve quelquefois l’avocat de siéger comme juge, et la question embarrassante de savoir si les femmes peuvent en droit faire partie de l’ordre des avocats, alors qu’elles furent exclues des corporations.
Sur la question des complications que pourrait entraîner la qualité de femme mariée, on dit d’abord : La femme, qui ne peut rien faire sans l’assentiment de son mari, ne saurait faire pour autrui ce qui lui est interdit pour elle-même. Mais du motif qui a fait édicter la théorie des articles 215 sq. du Code civil, il semble, au contraire, que l’on doive conclure à la non autorisation de la femme mariée avocat. L’autorisation maritale n’est en effet requise que pour certains actes, pour ceux qui peuvent mettre en péril le patrimoine de la femme; si elle a besoin de l’autorisation du mari pour ester en justice, ce qu’il faut traduire par figurer comme partie dans un procès, c’est parce qu’elle pourrait, dans un procès téméraire, engager et exposer son patrimoine; or, la femme avocat ne saurait mettre en péril ses biens et ceux de sa famille, ni causer préjudice à aucun des siens ; l’avocat n’encourt aucune responsabilité à raison des avis et des conseils qu’il donne ; la femme mariée n’aura donc pas plus besoin de l’autorisation de son mari pour pratiquer au barreau, qu’elle n’en a besoin actuellement pour être admise dans le personnel enseignant de l’Etat ou dans les administrations publiques où on commence à admettre les femmes. Tout au plus, pourrait-on exiger que la femme reçut de son mari l’autorisation de pratiquer, comme la femme qui veut faire le commerce a besoin, aux termes de l’art. 4 du Code de commerce, de l’autorisation générale du mari. Mais ce serait assimiler la profession d’avocat à une profession purement privée, à une profession commerciale, et c’est une profession libérale.
On invoque ensuite un argument tiré de l’art. 214 du Code civil : « La femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider » ; la femme mariée, dit-on, ne peut donc pas être avocat, elle pourrait être contrainte de transporter son cabinet où il conviendrait au mari de fixer sa résidence. Mais cette objection ne s’applique pas seulement à la profession d’avocat ; elle frappe toutes les professions, privées et publiques; il faudrait, si l’on en tenait compte, interdire à une femme mariée d’être médecin, ou pharmacien, ou marchande publique; on devrait exclure du personnel enseignant et des administrations publiques les femmes mariées, qui pourraient se trouver dans la nécessité d’abandonner leurs fonctions pour accompagner leur mari. Enfin le mineur ne devrait pas être admis au barreau, car aux termes de l’art. 374 du Code civil, il est tenu d’habiter avec ses parents.
Une plus grave objection est celle qui se résume ainsi : « Un avocat peut être appelé à compléter le siège du tribunal. Or, la loi a entendu écarter les femmes des fonctions judiciaires, donc la femme ne saurait devenir avocat. »
Cependant ce raisonnement ne semble pas irréfutable : de ce que, en l’état actuel du droit, les fonctions de juge ne soient pas accessibles aux femmes, il ne s’ensuit pas nécessairement que celles-ci ne puissent être avocats; les conditions requises ne sont pas les mêmes dans les deux cas, et on n’a jamais songé à refuser la prestation de serment et l’inscription, soit au stage, soit au tableau, d’un avocat sous prétexte qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour l’exercice éventuel du devoir de suppléance : ainsi, en Belgique, où le barreau est accessible aux étrangers, ceux-ci, bien qu’ils ne puissent être appelés à compléter le siège, peuvent cependant exercer la profession d’avocat. De même, en France, les mineurs sont appelés à plaider, bien qu’ils ne puissent remplir les fonctions de juge. Sur ce point, les femmes pourraient donc être avocats au même titre que les mineurs. Reste la question de l’organisation des avocats en corporation ; l’avocat, dit-on, n’exerce pas une simple profession, le barreau constitue un ordre, et cet ordre est inaccessible aux femmes, l’ordre des avocats est une corporation.
Mais, tandis que, rationnellement, rien n’implique l’idée que l’ordre, cette compagnie jouissant de certains privilèges et soumise à certaines règles, soit uniquement réservé aux hommes, juridiquement, s’il en fut ainsi au moyen âge et jusqu’au dix-huitième siècle, l’édit de 1776 est venu permettre aux femmes de faire partie des corporations. En Belgique., la loi du 11 juillet 1832, qui a créé l’ordre civil et militaire de Léopold, reconnaît aussi aux femmes le droit d’en faire partie et cet ordre renferme plusieurs dignitaires femmes. La difficulté d’ouvrir la corporation des avocats aux femmes n’existerait ainsi ni en fait ni en droit.
Il ne subsiste donc, en dehors de la tradition, aucune bonne raison pour exclure les femmes de la profession d’avocat ; encore, les arguments traditionnels n’ont-ils qu’une faible valeur, au moins en France.
Le temps n’a donc pas marché en vain, il a consacré d’importantes réformes et de réels progrès, en ce qui regarde l’instruction scientifique des femmes et leur accès aux professions libérales. L’esprit de la tradition a été vaincu en cette circonstance par l’esprit de progrès et de justice ; l’opinion publique, trop longtemps égarée, s’est enfin laissé gagner à l’évidence; Molière, qu’il ne faut pas confondre avec le bonhomme Chrysale, ne protesterait pas contre les réformes acquises, puisqu’il voulait «qu’une femme eût des clartés de tout ».
Mais ce qui a été conquis est quelque chose, ce qui reste à obtenir encore est beaucoup. Le principe d’égalité commence à s’affirmer aussi dans l’exercice des connaissances acquises, soutenu par le principe de la liberté des professions ; partout où la tradition n’a pas pris les devants pour s’assurer, dans un texte de loi, un triomphe durable, elle doit céder devant l’esprit du progrès gui, par une interprétation libérale, affirme, en son sens, tout ce qui ne lui est pas formellement dénié ; il provoque déjà des modifications législatives en harmonie avec les principes d’équité et de justice, qui doivent dominer le droit positif et lui servir de règle idéale ».
Jeanne Chauvin, Docteur en droit, Licencié ès lettres (philosophie). Lauréat de la Faculté de droit de Paris. Les Annales Politiques et littéraires, 21 novembre 1897, p. 324-325