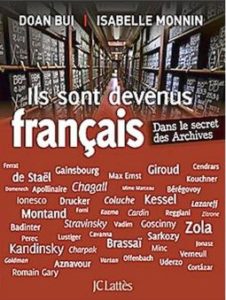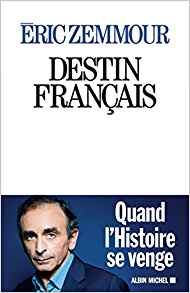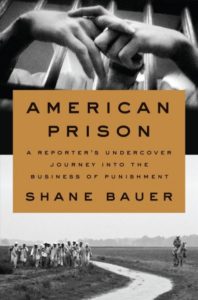Chantal Mouffe, à l’occasion de la parution de son essai, Pour un populisme de gauche (Albin Michel), accorde une interview au Point (27 septembre 2018) dans laquelle au détour d’une définition du peuple, elle aborde la question de l’admissibilité de la Charia en France. À la question « qu’est-ce que le peuple ? », elle répond : « Le peuple n’existe pas en soi. Ce n’est ni un référent empirique ni une catégorie sociologique. C’est une construction politique résultant de la création d’une chaîne d’équivalences entre les demandes démocratiques, celles de la classe ouvrière mais aussi celle des féministes, des LGBT, des immigrés, des chômeurs, des défenseurs de l’environnement, de la lutte antiraciste… Le populisme de gauche construit un « nous » transversal qui doit pouvoir articuler toute une série de demandes en vue de radicaliser la démocratie ». « Au nom de cette reconnaissance des demandes démocratiques, reconnaissez-vous le droit aux islamistes de réclamer l’application de la charia en France ? », lui demande le journaliste. « La démocratie pluraliste en tant que régime, répond-elle, requiert un « consensus conflictuels », c’est-à-dire un consensus sur les principes éthico-politiques de liberté et d’égalité pour tous, mais aussi la possibilité d’un dissensus sur leur interprétation et la manière de les mettre en œuvre. C’est ce que j’appelle « débat agonistique ». Mais cela n’implique pas la reconnaissance d’un « pluralisme légal » qui permettrait la coexistence à l’intérieur d’une même société de principes de légitimités opposés. Cela signifie qu’il n’est pas possible de réclamer l’application de la Charia en France ». On avait anticipé la mise sur agenda en Europe de cette question de la Charia : aussi lui avait-on consacré le texte ci-après, un texte intéressant le débat américain, paru en 2016 dans les Mélanges en l’honneur de M. François Hervouët.
*
Le 2 novembre 2010, les citoyens de l’Oklahoma ont approuvé à 70,08 % de « Oui » une proposition référendaire (State Question 755 encore appelée Save Our State Amendment) portant portant révision de la Constitution de l’État (Art. VII, section 1)[1] et qui prévoyait nouvellement que les juridictions de l’État ne devront statuer qu’au regard de la Constitution fédérale, de la Constitution de l’État, des lois et règlements fédéraux, de la Common Law, des lois et règlements de l’État, le cas échéant des lois et règlements des autres États de la fédération américaine. Surtout, ici était le cœur de cette initiative constitutionnelle, il était dit que les juridictions de l’Oklahoma ne tiendraient pas compte « des préceptes juridiques d’autres nations et d’autres cultures », ni du droit international, ni de la Charia. Alors que différents autres États (l’Arizona, la Floride, la Caroline du Sud, l’Utah, l’Indiana, le Texas, le Tennessee) s’étaient préparés à une initiative comparable, leur volonté fut inhibée par le blocage temporaire de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions par la cour fédérale pour le district Ouest de l’Oklahoma (9 novembre 2010), au motif pris de sa violation de la Constitution fédérale. Statuant nouvellement le 15 août 2013, la même cour fédérale de district et le même juge décidèrent du blocage définitif des nouvelles dispositions adoptées par les citoyens de l’Oklahoma[2].
Les initiatives législatives anti-Charia intéressent directement le constitutionnalisme et le pluralisme juridique dans la mesure où l’une des grandes questions éprouvées par les droits constitutionnels et infra-constitutionnels des ordres juridiques « occidentaux » est celle de l’étendue de la reconnaissance qu’ils doivent accorder aux « différences culturelles » ou à la « diversité culturelle », à moins pour eux de cesser d’être des ordres juridiques libéraux-pluralistes[3]. Ces politiques juridiques de reconnaissance suscitent néanmoins des réactions, des rejets, des refus. Le fait est que c’est en matière religieuse[4], et spécialement à propos de l’islam, que cette tension autour des « accommodements » se noue principalement dans la période contemporaine.
I. Présence judiciaire de la Charia
Il a pu être soutenu qu’il existe aux États-Unis un « contexte juridique de relative tolérance voire d’indifférence à l’égard de l’islam »[5]. Cette proposition est induite par la focale choisie par son auteure, soit le « filage » de débats ayant pour échelle le niveau national américain et la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. En réalité l’islam est l’objet dans la société américaine contemporaine de préventions qui doivent beaucoup au souvenir des événements du 11 septembre 2001, combiné à l’existence contemporaine d’un terrorisme domestique aux États-Unis[6]. Au nombre des manifestations de ces préventions[7], il y a donc également le rejet dont la Charia fait l’objet dans une partie de l’opinion ou par certains législateurs et juges, à mesure de l’existence réputée grandissante aux États-Unis de personnes ou d’organisations[8] qui, non seulement sont favorables à la Charia, mais encore œuvrent à sa promotion dans le contexte américain, voire à l’élimination des normes étatiques jugées par eux contraires à la Charia.
A. Intensité relative des invocations judiciaires de la Charia
Le Center For Security Policy a publié le 20 mai 2011 une volumineuse étude rendant compte des « conflits de lois » entre la Charia et le droit des États américains. L’étude concluait ainsi que :
« la Charia est désormais présente dans les décisions des juridictions d’État, en contradiction avec la Constitution et l’ordre public des États. Certains commentateurs ont soutenu qu’il n’y avait guère plus d’un ou deux cas d’application de la Charia par les tribunaux d’État ; toutefois, ce ne sont pas moins de cinquante cas significatifs que nous avons identifié dans le faible échantillon représenté par les décisions publiées des juridictions d’appel des États. D’autres soutiennent péremptoirement que les juges d’État rejettent systématiquement tout droit d’origine externe, et notamment la Charia, lorsqu’elle entre en conflit avec la Constitution des États-Unis ou l’ordre public [public policy] de l’État ; toutefois, nous avons trouvé 15 cas de juridictions de première instance (trial court) et 12 de juridictions d’appel dans lesquels la Charia a été considérée comme étant applicable par le tribunal ». « Les faits sont les faits », ajoutait l’étude, « certains juges rendent des décisions en se fondant sur la Charia même lorsque ces décisions heurtent des garanties constitutionnelles des droits. C’est une importante question et elle doit être l’objet d’un débat public et d’un engament des gouvernants »[9].
Cette étude – qui n’est certes pas favorable à la Charia mais dont la méthode de recherche est valable − répartit les enjeux concernés par cette présence judiciaire de la Charia entre la réglementation et le contentieux du mariage (21 cas), de la garde d’enfants (17 cas), des contrats (5), les principes généraux de la Charia (3), la réglementation par la Charia du droit de propriété (2), le Due Process et l’égalité (1), le mariage et la garde d’enfants (1). Sous bénéfice d’inventaire, ces cas impliquent bien la Charia, celle-ci étant « la réunion des prescriptions de la Sunna et du Coran », la Sunna désignant pour sa part « l’ensemble des hadîth ou traditions »[10]. Cette précision est importante lorsque l’on est avisé de ce que la Charia se prête à une confusion générale entre :
« trois choses : – les différentes formes coutumières d’organisation sociale et de comportement individuel parmi les communautés musulmanes, qui trouvent leur source dans le pays d’origine de chaque communauté mais ont également changé du fait de l’immigration. Les controverses sur ce qu’on appelle les crimes d’honneur et les mariages forcés sont révélatrices de la confusion qui règne ; – les différentes règles formulées par des savants musulmans qui affirment qu’elles sont « rationnelles », en ce sens qu’elles sont dérivées d’un texte, mais sont en fait des normes religieuses créées à l’aide de la méthodologie de la discipline classique du fiqh (…) ; – enfin, les lois des pays d’origine des populations immigrées sous le régime desquelles les individus se sont mariés ou ont passé des transactions financières (…) »[11].
B. Cas exemplaires
Les invocations de la Charia devant les juges se rapportent significativement aux mariages[12] et aux contrats.
1. Les mariages
Soit le cas d’un couple de ressortissants du Maroc résidant dans le New Jersey. Trois ans après leur mariage, l’époux commença de commettre des agressions sexuelles sur la personne de son épouse et de lui imposer des relations sexuelles non consenties, arguant de ce que l’Islam lui donnait la faculté souveraine d’avoir une relation sexuelle avec son épouse aussi souvent qu’il le souhaitait. Après que le couple a divorcé religieusement devant un imam, l’épouse demanda à un juge civil de prendre une mesure de contrôle judiciaire (restraint order) contre son époux. Or le juge de première instance (trial court) décida de ne pas accéder à la demande de l’épouse au motif qu’indépendamment des agressions de l’époux, ce dernier était déterminé par la conviction qu’il tirait de la religion d’avoir le droit de commettre une relation sexuelle non consentie avec son épouse, cette croyance annihilant toute intention criminelle ou délictuelle de la part de l’époux. Cette analyse a néanmoins été déjugée par la cour d’appel (23 juillet 2010) qui a considéré que les croyances religieuses de l’époux ne lui accordaient pas d’immunité au regard du droit pénal du New Jersey[13].
Dans une autre espèce, les juges ont eu à connaître du litige opposant un couple pakistanais ayant vécu maritalement au Pakistan pendant huit années. À la faveur d’un voyage d’agrément en compagnie de l’enfant du couple, l’épouse s’était installée aux États-Unis avec ladite enfant. L’époux avait alors formé une action devant les juridictions pakistanaises afin d’obtenir la garde de l’enfant mais l’épouse s’était interdit de se présenter devant les juges compte tenu de la probabilité de son arrestation pour adultère. La garde de l’enfant ayant été accordée à l’époux par les juridictions pakistanaises, il demanda aux juridictions américaines de reconnaître et de faire exécuter cette décision. Alors que la juridiction de première instance fit droit à la demande de l’époux en arguant de ce que les juridictions pakistanaises avaient tenu compte de l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel décida autrement, sa contestation de l’évaluation de « l’intérêt de l’enfant » par les juridictions pakistanaises allant jusqu’à se demander si « l’intérêt de l’enfant » ne pouvait pas être de vivre dans une « société non-musulmane »[14].
Dans l’État de Washington (qui n’est pas à confondre avec la ville du même nom dans le district fédéral de Columbia), les tribunaux ont eu à connaître du cas d’un couple marié dont l’époux, de nationalité américaine, avait formé un contrat prénuptial, le Mahr[15], rédigé dans une langue (le Farsi) qu’il ne lisait ni ne comprenait. Ce contrat stipulait notamment que l’époux devrait verser à l’avenir une somme de 20.000 dollars à sa future épouse. Et c’est sans avoir été avisé de cette stipulation que le futur époux signa le contrat et épousa religieusement puis civilement sa partenaire. Après avoir été chassée du domicile conjugal quelques mois seulement après le mariage, l’épouse forma une demande de divorce auprès des juridictions de l’État de Washington. La juridiction de première instance enjoignit l’époux de verser la somme de 20.000 dollars à son épouse au motif de l’opposabilité de la stipulation contractuelle du Mahr. La cour d’appel déjugea la juridiction inférieure en faisant valoir que celle-ci aurait dû partir de « principes juridiques neutres » pour déterminer l’applicabilité de la stipulation litigieuse du Mahr. Et ces principes juridiques neutres – soit le droit des obligations de l’État de Washington – exigent un consentement éclairé des parties sur un contrat afin que celui-ci puisse être opposable. Par suite le Mahr était inapplicable en l’espèce puisque les parties n’y avaient pas légalement consenti[16].
2. Les contrats
En matière de contrats, un certain nombre de cas intéressent des arbitrages rendus par des institutions arbitrales à caractère religieux. Tel fut le cas dans une espèce intéressant deux partenaires d’affaires dont le contrat contenait une clause arbitrale renvoyant à une instance arbitrale de caractère religieux. À la faveur d’un désaccord entre les parties sur l’exécution du contrat, les intéressés s’en remirent à une instance arbitrale religieuse et la partie en faveur de laquelle l’arbitrage fut rendu demanda aux juridictions du Minnesota de rendre exécutoire la sentence arbitrale. Or la partie perdante argua devant lesdites juridictions de l’inopposabilité de la sentence dans la mesure où elle aurait été rendue en violation des lois de l’état relatives à la corruption ou à la fraude. Les juges du Minnesota déclarèrent la sentence exécutoire en faisant valoir que la partie perdante aurait dû former une contestation en bonne et due forme de la sentence devant les juridictions de l’état, sur le fondement des lois de l’état et dans le délai spécialement prévu à cette fin par lesdites lois[17].
La Cour suprême de l’Arkansas eut pour sa part à statuer sur une action formée par un imam contre son licenciement par un centre religieux de Little Rock. Ce licenciement avait été prononcé par le Centre sur le fondement du contrat de travail passé avec le plaignant et qui prévoyait que le Centre pouvait résilier ledit contrat par un vote unanime de son comité exécutif et de son conseil d’administration, pour des « motifs légitimes au regard de la Charia », avec un préavis de licenciement de soixante-jours. Le licenciement fut prononcé en l’espèce au regard notamment des conflits et des controverses provoqués au sein des sociétaires du centre religieux par les sermons (khutbas) de l’imam : formellement, le licenciement était justifié par la « désunion et la fitna » provoquée au sein de la communauté religieuse par lesdits sermons, par les allégations « inappropriées et inexactes » contenues dans ces sermons et dirigées « contre certains membres de la communauté avec qui [l’imam a eu] des désaccords personnels », par le caractère « non-musulman » des agissements de l’imam (un-Islamic). L’imam forma une action devant les juridictions de l’Arkansas contre le centre religieux en invoquant la diffamation du centre à son égard, une violation des termes de son contrat de travail et une responsabilité délictuelle du centre. Les intimés ont objecté que les juridictions de l’État ne pouvaient pas statuer sur ce cas en raison du Premier Amendement de la Constitution des États-Unis. Cette objection fut accueillie par la juridiction de fond, puis par la Cour suprême de l’Arkansas[18] qui admit que les juridictions de l’État n’auraient pas pu se prononcer sur l’affaire au regard du Premier Amendement ‒ sachant que l’action en diffamation était déterminante de l’action en violation du contrat et de de l’action en responsabilité délictuelle ‒ sans devoir apprécier la conformité à la Charia du licenciement du plaignant : les allégations contenues dans les lettres d’avertissement, de préavis et de licenciement ayant été faites dans le contexte d’un différend sur l’aptitude de l’appelant à rester imam, fit valoir la Cour, il est difficile de connaître du caractère diffamatoire des allégations litigieuses sans un examen des doctrines religieuses, des prescriptions religieuses, des procédures religieuses intéressant l’aptitude même à être imam, ce que le Premier Amendement interdit aux juges de faire.

II. Réactions législatives anti-Charia
Les propositions normatives anti-Charia consistent, pour certaines, en la dévolution à l’Attorney General de l’État de pouvoirs de contrôle de celles des organisations sociales qui seraient des Sharia Organization(s) et, pour d’autres, en un empêchement de l’applicabilité judiciaire de la Charia.
A. Consistance normative
1. Pouvoirs spéciaux de surveillance des Sharia Organizations
La dévolution de pouvoirs spéciaux de contrôle des Sharia Organization(s) à l’Attorney General de l’État n’est pas moins présentée par le mouvement anti-Charia comme une défense des droits et des libertés garantis par la Constitution des États-Unis et les Constitutions des États. Les promoteurs d’un contrôle des Sharia Organizations(s) prétendent même procéder par imitation du droit fédéral et des conditions d’inscription d’organisations étrangères sur la liste des organisations terroristes tenue par le Département d’État.
D’un État à un autre, la trame rédactionnelle et normative de la proposition législative est la même. L’Attorney General se verrait accorder le pouvoir de désigner une organisation sociale comme étant une Sharia Organization si cette organisation adhère « en connaissance de cause » à la Charia (1), est engagée, a la capacité ou a l’intention de s’engager dans une action terroriste (2) qui menace la sécurité des habitants de l’État (3). Le concept de Sharia Organization est d’autant plus singulier dans ce type de proposition législative que la Charia s’y entend :
« [du] jeu de règles, de préceptes, d’instructions ou de décrets réputés provenir directement ou indirectement d’Allah ou du prophète Mohammed et qui incluent directement ou indirectement l’encouragement de toute personne à soutenir l’abrogation, la destruction, ou la violation de la Constitution des États-Unis ou de l’État [concerné], la destruction de l’existence nationale des États-Unis ou de la souveraineté ou de l’État [concerné] et qui inclut, entre autres méthodes en vue d’y parvenir, le recours probable à une violence imminente »[19].
La labellisation d’une organisation en Shariah Organization supposerait de la part de l’Attorney General qu’il avise d’abord de son intention, et sous le sceau de la confidentialité (en général dans un délai d’une semaine avant la publication de sa décision), le gouverneur, les speakers des chambres et les leaders de la majorité et de l’opposition au sein du parlement de l’État ; qu’ensuite il fasse publier une annonce légale dans un support d’information à forte audience dans l’État. Cette labellisation serait révocable dans certaines conditions par l’Attorney General lui-même – sur la demande motivée de l’organisation ou de sa propre initiative –, par le parlement de l’État ou par une juridiction saisie à cet effet par l’organisation.
Les pouvoirs de l’Attorney General liés à cette qualification de Shariah Organization seraient d’abord des pouvoirs de poursuite pénale de toute personne ayant fourni ou essayé de fournir en connaissance de cause une assistance matérielle ou des ressources à une telle organisation, soit une infraction de nature criminelle (pour parler le langage du droit pénal français) dont la création est précisément envisagée par les propositions de loi en question[20]. D’autre part, l’Attorney General aurait le pouvoir d’exiger de toute institution financière faisant des affaires dans l’État, possédant ou contrôlant des actifs de n’importe quelle Sharia Organization, de bloquer toutes les transactions financières impliquant ces actifs jusqu’à nouvel ordre émanant de lui, du parlement de l’État ou d’un tribunal. Et, n’importe quelle institution financière faisant des affaires dans l’État et qui prendrait conscience de ce qu’elle possède ou contrôle des fonds en rapport avec une Sharia Oganization serait tenue de les consigner et d’en informer l’Attorney General. Ces provisions légales sont généralement assorties d’amendes de l’ordre de 50.000 dollars.
2. Affirmation constitutionnelle ou légale de l’inapplicabilité judiciaire de la Charia
Rédigées suivant le même modèle, les propositions de loi tendant à empêcher l’applicabilité judiciaire de la Charia énoncent pour leur part généralement trois prescriptions. Il est d’abord dit que toute juridiction ou autorité administrative de l’État qui fonde ses décisions sur « tout droit ou système juridique qui ne reconnaîtrait pas aux destinataires de la décision ou aux parties concernées par elle les mêmes libertés fondamentales, les mêmes droits et privilèges garantis par la Constitution des États-Unis et les Constitutions des États » viole l’ordre public (public policy) de l’État[21]. Consécutivement, de telles décisions doivent être considérées par les tribunaux comme nulles et non avenues. D’autre part, les législateurs anti-Charia entendent prescrire qu’est contraire à l’« ordre public » (public policy) de l’État, tout contrat, toute stipulation contractuelle qui prévoirait que les litiges nés de ce contrat ou de cette stipulation seraient résolus par les tribunaux sur le fondement d’une législation ou d’un système juridique qui « comprendrait quelque règle de forme ou de procédure applicable audit litige et qui ne reconnaîtrait pas aux parties les mêmes libertés fondamentales, les mêmes droits et privilèges garantis par la Constitution des États-Unis et les Constitutions des États »[22]. Enfin, et de la même manière, seraient déclaré(e)s contraires à l’« ordre public » de l’État et frappé(e)s de nullité les contrats et les stipulations contractuelles qui désigneraient comme compétentes en cas de litige, des juridictions (des juridictions religieuses par exemple) ou des instances arbitrales fondées sur la base d’une législation ou d’un système juridique qui ne reconnaîtrait pas aux parties « les mêmes libertés fondamentales, les mêmes droits et privilèges garantis par la Constitution des États-Unis et les Constitutions des États ».
B. Principe et limites du pluralisme juridique
Les initiatives législatives anti-charia se prêtent en substance à trois positions : ‒ leur approbation à l’aune du libéralisme repose sur l’idée qu’elles font obstacle à la privation des musulmans Américains ou résidant aux États-Unis des droits garantis par la Constitution des États-Unis[23] ; ‒ leur contestation[24] repose pour sa part sur l’idée que ces textes affectent nécessairement le droit à la liberté de religion des musulmans, quand bien même la Constitution garantit cette liberté aussi bien au chrétien qu’à « l’infidèle, l’athée, ou le croyant en une foi non chrétienne, telle que l’islam ou le judaïsme »[25] ; ‒ une troisième position veut qu’il faille distinguer les règles religieuses susceptibles d’être admises de celles qui ne sauraient l’être au regard de l’ordre public constitutionnel américain[26].
La question ne se pose cependant pas aux juges en des termes aussi « théoriques » puisqu’il leur faut raisonner à l’intérieur d’un certain nombre de contraintes juridiques : d’une part des droits constitutionnels favorables à l’invocabilité judiciaire de la Charia, soit la Contracts Clause (art. I, sect. 10), l’Establishment Clause et la Free Exercise Clause (ier Amendement), l’Equal Protection Clause (xive Amendement), la Due Process Clause (xive Amendement) ; d’autre part la jurisprudence par laquelle la Cour suprême a posé une distinction au sein de la liberté de religion entre le caractère absolu de la liberté de croire (freedom to believe) et le caractère relatif de la liberté de manifester ses convictions ou croyances religieuses (freedom to act)[27].
1. Les droits constitutionnels favorables à l’invocabilité judiciaire de la Charia
La Contracts Clause est opposable aux lois anti-Charia parce que la liberté contractuelle s’entend notamment de la faculté pour les parties de choisir le droit applicable à leurs engagements réciproques[28]. La Due Process Clause l’est également parce que, s’agissant tout au moins des propositions de lois tendant à interdire aux juges de donner effet à des contrats ou à des stipulations contractuelles renvoyant à la Charia, les initiatives législatives en cause ne résolvent pas la question de l’indétermination des frontières formelles de la Charia – une indétermination ressortant de l’absence d’une codification et de l’absence d’un seul et authentique interprète de prescriptions religieuses néanmoins vouées à embrasser tous les aspects de la vie des individus –, ces initiatives étant ainsi « trop vagues » dans leur désignation de la Charia pour que leur application puisse satisfaire aux exigences du Due Process[29]. Le Premier Amendement pour sa part a vocation à être mobilisé sur la question de savoir si les initiatives anti-Charia constituent ou non une discrimination religieuse ; mais il y a aussi la question de savoir si ces initiatives constituent ou non une immixtion des pouvoirs publics dans les questions dogmatiques et disciplinaires internes à une « église », puisque l’autonomie ecclésiastique – qui est analysée comme une garantie fondamentale de la liberté de religion – rend incompétentes les juridictions de l’ordre juridique étatique sur des controverses d’ordre religieux[30], d’où, par exemple, l’inconstitutionnalité d’une immixtion des juges dans les litiges intéressant le recrutement et l’activité des personnels non-laïques des entreprises de conviction religieuse. Cette immixtion n’est possible que pour autant précisément que le litige n’a aucune implication dogmatique (neutral-principles exception), ce qui est théoriquement le cas, notamment, lorsque l’on est en présence de litiges intéressant des droits de propriété d’entreprises de conviction religieuse[31].
2. L’exigibilité de la jurisprudence Reynolds sur la polygamie chez les Mormons
La lecture croisée de l’arrêt de la cour fédérale pour le district Ouest de l’Oklahoma qui a bloqué la loi adoptée par référendum dans l’Ohio et de l’arrêt de la cour d’appel du New Jersey qui statua sur le cas des agressions et du viol excusés par la juridiction inférieure au nom des convictions religieuses suggère que les États (ou le Congrès pour ce qui concerne les juridictions fédérales) ne peuvent légiférer de manière générale et seulement pour la Charia.
L’invocabilité de la Charia devant les tribunaux peut néanmoins être limitée pour des motifs tirés de la protection de l’« ordre public » fédéral ou étatique (public policy exception). Cette limite ‒ qui est également opposée par les juges à des législations étrangères via des jugements étrangers ‒ est relativement aisée à circonscrire lorsque l’« ordre public » invoqué ressort de la loi pénale. L’arrêt Reynolds rendu en 1878 par la Cour suprême des États-Unis à propos de la polygamie chez les Mormons[32] est en la matière une référence.
Reynolds avait été condamné sur le fondement d’une loi fédérale incriminant la bigamie, malgré son invocation des convictions et des obligations religieuses (religious belief or duty) découlant de la doctrine favorable à la polygamie alors en vigueur au sein de l’« Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Afin de valider cette condamnation, la Cour suprême dut d’abord admettre le pouvoir du Congrès d’édicter une infraction fédérale de polygamie, analysée par elle comme une « interférence » avec un agissement lié à la religion (et non une interférence avec une croyance religieuse considérée en elle-même)[33]. La Cour s’appuya dans cette perspective sur le caractère lointain de la condamnation de la polygamie en Europe du Nord et de l’Ouest, Angleterre et Pays de Galles compris, et sur la réception de cette condamnation dans la nouvelle République américaine[34].
La Cour fit ensuite valoir que l’acceptation d’une cause d’irresponsabilité pénale tenant aux convictions ou obligations religieuses aurait deux conséquences paradoxales : d’une part elle reviendrait à admettre une certaine supériorité des croyances religieuses sur la législation étatique ; d’autre part si ceux qui font de la polygamie une composante de leurs croyances et convictions religieuses étaient soustraits du champ d’application de l’infraction définie par la loi, fit-elle valoir, « ceux qui ne font pas de la polygamie une partie de leur croyance religieuse pourraient être déclarés coupables et punis, tandis que ceux qui le font, devraient être acquittés et libérés. Ce serait l’introduction d’un nouvel élément dans le droit pénal »[35].
Dès lors que l’infraction incompatible avec des pratiques religieuses et ne prévoyant pas d’exception en faveur des convictions religieuses est valide ‒ dans son principe comme dans ses propriétés (clarté et précision, non-rétroactivité) ‒ elle prévaut donc[36]. À charge pour les juges de s’assurer de ce que l’élément intentionnel de l’infraction est établi. Cette dernière exigence a été précisée dans Reynolds, la Cour faisant valoir fermement que l’ignorance de la loi ne saurait être une cause d’irresponsabilité pénale[37].
L’« ordre public » fédéral ou étatique invocable contre l’application de la Charia peut ne pas ressortir de la loi pénale. Cette hypothèse est néanmoins rare parce qu’elle contraint spécialement les décideurs publics et les juges à caractériser le « besoin social impérieux » ou le « motif prépondérant d’intérêt public » ‒ ce lexique de la Cour européenne des droits de l’Homme est emprunté ici à titre figuratif ‒ en question. Le cas le plus notoire s’est rapporté à la discrimination raciale et à sa prohibition fédérale assortie de la faculté pour les procureurs fédéraux d’engager une action civile. Dans un célèbre arrêt Bob Jones rendu en 1983[38], la Cour suprême a ainsi jugé que la prohibition fédérale de la discrimination raciale constituait un motif d’« ordre public » justificatif du refus des services fiscaux fédéraux d’accorder des exemptions fiscales à une université chrétienne fondamentaliste qui, sur le fondement des écritures (et non sur une doctrine raciale autonome), interdisait formellement les relations sexuelles interraciales (sexual mixing)[39] et les mariages interraciaux, une interdiction spécialement dirigée contre les étudiant(e)s Noir(e)s, qui n’ont été admis(e)s par l’Université qu’en 1971[40].
*
L’invocabilité judiciaire de la Charia aux états-Unis compte donc parmi les manifestations du pluralisme juridique américain. Au même titre que la souveraineté tribale des Indiens. C’est ce pluralisme juridique que tendent à méconnaître les discours, assez prégnants en France, sur l’hostilité du « droit américain » au « droit d’origine externe » (cette expression étant entendue ici dans un sens matériel comme désignant tout ce qui ne serait pas « authentiquement américain »). Cette idée a prospéré à la lumière des préventions exprimées par certains juges ou par certains juristes à l’idée de voir le droit des États-Unis se soumettre à celui d’autres pays. Ces préventions se sont cristallisées en particulier autour de l’arrêt Roper v. Simmons (2005) par lequel la Cour suprême a jugé contraire au VIIIe amendement de la Constitution américaine l’application de la peine de mort aux personnes mineures au moment du crime pour lequel ils ont été jugés coupables. L’arrêt Roper a particulièrement été commenté sous l’angle du dissensus qui a opposé les juges Anthony Kennedy et Antonin Scalia : le premier, auteur de l’opinion majoritaire, se prononçait en faveur d’une sollicitation du « droit d’origine externe » à titre « instructif » ou confortatif de l’interprétation de la Constitution américaine, faisant remarquer que cette position était celle de la Cour depuis au moins Trop v. Dulles (1958) ; le second, auteur d’une vigoureuse opinion dissidente, se voulait d’autant plus hostile à la soumission du droit des États-Unis au « droit d’origine externe » qu’il reprochait à de nombreux droits étrangers de ne pas garantir un certain nombre de « principes fondamentaux de droit constitutionnel », par exemple l’Exclusionary Rule qui, en droit américain, frappe de nullité toute preuve obtenue en violation des droits du prévenu[41].
Pour autant, l’idée d’une « hostilité » des États-Unis au « droit d’origine externe » a quelque chose d’une appréhension partielle des choses[42], puisqu’elle méconnaît ou mésestime certains autres faits : ‒ par exemple le fait que la Cour suprême statue précisément en faveur du droit d’origine externe dans Roper, suivant une très ancienne tradition qui fait exister de nombreux arrêts de la Cour suprême datés de la première moitié du XIXe siècle et mobilisant du droit d’origine externe[43] ; ‒ par exemple le fait que si la question s’est posée en termes renouvelés devant la Cour suprême dans la période contemporaine, c’est bien parce que des juridictions fédérales invoquaient le droit international public en général et le droit international des droits de l’Homme et le droit international humanitaire en particulier[44] ; ‒ par exemple le fait de la très grande appropriation du droit international privé par les juridictions fédérales et, surtout, par les juridictions d’État[45]. Et, ce que montre le mouvement anti-Charia, c’est que les juridictions américaines font bien droit aux « préceptes juridiques d’autres nations et d’autres cultures », la question étant de savoir jusqu’à quel point elles peuvent aller dans cette acceptation sans contrevenir aux droits garantis aux personnes par la Constitution des États-Unis et par les constitutions des entités fédérées. Les réactions constitutionnelles ou législatives anti-Charia dans les États fédérés renvoient donc à cet enjeu constitutionnel et politique tout en exprimant une forme d’hostilité d’une partie de l’opinion publique à l’égard de l’islam.
——–
[1] Sur les procédés de démocratie directe dans les entités fédérées américaines, on se permet de renvoyer à notre étude sur « L’industrie des votations populaires aux états-Unis », RFDC, 2015, n° 100.
[2] Muneer Awad v. Paul Ziriax (Case No. CIV-10-1186-M).
[3] Sur cette question, voir spécialement de Will Kymlicka, « Démocratie libérale et droits des cultures minoritaires », in France Gagnon, Marie McAndrew & M. Pagé (eds.), Pluralisme, citoyenneté et Éducation, L’Harmattan, Montreal, 1996, p. 25-51 ; « Minority Group Rights: The Good, The Bad and the Intolerable », Dissent, 1996 (été), p. 22-30 (texte reproduit dans de nombreuses publications : http://post.queensu.ca/~kymlicka/articleschapters.php) ; « Liberalism, Individualism, and Minority Rights », in A Hutchinson & L. Green (eds.), Law and the Community, Carswell, 1989, p. 181-204. Voir également : Paul Schiff Berman, « Towards a Jurisprudence of Hybridity », Utah Law Review, Vol. 2010, Issue 1 (2010) : 11-30 ; Julie Ringelheim, Diversité culturelle et droits de l’homme. La protection des minorités par la convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2006.
[4] Dans le même ordre d’idées, voir notre note « Circoncision religieuse et droit à la santé des nouveaux nés. Décision d’un juge fédéral sur la Metzitzah b’peh » (http://droitamericain.fr/Circoncision-religieuse-et-droit-a.html). Voir encore, s’agissant de la France : Stéphane Papi, « Normes islamiques et droit interne en France : de quelques zones de confluences », Droit et Société, 2014/3, n° 88, p. 689-708.
[5] N. Marzouki, « Les débats sur le droit islamique aux États-Unis et au Canada, entre égalité formelle et pluralisme », in La Charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique (dir., Badouin Dupret), La Découverte, 2012, p. 265 et s.
[6] Andrea Elliott, « The Man Behind the Anti-Shariah Movement », New York Times, 30 juillet 2011 ; Pew Research Center, How Americans Feel About Religious Groups (Jews, Catholics & Evangelicals Rated Warmly, Atheists and Muslims more Coldly, 16 juillet 2014 ; Conor Friedersdorf, « Islamophobia is not a Myth », The Atlantic, 14 janvier 2015 ; Brendan O’Neill, « Islamophobia Is a Myth », National Review, 9 janvier 2015.
[7] Entre autres manifestations législatives de ces préventions, l’on peut citer le Mississippi Religious Freedom Restoration Act (Senate bill n° 2681) adopté par le Sénat du Mississippi le 31 janvier 2014 (48 voix contre 0, et 5 sénateurs absents), soit un texte voué à mieux garantir l’exercice de la « liberté religieuse » dans l’État en y interdisant toute mesure ou action susceptible d’avoir un effet réfrigérant sur cette liberté. Or la rédaction du texte a fait dire à ses adversaires que le texte pourrait empêcher les musulmans, par exemple, de s’interrompre de travailler afin de prier ou interdire à certains groupes de revêtir un couvre-chef à caractère religieux. Certains sénateurs n’ont cependant pas caché qu’il s’agissait de défendre le caractère chrétien des États-Unis en général et du Mississippi en particulier.
L’on peut encore citer l’adoption par la chambre basse du parlement du Mississippi le 2 janvier 2015 d’une proposition de loi ayant pour objet d’interdire l’usage du droit d’origine externe dans l’état (House Bill 177) au motif de la protection des droits garantis par la Constitution des états-Unis et la Constitution de l’état. C’est dans le même Mississippi que certains parlementaires proposent de faire de la Bible le livre symbolique de l’état (State Book) suivant l’usage qui veut que les états puissent avoir des symboles tels qu’un livre, un mammifère d’eau, une boisson officielle.
La construction d’un centre culturel musulman comptant une mosquée (la Cordoba House) à deux blocs de Ground Zero, le lieu des événements du 11 septembre 2001, a par ailleurs été l’objet d’une bataille judiciaire : c’est en vain qu’une fondation réputée pour ses opinions conservatrices (l’American Center for Law and Justice) a demandé aux juridictions de l’État d’annuler la décision de la ville de New York qui a rendu possible cette construction en ne lui opposant pas le caractère de « lieu classé » (landmark) du site du 11 septembre 2001. L’argument juridique des adversaires de ce centre culturel musulman euphémise en réalité une hostilité politique nourrie par l’idée que l’existence d’un centre culturel musulman près de Ground Zero serait une insulte à la mémoire des victimes (Laurie Goodstein, « Concern Is Voiced Over Religious Intolerance », The New York Times, 7 septembre 2010 ; Feisal Abdul Rauf, « Building on Faith », The New York Times, 7 septembre 2010). Sur l’effet réfrigérant des dispositifs de lutte contre le financement du terrorisme sur la pratique par les Musulmans d’activités caritatives, et notamment sur leur obligation religieuse d’aumône (la zakât), voir le rapport de l’ACLU, Blocking Faith, Freezing Charity: Chilling Muslim Charitable Giving in the War on Terrorism Financing, juin 2009.
[8] Ces organisations (ainsi de l’Assembly of Muslim Jurists of America ou de la défunte Shariah Scholars Association of North America) ne sont pas à mettre sur le même plan que des institutions universitaires qui travaillent sur la Charia comme l’Islamic Legal Studies Program de la Harvard Law School.
[9] Center For Security Policy, Shariah Law and American Courts: An Assessment of State Appellate Court Cases, 20 mai 2011, p. 9. Les statistiques établies par cette étude sur la période allant de 2010 à sa publication en 2011 répartissent ainsi les cas par État : Arizona (1) – Arkansas (1) – Californie (5) – Delaware (1) – Floride (4) – Illinois (1) – Indiana (1) – Iowa (2) – Louisiane (2) – Maine (1) – Maryland (3) – Massachusetts (4) – Michigan (1) – Minnesota (1) – Missouri (1) – Nebraska (2) – New Hampshire (1) – New Jersey (6) – Ohio (1) – Caroline du Sud (1) – Texas (3) – Virginie (3) – Washington (4). C’est nous qui traduisons.
[10] François-Paul Blanc, Le droit musulman, Dalloz, 2e éd., 2007, p. 9.
[11] R. Gleave, « La charia dans l’histoire : ijtihad, épistémologie et « tradition classique » », in La Charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique (dir., B. Dupret), La Découverte, 2012, p. 24-25. Le trouble caractéristique de la perception de la Charia, au-delà même de « l’Occident », est imputé notamment à la concurrence entre des écoles interprétatives de l’islam sunnite (le chafiisme, le hanafisme, le malikisme, le hanbalisme) (B. A. Venkatraman, « Islamic States and the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: Are the Shari’a and the Convention Compatible? » (1995) 44 Am. U.L.Rev.1949-2027).
[12] Sur la réception des mariages musulmans par les tribunaux civils occidentaux, voir P. Fournier, Mariages musulmans, tribunaux d’Occident : Les transplantations juridiques et le regard du droit, Presses de sciences po, 2013. Pour les États-Unis, l’on peut se reporter aux études suivantes : Lindsey E. Blenkhorn, « Islamic Marriage Contracts in American Courts: Interpreting Mahr Agreements as Prenuptials and Their Effect on Muslim Women », Southern California Law Review, Vol. 76, Issue 1 (November 2002): 189-234 ; Emily L. Thompson & F. Soniya Yunus, « Choice of Laws or Choice of Culture: How Western Treat the Islamic Marriage Contract in Domestic Courts », Wisconsin International Law Journal, Vol. 25, Issue 2 (2007): 361-396 ; Nathan B. Oman, « Bargaining in the Shadow of God’s Law: Islamic Mahr Contracts and the Perils of Legal Specialization », Wake Forest Law Review, Vol. 45, Issue 3 (2010): 579-606.
[13] S.D. v. M.J.R., 2 A.3d 412 (N.J. Super. Ct. App. Div. 2010).
[14] Hosain v. Malik, 671 A. 2d 988 (Md. Ct. Spec. App. 1996).
[15] Sur ce contrat, voir P. Fournier, op. cit., p. 31-68. « Alors que les juristes musulmans », écrit Pascale Fournier, « voient dans le Mahr un symbole religieux de dignité, de respect et d’amour pour toutes les femmes musulmanes, la fluctuation des sommes qui lui sont attribuées est présentée comme le reflet du statut socio-économique de cette femme musulmane particulière. Au surplus, pour les féministes, si le mahr symbolise l’augmentation positive du pouvoir des femmes accédant à un droit de propriété, il demeure attaché à une conception patriarcale (négative) de la commercialisation de la sexualité féminine » (p. 31).
[16] In re Marriage of Obaidi, 227 P. 3d 787 (Wash. Ct. App. 2010).
[17] Abd Alla v. Mourssi, 680 N.W.2d 569 (Minn. Ct. App. 2004).
[18] El-Farra v. Sayyed, et al., 226 S.W.3d 792 (Ark. 2006).
[19] C’est nous qui traduisons. Cette formulation quelque peu alambiquée a vocation à préserver ces législations de récriminations sous l’angle de la Due Process Clause (voir infra).
[20] La peine minimale d’emprisonnement encourue est généralement fixée à 15 ans.
[21] C’est nous qui traduisons.
[22] C’est nous qui traduisons.
[23] Center For Security Policy, Shariah Law and American Courts: An Assessment of State Appellate Court Cases, 20 mai 2011 ; Robert Spencer, « The Necessity of Anti-Sharia Laws », American Thinker, 13 mars 2012.
[24] Robert K. Vischer, « The Dangers of Anti-Sharia Laws », First Things, 1er mars 2012 ; Martha F. Davis & Johanna Kalb, « Oklahoma State Question 755 and An Analysis of Anti-International Law Initiatives », American Constitution Society for Law and Policy, janvier 2011.
[25] Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38, 52 (1985).
[26] Voir par exemple : Eun-Jung Katherine Kim, « Islamic Law in American Courts: Good, Bad, and Unsustainable Uses », 28 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol’y 287 (2014).
[27] Voir infra la note 33.
[28] Educ. Employees Credit Union v. Mut. Guar. Corp., 50 F.3d 1432, 1438 (8th Cir. 1995).
[29] Sur la portée normative du Due Process en général et son double visage (Substantive Due Process d’une part et Procedural Due Process d’autre part), voir notre étude : « Droit à un procès équitable et Due Process of Law », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 44, p. 49-59.
[30] Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Milivojevich, 426 U.S. 696, 710, 96 S.Ct. 2372, 49 L.Ed.2d 151 (1976); Presbyterian Church v. Mary Elizabeth Blue Hull Memorial Presbyterian Church, 393 U.S. 440, 449, 89 S.Ct. 601, 21 L.Ed.2d 658 (1969); Watson v. Jones, 80 U.S. (13 Wall.) 679, 727, 20 L.Ed. 666 (1871).
[31] Alicea-Hernandez v. Catholic Bishop of Chicago, 320 F.3d 698 (7th Cir.2003) ; Scharon v. St. Luke’s Episcopal Presbyterian Hospitals, 929 F.2d 360 (8th Cir.1991) ; Minker v. Baltimore Annual Conference of United Methodist Church, 894 F.2d 1354, 1359 (D.C.Cir.1990) ; Hutchison v. Thomas, 789 F.2d 392 (6th Cir.1986) ; Rayburn v. General Conference of Seventh-Day Adventists, 772 F.2d 1164 (4th Cir.1985) ; Simpson v. Wells Lamont Corp., 494 F.2d 490 (5th Cir.1974). L’originalité statutaire des entreprises de conviction religieuse (celles-ci existant concurremment à des entreprises de conviction laïque) a une très grande ancienneté aux états-Unis. Voir par exemple notre note : « La Constitution des États-Unis exclut les ministres du culte du champ d’application du droit anti-discrimination. Cour suprême des États-Unis, 11 janvier 2012, Equal Employment Opportunity Commission – Cheryl Perich », 12 janvier 2012 (http://droitamericain.fr/La-Constitution-des-États-Unis) ; voir également notre étude « L’exceptionnalisme juridique américain vu des États-Unis », op. cit., p. 45-46. Il existe des cas intéressant des ruptures de contrats d’emploi par des entreprises de tendance religieuse musulmane, les stipulations de ces contrats prévoyant une rupture unilatérale par l’employeur en cas d’agissements de l’employé contraires à la Charia.
[32] Reynolds v. United States, 98 U.S. 145, 25 L. Ed. 244 (1878).
[33] La formulation la plus couramment citée de cette différence de statut constitutionnel de la liberté de croire (freedom to believe) et de la liberté de manifester ses convictions ou croyances religieuses (freedom to act) est celle de l’arrêt Cantwell v. Connecticut qui renvoie lui-même à Reynolds :
« The constitutional inhibition of legislation on the subject of religion has a double aspect. On the one hand, it forestalls compulsion by law of the acceptance of any creed or the practice of any form of worship. Freedom of conscience and freedom to adhere to such religious organization or form of worship as the individual may choose cannot be restricted by law. On the other hand, it safeguards the free exercise of the chosen form of religion. Thus the Amendment embraces two concepts, — freedom to believe and freedom to act. The first is absolute but, in the nature of things, the second cannot be. Conduct remains subject to regulation for the protection of society » (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 60 S. Ct. 900, 84 L. Ed. 1213 [1940]).
Afin de justifier la faculté pour les pouvoirs publics de s’ingérer dans certaines manifestations de croyances religieuses, la Cour, dans Reynolds, cite notamment l’hypothèse dans laquelle les pouvoirs publics préviendraient en les interdisant des sacrifices humains fondés sur des croyances religieuses ou pour empêcher le passage à l’acte d’une femme qui croirait religieusement avoir le devoir de se brûler sur le bûcher funéraire de son défunt mari.
[34] On trouve en particulier dans Reynolds une lecture politique de la monogamie et de la polygamie ainsi qu’un rejet explicitement politique du patriarcat : « En fait », écrit la Cour, « selon que les mariages monogames ou polygames sont autorisés, l’on voit les principes sur lesquels, à un degré plus ou moins grand, le pouvoir politique repose ».
[35] C’est nous qui traduisons.
[36] Pour une application de ce principe par la Cour suprême, voir également : Employment Division, Department of Human Resources of Oregon v. Smith, 494 U.S. 872, 110 S. Ct. 1595; 108 L. Ed. 2d 876 (1990). La Cour suprême a statué dans cette espèce sur l’applicabilité d’une loi d’État prohibant la consommation de certaines drogues à la consommation du peyotl (peyote) fondée sur des motifs religieux par certaines tribus indiennes. La question portait plus précisément sur l’impossibilité pour un chômeur licencié pour violation de l’incrimination légale de la consommation du peyotl d’accéder à des aides publiques de l’Oregon destinées aux chômeurs, nonobstant la dimension religieuse de sa consommation.
[37] Dans le même sens, et s’agissant toujours de la polygamie pratiquée par les Mormons, voir : Cleveland v. United States, 329 U.S. 14, 67 S. Ct. 13, 91 L. Ed. 12 (1946).
[38] Bob Jones University v. United States, 461 U.S. 574, 103 S. Ct. 2017; 76 L. Ed. 2d 157 (1983). Cet arrêt s’est prêté à un commentaire très remarqué : Robert M. Cover, « The Supreme Court, 1982 Term–Foreword: Nomos and Narrative », 97 Harv. L. Rev. 4, 11–15 (1983).
[39] Sur le sexual mixing comme objet d’étude, voir en langue française : Christine Salomon, « Jungle Fever. Genre, âge, race et classe dans une discothèque parisienne », Genèses 4/ 2007 (n° 69), p. 92-111.
[40] Mokhtar Ben Barka, « La Bob Jones University : hier et aujourd’hui », Revue LISA/LISA e-journal, Vol. II – n°1 | 2004, 111-126.
[41] V. P. Mbongo, « L’exceptionnalisme juridique américain vu des États-Unis », in Le droit américain dans la pensée juridique française contemporaine, op. cit., p. 35-54.
[42] D’ailleurs, de la même manière que cette doctrine ne prête pas attention à la résistance de différents états à l’invocabilité de la Charia, elle ne prête pas non plus attention à la résistance des législateurs de certains états à la réception de l’Agenda 21 de l’Organisation des Nations unies, soit la Déclaration de l’ONU sur le développement durable adoptée en 1992 par la Conférence de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement.
[43] Voir par exemple : Johnson v. M’Intosh, 21 U.S. (8 Wheat) 543 (1823) ; Cherokee Nation v. Georgia 30 U.S. (5 Pet.) 1, (1831) ; Worcester v. Georgia, 31 U.S. (6 Pet.) 515 (1832).
[44] Paul Schiff Berman, « Federalism and International Law Through the Lens of Legal Pluralism », 73 Mo. L. Rev. 1151 (2008).
[45] La Cour suprême elle-même, dans Abbott v. Abbott (2010), a raisonné à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, des législations britannique, autrichienne, australienne, sud-africaine, allemande… Et, dans un travail fondé sur des sources directes, un auteur a montré à quel point la thèse de « l’hostilité des États-Unis » à l’égard du droit international pénal ou de la Cour pénale internationale consistait elle aussi un raccourci : Julian Fernandez, La politique juridique extérieure des États-Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, Pedone, 2010.